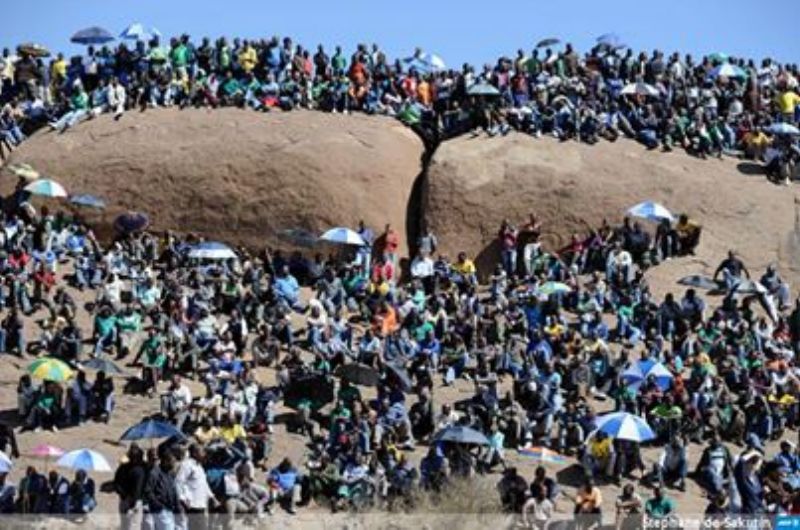
Nous avons traversé les sphères concentriques de notre monde depuis le centre de la terre, en passant par l'eau, puis l'air, jusqu'au vide intersidéral. Nous étions ensuite revenus sur le vernis du vivant entre le solide et le gazeux, la biosphère.
Avant de prendre encore plus de hauteur et bien que ce soit complètement en dehors de ma formation initiale, je voudrais vous faire part d'une intuition qui m'est venue pendant que je préparais le chapitre suivant et qui s'est étoffée au point de pouvoir constituer un ensemble structuré et cohérent, si ce n'est consistant. Je me suis posé la question de regarder comment la vie se complexifie par dessus la sphère matérielle proprement dite.
Il s'agit évidemment de spéculations personnelles, d'un regard de biologiste sur un monde vis-à-vis duquel je n'ai jamais reçu la moindre formation officielle, juste un peu d'éthologie rudimentaire. J'ai, bien sûr, parcouru un peu de ce qui est disponible sur Internet pour me déniaiser vaguement mais comme je n'ai rien trouvé de probant pouvant rejoindre l'armature de mon intuition (bien que tout ce que j'ai pu découvrir s'imbrique plutôt bien dedans), j'ai assez vite laissé tomber pour me fier à elle.
Donc, "je sais rien mais je dirai tout", c'est une intuition, un regard sur les rapports sociaux différent de l'académique en vogue (bien qu'il existe dans la sociologie/ethnologie formelle quelques recherches récentes allant un peu dans ce sens-là) et, contrairement aux chapitres précédents, pas du tout une synthèse des connaissances établies. Ceci dit, elle s'appuie sur des connaissances établies : je ne suis pas de taille à réinventer le monde, chose qui, de toute façon, ne peut pas me motiver.
Disons que c'est une bouteille jetée à la mer pour que d'autres reprennent, appuient, corrigent ou démolissent cette intuition.
À vous de voir.
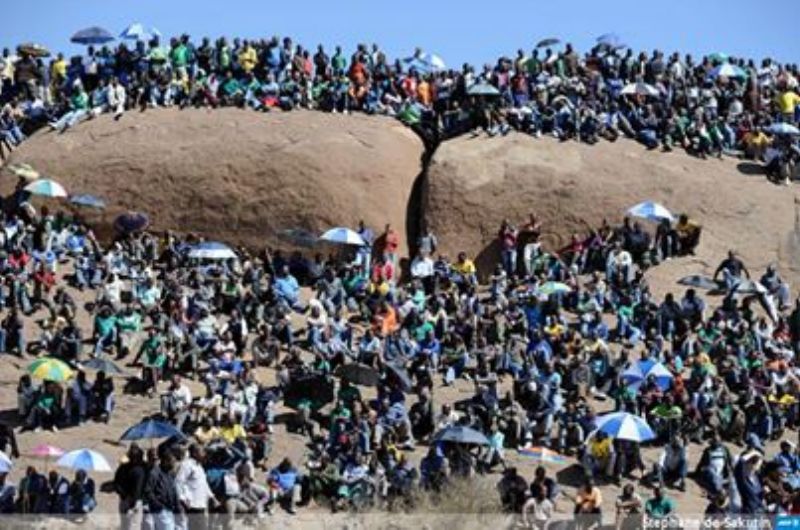
Pour pouvoir partager ce qui va suivre, je crois utile de rappeler d'abord quelques faits et lois pour mieux comprendre.
Quel que soient le domaine dans lequel on mène une activité, son ampleur et son échelle, deux lois empiriques semblent présider à toute action.
Une définition tout d'abord : le rendement est le rapport entre l'énergie dépensée et celle effectivement transformée dans un but donné, d'une certaine façon c'est celle reçue en retour, le rapport dépenses/recettes de l'opération. Cette définition est générale, elle s'applique dans tous les domaines. Bien sûr, tout est possible, depuis les rendements nuls, le gaspillage "pur", jusqu'aux rendements infinis ou presque, "l'effet papillon" en étant la plus célèbre image.
En physique stricte, le rendement est le rapport entre l'énergie "utile" et celle "fournie". Si la définition précédente reste vraie, la pratique montre que, dans le domaine mécanique au moins, la grande majorité des rendements se répartit entre 15 et 40 %. Bien que dans les autres domaines, le sociologique en particulier, la notion de rendement soit plus élastique (puisqu'on peut prétendre a posteriori avoir visé le but atteint et non pas celui réellement poursuivi), il est logique de considérer que cette moyenne soit largement partagée, voire souvent inférieure à 15 % puisque moins matérielle.
Cette célèbre loi "sociologique" est aussi connue sous le nom de loi de Pareto.
En gros, elle dit que 80 % des conséquences sont provoquées par 20 % des causes, que 80 % des espaces sont occupés par 20 % des ressources, que 80 % du temps ou des efforts ne servent qu'à 20 % du résultat, que 20 % des possibilités servent dans 80 % des cas.
Elle est d'origine sociologique mais elle se vérifie dans tous les domaines ... à 80 %.
On peut aussi la traduire en se disant que pour obtenir un résultat quelconque sur quoi que ce soit, l'énergie et le temps à consacrer à ce qui encadre le moindre résultat sont toujours 4 fois plus importants que ceux consacrés au résultat en lui-même (réflexion, préparation, équipement, action (20%), évaluation, rangements, entretien, réparations & nettoyages, etc.). C'est valable depuis la moindre expérience formelle scientifique de laboratoire, jusqu'au plus banal des repas quotidiens, courses et vaisselles incluses.
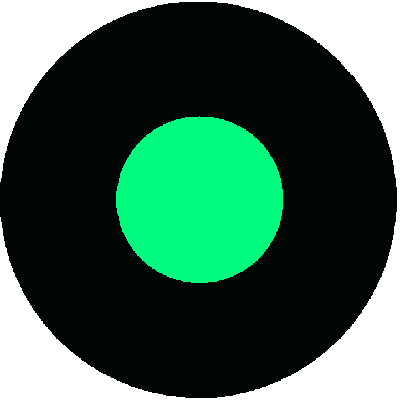 80/20 en surface, les 20% au centre |
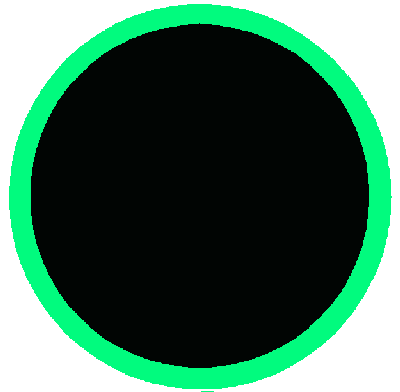 80/20 en surface, les 20% autour |
Cette autre loi est issue de l'informatique et d'Internet. Elle est également appelée loi de Nielsen (appliquée à la vitesse de connexion), sinon règle du 1 % (appliquée à la participation des internautes).
En gros, elle dit que, quel que soit le sujet, moins de 1 % de la population des internautes y contribue de façon proactive (c'est à dire autrement que par des "lol", "+1" et autres smileys, 9 % y participent occasionnellement de façon opportuniste et 90 % n'y contribuent jamais.
Je ne la connaissais pas et sa découverte m'a fichu un sacré vertige : si seulement 1 % des internautes contrôlent la totalité de ce qui y est dit, le pouvoir d'influence qu'ils prennent alors sur les autres est supérieur à tout ce que j'ai pu imaginer jusque-là. C'est plutôt inquiétant pour la démocratie, surtout lorsque les grands lobbys décideront d'y consacrer leurs moyens pour de bon (cf. ACTA, SOPA, PRISM, HADOPI, etc...)
Comme elle dépasse largement le domaine de l'Internet, qu'elle est plutôt universelle, ma peur risque fort d'en trouver des preuves terrifiantes comme celle-ci : Quand la science découvre les 1 % qui dirigent l'économie
En tout état de cause elle renforce la loi de Pareto et montre que "de petites causes peuvent avoir de grandes conséquences" et, bien sûr, elle ne s'applique pas qu'à l'informatique et Internet. D'une certaine façon, on peut la considérer comme une sorte de formalisation du fameux "effet papillon" et sa généralisation est extrêmement importante bien au-delà de la sociologie.
On remarquera aussi qu'elle est liée à la précédente car, en fait, la loi des 80/20 en est une approximation. En réalité, il existe 3 parties dans la loi des 80/20 : la troisième est un "résidu" pas assez significatif pour justifier un lourd investissement dessus mais elle existe, disons que c'est 80/20 à 1% près ...
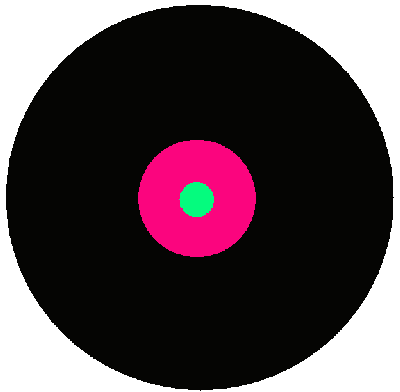 90-9-1 en surface, les 9+1% au centre |
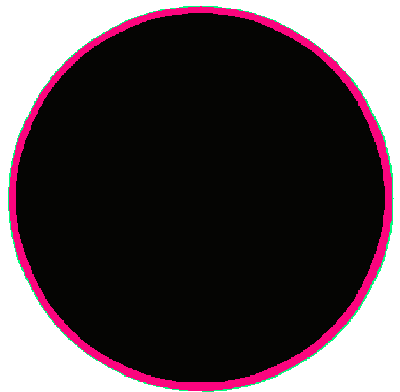 90-9-1 en surface, les 9+1% autour |
On la retrouve partout, dans l'effet du sel et des autres condiments sur la nourriture, dans les concentrations des principes actifs de pratiquement tous les médicaments, dans celles des colorants des peintures, aliments et autres, dans la proportion de fer de l'hémoglobine, du magnésium de la chlorophylle, de tous les catalyseurs de toutes les réactions chimiques, jusqu'au fameux "grain de sable qui bloque la machine" ou au dicton "quand on est plusieurs il est plus facile de faire du bruit que du silence", voire aussi le "un seul être vous manque et tout est dépeuplé" (ou repeuplé, c'est selon), etc.
La Loi Normale décrit un phénomène courant qu'on pourrait imager avec, par exemple, du sable s'écoulant dans un sablier : quand on le retourne, tous les grains de sable vont descendre par le petit trou qui sépare les deux ampoules de verre à fond plat. Tous ces grains commencent leur chute du même endroit mais ils ne la terminent pas tous au même endroit. Quelle est la probabilité qu'un grain s'immobilise à un endroit donné ? C'est ce que décrit cette loi.
La répartition finale des grains est prévisible et chacun a pu le vérifier consciemment au moins une fois dans sa vie mais ce qu'on n'imagine pas en regardant ce petit tas de sable, ou tout autre tas d'éléments de petite taille constitué par leur écoulement à partir d'une source unique (trou dans un sac de riz, montagne de sel, de minerai, de graines ou autre, au bout d'une trémie, terrils, décharge de benne de camion, etc.), c'est que plus de la moitié du tas se tient dans un volume égal ou inférieur à celui occupé par les moins de 10 % qui se sont répartis au plus loin du centre du tas, au plus loin de la verticale du point de chute. La répartition des éléments issue d'une loi normale a toujours cette allure. L'examen des probabilités associées aux cercles concentriques à la verticale du point de chute image bien les deux lois précédentes.
C'est la loi statistique la plus connue, c'est aussi la plus universelle. On l'applique sans gros risque d'erreur dès que le nombre d'essais, de tests, est supérieur ou égal à 100. En dessous, les risques d'erreur deviennent trop importants et on lui préfère des lois plus "sur mesure" comme la loi de Poisson puis, en gros en-dessous de 50, la loi Binomiale.
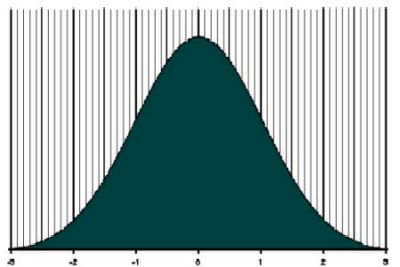 courbe de Gauss, Normale centrée, réduite |
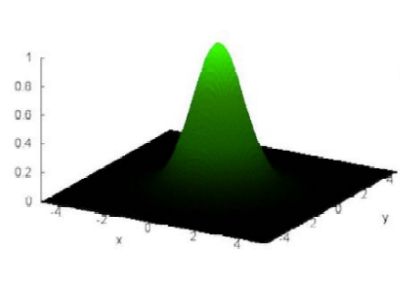 La même en 3D |
Si l'on représente les deux lois précédentes sur des schémas de loi Normale, ça donne quelque chose comme ça :
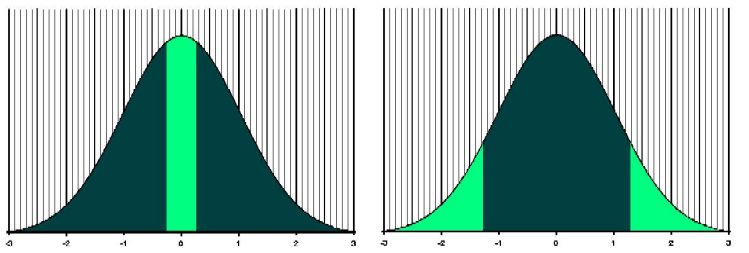
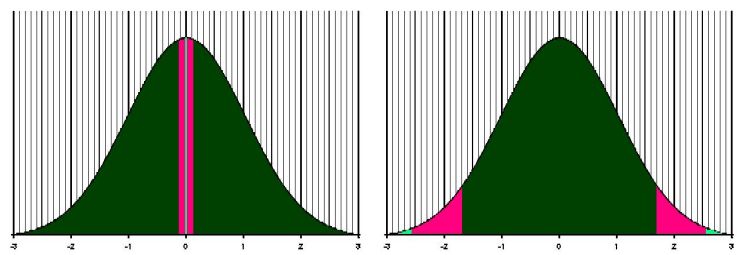
Ceci pour serrer d'un peu plus près l'image que ça pourrait avoir avec des grains de sable :
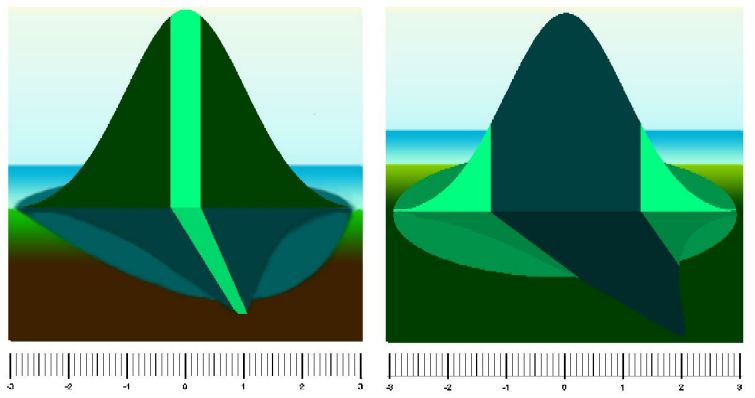
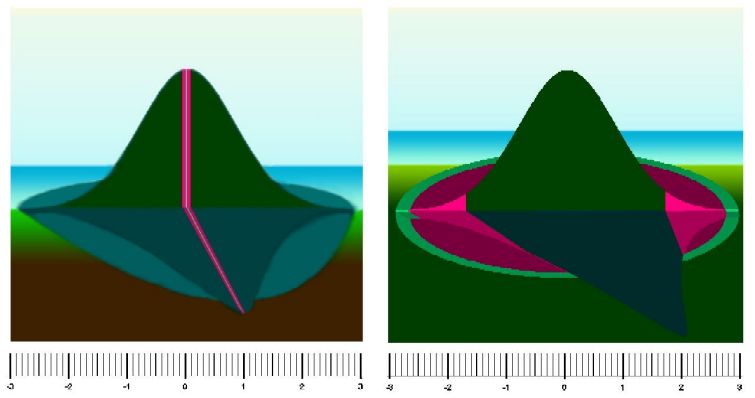
Ça aide à voir ce que "minorité" veut dire selon qu'elle soit aux commandes ou aux marges.
Petit retour sur la biosphère pour rappeler le principe fondamental qui régit le maintien et l'expansion de la vie depuis qu'elle existe ici. J'écrivais :
"Le défi de toute espèce, l'objectif implicite recherché par son génome, est d'arriver à occuper de façon durable le plus grand volume possible de ce qui l'entoure tout en satisfaisant ses besoins élémentaires le mieux possible, en étant "bien nourrie", le mieux possible.
A ce titre, "tout fait ventre" : à partir du moment où quoi que ce soit peut être exploité comme ressource pour en être "bien nourri", pour chaque individu et quelle que soit son espèce, c'est "bon à prendre" même si ce "quoi que ce soit" est vivant, même de sa propre espèce. C'est un réflexe aussi vieux que les premières formes de vie. C'est celui qui sous-tend toute l'évolution du vivant depuis son origine. Il doit d'être toujours aussi fondamental à toute forme vivante aujourd'hui au succès qu'il apporte au maintien de leur génome dans la biosphère.
D'un autre côté, la Vie a autant horreur du vide que de l'uniformité : pour la vie, d'une certaine façon, c'est la même chose, tout espace homogène, uniforme, qu'il soit physique ou biologique, voire conceptuel, est un "splendide marché à conquérir". La première espèce trouvant une façon de l'exploiter pour son compte peut rapidement en exploser ses effectifs, donc offrir une plus grande stabilité à son génome, donc renforcer sa pérennité."
Cette règle s'applique dans tous les domaines, à toutes les espèces. On trouve même une version "sociale" chez les fourmis :
Il existe environ 12 000 espèces de fourmis. C'est une estimation, on pourrait tout aussi bien dire 10 ou 15 000. Chaque espèce est socialement structurée et pour une espèce donnée, toute autre espèce est "considérée comme" une autre entité, menace ou ressource. La latitude comportementale d'une fourmi dans sa colonie est plus qu'étroite. Les comportements face aux différentes situations sont très stéréotypés. Il faut dire que si l'on évalue l'individualisation de l'espèce humaine à environ 100 000 ans (cent mille), pour les fourmis on parle plus facilement de 100 000 000 d'années (cent millions). Il est donc logique que leur évolution soit mille fois plus poussée et leur diversité en espèces dix mille fois plus élaborée que celles des grands singes.

Sociologiquement parlant, il est logique que, pour la famille des fourmis, tout ce qui a pu être possible, viable et stable ait été "poussé à fond" dans toutes les directions possibles. Elles sont donc, au sein de la même espèce comme entre leurs espèces, extrêmement intéressantes pour connaître les grandes lignes de l'univers des possibles des interrelations sociales ou apparentées.
Ainsi, non seulement les tâches des individus sont différentes selon leur naissance (reproducteurs, ouvrières, soldats), mais encore variables en fonction de l'âge de l'individu, comme chez les abeilles et les autres insectes sociaux. La densité des castes est contrôlée à la naissance en fonction de celle de la colonie qui, elle, est contrôlée par les limites de son environnement.
Il existe ce que nous appelons des fourmis esclavagistes, c'est à dire des espèces, très nombreuses, qui volent le naissain d'autres espèces de fourmis pour utiliser les individus qui en sortent à des fonctions et tâches précises, ce qui est fait avec suffisamment de "finesse" pour que l'espèce victime de cette prédation élaborée n'en disparaisse pas. Ceci dit, le mot "esclavagiste" est un anthropomorphisme abusif car l'esclave n'est pas de l'espèce "esclavagiste". C'est plutôt une chose qui serait à apparenter à ce que nous faisons avec d'autres vertébrés comme les vaches, chèvres, moutons, porcs, chevaux, volailles, etc. Bien que notre domination sur ces espèces ne soit pas taxée d'esclavagisme, les latitudes comportementales que nous leur tolérons sont largement plus étroites que celles laissées aux esclaves humains. Les fourmis font pour ainsi dire pareil.
Ceci étant, les espèces de fourmis sont plus voisines entre elles que l'homme avec son bétail. Il en résulte que les comportements en sont d'autant plus complexes. Ainsi, si l'esclavagisme existe et a atteint une sophistication poussée, il existe aussi des comportements adaptatifs qui cherchent à rétablir l'équilibre et bien d'autres choses encore à découvrir car nous n'en savons pas beaucoup sur cette grosse dizaine de milliers d'espèces. Le fait notable ici est que, sociologiquement, la pression de "prédation" des "esclavagistes" a été assez large et assez complexe pour permettre le développement d'un comportement antagoniste, pour constituer une sorte de "nouveau marché à prendre", pour leur faire inventer le "sabotage".
L'antagonisme esclavagiste-esclave autorise donc toute une déclinaison de possibilités permettant à ce type de relation de perdurer depuis une centaine de millions d'années. L'équilibre s'est fait en éliminant par sélection naturelle les espèces incapables d'arriver à le trouver, incapables de maintenir le génome soit des esclaves, soit des esclavagistes, soit des deux. La dépendance n'est pas nécessairement mutuelle, les esclaves survivent mieux sans les esclavagistes, mais elle existe encore pour celles ayant trouvé "un comportement durable de gestion de la ressource", un peu comme l'humain a changé l'auroch en vache, le loup en chien.
Évidemment et comme chacun le sait, rien n'interdit à l'homme d'en faire de même avec une partie de ses semblables, mais à un niveau moins élaboré. Les fourmis nous montrent qu'à ce niveau l'humain n'a rien inventé, en fait. Il suit un chemin qui a déjà été exploré avant lui.
L'organisation sociale des babouins est fondée sur un réseau de dominances qui prend en compte des facteurs très divers – force physique, sexualité, amitiés individuelles et surtout sociabilité.
En haut de la hiérarchie, on trouve les mâles adultes, suivis des mâles immatures et des femelles. Parmi ces dernières, celles qui sont en chaleur prennent le pas sur leurs compagnes.

Les mâles dominants, ceux qui l'emportent pour la conquête des femelles et forcent leurs rivaux à s'effacer, disposent de la meilleure nourriture et des perchoirs les plus confortables pour dormir dans les arbres. Leur supériorité ne dépend pas seulement de leur valeur dans les combats – la victoire allant au plus gros et au plus vigoureux –, elle relève aussi de leur aptitude à mettre les autres mâles dans leur camp, à former des alliances avec eux.
Les affrontements entre mâles sont fréquents, et cette fréquence est sans doute en partie à l'origine de certaines spécificités anatomiques de l'animal, notamment sa dentition incroyablement puissante. Dans la plupart des disputes, l'attitude menaçante du mâle – grondements, attaque simulée – ainsi que sa position dans la hiérarchie du groupe suffisent à dissuader l'adversaire mais il arrive que des mâles d'habitude soumis lancent des défis aux dominants. Le prix à payer alors pour les perdants est lourd : ils peuvent être blessés, parfois même tués.
Les mâles dominants ont presque toujours la priorité lorsqu'il s'agit d'aborder une femelle en chaleur. Ils ont donc plus de chances que les autres mâles de s'assurer une progéniture. Les mâles subordonnés, ou sub-adultes, eux, ne peuvent approcher les femelles qu'en dehors des périodes de réceptivité et de fécondité maximales. Quant aux jeunes des deux sexes, ils ne sont apparemment sujets à aucune attraction sexuelle. Les mâles dominants se désintéressent du comportement des femelles en dehors des périodes de fécondité.
Entre ces dernières la hiérarchie est bien moins nette que chez les mâles. Plusieurs d'entre elles peuvent participer à une agression contre l'une ou l'autre de leurs compagnes. Leur statut dépend de leur maturité sexuelle et du cycle de reproduction. Elles vivent en marge de la société et n'ont aucun pouvoir tant qu'elles sont trop jeunes pour se reproduire.
Ce schéma social n'est donc pas une invention humaine non plus.

Pour étudier leur aptitude à nager, un chercheur du laboratoire de biologie comportementale de la faculté de Nancy, Didier Desor, a réuni six rats dans une cage dont l'unique issue débouchait sur une piscine qu'il leur fallait traverser pour atteindre une mangeoire distribuant les aliments. On a rapidement constaté que les six rats n'allaient pas chercher leur nourriture en nageant de concert. Des rôles sont apparus, répartis ainsi : deux nageurs exploités, deux non nageurs exploiteurs, un nageur autonome et un non nageur souffre-douleur.
Les deux exploités allaient chercher la nourriture en nageant sous l'eau. Lorsqu'ils revenaient à la cage, les deux exploiteurs les frappaient et leur enfonçaient la tête sous l'eau jusqu'à ce qu'ils lâchent leur butin. Ce n'est qu'après avoir nourri les deux exploiteurs que les deux exploités soumis pouvaient se permettre de consommer leurs propres croquettes. Les exploiteurs ne nageaient jamais, ils se contentaient de rosser les nageurs pour se faire nourrir.
L'autonome était un nageur assez robuste pour ramener sa nourriture et passer les exploiteurs en la conservant. Le souffre-douleur, enfin, était incapable de nager et incapable d'effrayer les exploités, alors il ramassait les miettes tombées lors des combats. La même structure - deux exploités, deux exploiteurs, un autonome et un souffre-douleur s'est retrouvée dans les vingt cages où l'expérience a été reconduite.
Pour mieux comprendre ce mécanisme de hiérarchie, Didier Desor a placé six exploiteurs ensemble. Ils se battirent toute la nuit. Au matin, ils avaient recréé les mêmes rôles. Deux exploiteurs, deux exploités, un souffre douleur, un autonome. Ils ont obtenu le même résultat aussi en réunissant dans une même cage six exploités, six autonomes ou six souffres-douleur.
Puis l'expérience a été reproduite dans une cage plus grande contenant deux cents individus. Ils se sont battus toute la nuit, le lendemain il y avait trois rats crucifiés dont les autres avaient arraché la peau. Moralité: plus la société est nombreuse plus la cruauté envers les souffre-douleur augmente. Parallèlement, les exploiteurs de la cage des deux cents entretenaient une hiérarchie de lieutenants afin de répercuter leur autorité sans même avoir besoin de se fatiguer à terroriser les exploités.
Autre prolongation de cette recherche, les savants de Nancy ont par la suite ouvert les crânes et analysé les cerveaux. Or les plus stressés n'étaient ni les souffres-douleur, ni les exploités, mais les exploiteurs.
Se pourrait-il que, pour chaque espèce animale, il existe une sorte de grille d'organisation spécifique ? Quels que soient les individus choisis et dès qu'ils sont plus de deux, ils s'empressent de tenter de reproduire cette grille pour s'y intégrer. Peut-être que l'espèce humaine est tributaire d'une telle grille elle aussi.
Lorsque le singe s'est redressé il y a 6 (Orrorin tugenensis) ou 7 (Sahelanthropus tchadensis) millions d'années, il était déjà social mais le chemin a été long avant la généralisation de l'invention de la société.
La répartition des tâches de façon totalement disjointe est récente et, en apparence pour l'instant, humaine : c'est le seul vertébré connu où l'on trouve des individus profitant du travail d'autres de sa population sans jamais avoir y participé et dont le propre travail est également parfaitement étranger aux premiers.
Cette évolution récente a été rapide, initiée il y a entre 9 et 12 000 ans, au temps des premières villes, elle n'aurait pas pu apparaître avant. A cette époque, la structure principale de ces sociétés reposait sur trois piliers :
(Source : http://mimimato.forumactif.org/t60-d-ou-viens-je-qui-suis-je-ou-vais-je)
Ce dont on dispose aujourd'hui provient du croissant fertile, zone géographique qui recouvre d'un côté le pays des pharaons, le Nil, de l'autre celui des Assyriens et des Hittites entre le Tigre et l'Euphrate, le Jourdain entre les deux. Ces trois groupes culturels sont les plus anciens connus, ils ont commencé à laisser des traces il y a 12 millénaires, 2 000 ans avant le dernier grand changement climatique. Il y a donc certainement des traces à découvrir sous le niveau actuel de la mer, loin du rivage.
Au départ il s'agissait surtout de très gros villages, certains devenant villes, Uruk et Assur en particulier, Assur dont le fer de lance était ses commerçants qui ont délégué l'administration de la ville à son clergé au nom du dieu principal Assur, de même nom que la cité. La notion de roi est venue de là : le roi est le plus grand des prêtres et le chef de l'administration. Au départ il est élu pour gérer l'administration, puis il devient aussi le chef des armées tout en conservant son apostolat. D'autres villes-états sont nées "au même moment" dans la région et la compétition entre elles commence très rapidement aussi, Assur n'a pas toujours eu le dessus.
La Mésopotamie devient une constellation de petits états plus ou moins belliqueux entre eux. Leur fédération en un grand royaume a lieu par la force il y a en gros 4 millénaires, 3 800 ans environ, sous le règne de Samsi-Addu mais ce royaume se délitera "très vite" au profit de celui de Babylone : la société se cherche, cherche sa stabilité. Elle ne l'a pas trouvée dès le début ce qui nous vaut de nous entre-déchirer au détriment de la survie de toute la biosphère, de ne pas être une seule population-pays-société-civilisation aujourd'hui.
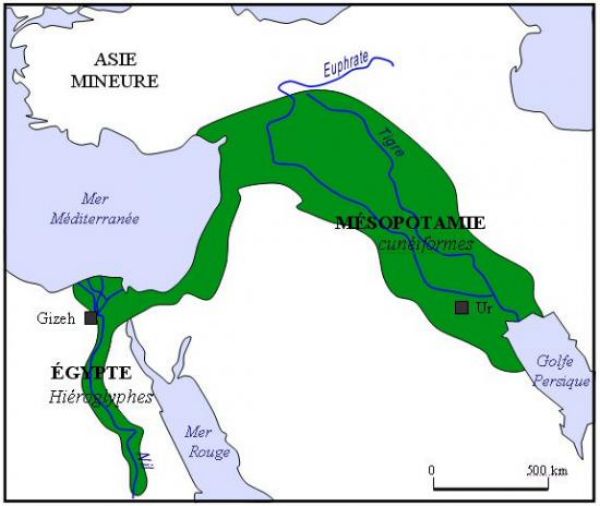
Les raisons de cet échec tiennent, pour moi, dans notre très fort individualisme et notre mépris de la vie des autres : la royauté "de droit divin" n'a pas réussi à éviter au roi d'être régulièrement assassiné par ses prétendants et concurrents, pas plus qu'à faire de lui un gestionnaire clairvoyant et visionnaire sachant stabiliser et étendre son royaume sans le fragiliser.
C'est une rançon énorme à la vie antérieure en bandes concurrentes et dispersées pour lesquelles les autres constituaient une menace à leur survie. Chose cohérente à l'époque puisque l'espace vital minimal exigé par le mode de vie prédateur-nomade est immense. A partir du moment où ces bandes fusionnent en populations denses et gérées centralement, donc dès l'apparition des premières cités-états et jusqu'à aujourd'hui, la situation s'inverse totalement sur ce plan : à court-moyen terme affaiblir ses partenaires affaiblit forcément tout le monde y compris soi-même. Le réflexe de compétition clanique qui s'est maintenu à l'intérieur des grandes populations bien constituées fragilise plus l'ensemble qu'il ne le stabilise mais on n'efface pas comme ça plus de 300 millénaires de notre évolution psychologique, hélas.
C'est aussi une rançon énorme à la spécialisation originelle entre hommes et femmes : les premiers se sont formés à être des prédateurs-conquérants, les secondes à être les gestionnaires de l'espace conquis mais comme les premiers ont avili et déprécié les secondes il était impossible de stabiliser durablement les territoires conquis, tout empire s'en est déstructuré très facilement.
L'irrespect des "faibles", des subtils, tue la civilisation.
Côté relations humaines, en dehors de l'économique, "ces temps étaient durs" : esclaves, hommes "libres", nobles et puissants, phallocratie, sentences de mort expéditives, droit de cuissage, nos pires travers étaient la règle - nécessité à être expéditif, binaire ?? - et pourtant le roi était élu au départ.
L'organisation sociale était finalement assez voisine de celle d'aujourd'hui : un roi comme chef des armées et du clergé, un clergé chargé de l'administration et des commerçants, paysans-guerriers et mercenaires-nomades. Ce sont bien ces trois forces fondamentales qui tiennent encore la cohérence de toute société humaine au monde : des chefs de clan, femmes et chasseurs sortent les notions de direction, administration et production sans qu'il y ait eu, depuis certainement des centaines de millénaires, quasiment d'autre évolution que cette généralisation-là sur seulement les 10-12 derniers millénaires.
Il est donc possible de considérer que l'invention des hommes du croissant fertile est d'avoir fédéré puis virtualisé les bandes, les clans, en les transformant en "cellules" d'un méta-organisme humain, en sous-groupes actifs plus ou moins individualisés et hiérarchisés dans une premlière grande société humaine, la physiologie de l'ensemble (leurs interrelations) régie par ce qu'on nomme "la loi" ou "le code".
Les trois couleurs les plus utilisées étaient le rouge, le noir et le blanc. On comprend, ce sont les plus voyantes dans un environnement marron et vert.
Une symbolique y était associée et elle a toujours cours aujourd'hui :
 |
 |
 |
| Le paysan-commerçant-guerrier est en noir, | le clergé-administrateur en blanc, | le roi en rouge. |
Les trois forces initialement constitutives de la société et mises en trois couleurs qui sont encore aujourd'hui sur les drapeaux de la plupart des pays du monde, le blanc pouvant se décliner en jaune, le noir en bleu ou en vert et le rouge en rouge ou violet. Bien sûr il y a eu évolution, les curés de base sont parfois en noir, le haut clergé peut être en violet, le pape est resté en blanc, les policiers sont en bleu ou en vert foncé, et en noir aussi, etc. mais aujourd'hui la permanence et l'universalité de cette structuration est saisissante, pratiquement intacte : roi, noblesse et clergé puis tiers état, partout au monde avec quelques variations de style mais à peine. (L'armée est récemment devenue mimétique de son cadre d'opération mais reste en foncé pour ses uniformes de parade, les soldats de base évidemment, on voit les officiers supérieurs en blanc).
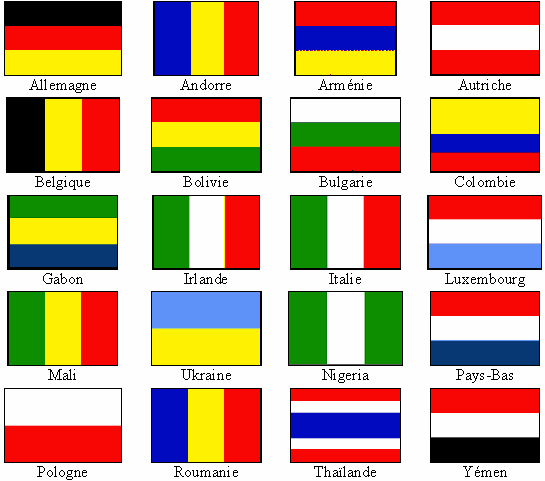
Les gens d'avant le 7e millénaire ne savaient pas écrire, ils n'en avaient pas besoin. Il est difficile de deviner comment ils en étaient arrivés à créer et maintenir "la haute" dans ces groupes forcément plus petits que leurs successeurs. Le mécanisme pourrait être l'intérêt évident qu'il y avait à courtiser le chef de clan pour améliorer son propre statut, comportement certainement né plusieurs centaines de millénaires avant le Würm, mais pourquoi-comment l'individu a-t-il perdu de vue que si son intérêt s'obtient au détriment du groupe alors il le tue ? Pourquoi était-ce viable, incontournable ? Comment s'en débarrasser aujourd'hui alors que cet endo-parasitisme est général sur toute la planète au point de menacer l'espèce et toute la biosphère ?
L'expérience ci-dessus sur les rats contient sans doute un élément de réponse.
Je remarque ici encore la présence récursive de cette structuration (administratif/commercial/technique) depuis les petites entreprises jusqu'aux états.
La récursivité des structures, qu'elles soient matérielles, physiologiques ou sociales, et bien que ce soit un sujet trop à la mode pour ne pas s'en méfier, saute aux yeux dès qu'on l'identifie au point d'en donner le vertige.
Outre de nous permettre de créer de jolis dessins que nous trouvons plus ou moins esthétiques et vertigineux, qu'est-ce qu'une fractale, sur quoi reposent-elles ?
Une fractale est un objet dont la structure et l'apparence ne changent pas quand on change d’échelle. On peut les considérer en absolument tout point comme des structures gigognes. C'est une quintessence de la récursivité puisqu'un objet fractal est un ensemble d'objets dont chaque élément lui est identique. La notion d'infini exposée ainsi me donne le vertige mais quel que soit ce qu'elle suscite, l'universalité de sa vérité dans ce qui nous entoure mérite qu'on s'y arrête.
Si tout secteur ou point d'une fractale est cette fractale, alors comment est-ce conçu, qu'est-ce qui en assoit et en dirige l'existence ?
Je ne sombrerai pas dans l'analyse mathématique car elle m'est aussi étrangère que soporifique, comme à beaucoup. Les explications imagées à notre échelle me semblent plus parlantes.
Pour générer une fractale, il faut de la récursivité et pour répéter à l'infini un motif il faut qu'il le permette au départ. Tout motif étant fait pour être répété, normalement on doit pouvoir faire des fractales avec n'importe quoi, y compris le "motif nul", le point. Ceci dit, il est difficile de voir une fractale dans une surface unie bien que c'en soit une : nos yeux ont besoin d'une différence, d'une opposition, d'un motif, puis de récursivité.
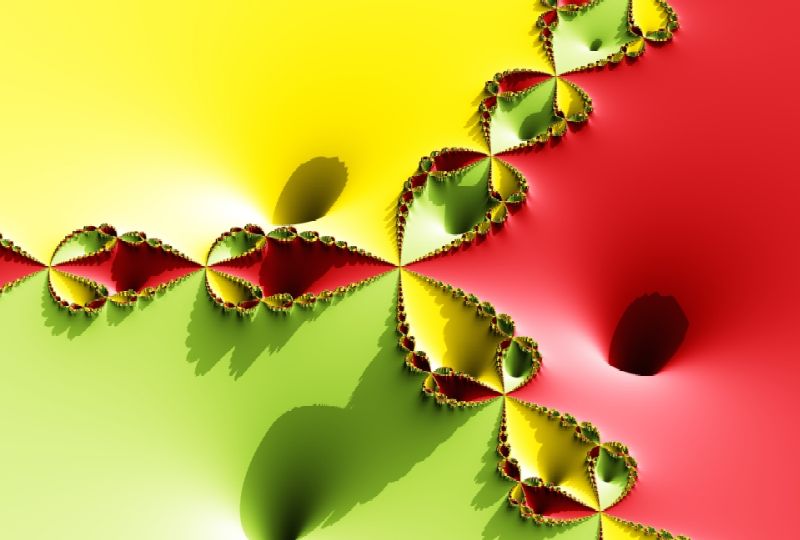
D'un point de vue plus général, toute "différence élémentaire" qui peut être reproduite et répétée peut se décliner en fractale, dans tous les domaines et c'est ce qui devrait nous en rendre méfiants.
Depuis quelques petites années les fractales sont de plus en plus à la mode, mises à toutes les sauces. C'est facile puisque toute contradiction, toute opposition, toute situation plus ou moins contrastée peut être utilisée comme motif de base. Ceci étant, l'observation de l'univers depuis les particules élémentaires jusqu'à ce que nous pouvons encore en voir au plus loin possible, en passant par cette biosphère qui nous héberge ainsi que par le monde virtuel des concepts, tout présente des structures répétées, récursives, fractales. Il est alors logique de retrouver ce phénomène en sociologie aussi.
Sous cet angle, l'examen des phénomènes sociologiques de petite échelle peut faire pressentir ceux à échelles trop grandes pour que nous puissions les percevoir à notre niveau mais ceci avec toute la méfiance disponible pour ne pas alimenter les théories du complot, les désinformations, les manipulations par "fractalisation" de spéculations grossières, sérieusement invérifiables mais comme ce "marché" existe, il est "exploité". Bref.
Je n'ai rien trouvé concernant l'analyse sociologique vue sous l'angle des fractales mais j'ai l'intuition que la récursivité s'applique aussi entre les structures sociales selon leurs tailles, leurs niveaux d'imbrication et leur histoire.
Tout ce qui précède étant somme toute assez éclectique, une petite pause s'impose, je propose.
On joue ?
On commence par le plus vieux et le plus con que je connaisse : le jeu de l'ultimatum.
C'est un jeu à deux : il y a un très très gros long lingot d'or pur sur la table que deux personnes doivent se partager. L'un des deux a la commande du massicot pour le couper en deux et l'autre regarde. Le premier doit dire à l'autre où il va couper et si l'autre refuse alors ni l'un, ni l'autre n'en auront la moindre poussière. Une seule proposition, c'est tout. Pas de "session de rattrapage".
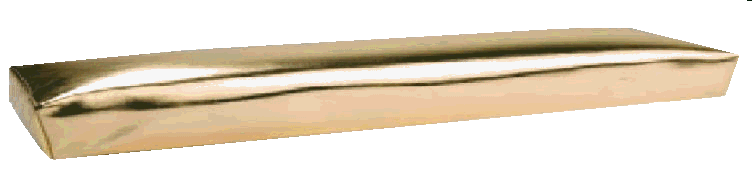
Alors ? Tu coupes où ? Je coupe où ?
Amusant, non ?
Qu'est-ce qu'un jeu ?
En général, c'est une mise en situation de compétition ou d'affrontement avec quelque chose à gagner, souvent réduit à la proclamation du résultat mais pas toujours. Donc, c'est par essence une miniaturisation de relations sociales. Par conséquent, les jeux ont des choses à nous apprendre sur beaucoup de comportements, humains ou pas.
Prenons, par exemple, le jeu "pierre-papier-ciseaux". La règle de ce jeu est que la pierre casse les ciseaux mais est enveloppée par la feuille qui est pourtant coupée par les ciseaux. Chaque joueur choisit un élément et le gagnant est celui qui l'emporte sur les autres au moment où tous l'annoncent. Jouer toujours la même chose est une mauvaise stratégie car l'autre ou les autres vont vite comprendre l'objet à préférer pour avoir l'avantage. Stratégiquement aussi, avoir une préférence pour l'un des objets amènera rapidement à un résultat analogue dès que ce sera compris. La stratégie que ce jeu impose si l'on veut ne pas trop perdre est de choisir le plus aléatoirement possible l'élément en respectant globalement une proportion 1/3 pierre, 1/3 ciseau, 1/3 papier. Cette "martingale", cet équilibre stratégique, est ce que les théoriciens du jeu nomment l'équilibre de Nash. Beaucoup de jeux y conduisent mais pas tous et il n'y en a pas forcément qu'un seul par jeu non plus.
Le jeu du mille-pattes est un jeu à deux, un peu plus subtil mais à peine : le joueur 1 a devant lui deux piles, l’une de 4 pièces de monnaie, l’autre de 1. Il a deux solutions : soit il prend la plus grosse pile, alors le joueur 2 reçoit l'autre et le jeu est fini, soit il passe, ne prend rien, et le montant de chaque pile est doublé : la première passe à 8 pièces, la seconde à 2. Le joueur 2 a alors le même choix : prendre la plus grosse pile ou ne rien prendre et laisser les montants doubler mais avec le risque que le joueur 1 prenne ensuite la grosse pile. Le nombre de tours maximal du jeu est fixé au départ et connu des joueurs et, si le jeu va jusqu'au bout, les joueurs se partagent le magot à 50/50. Notez qu'au dernier tour, la grande pile contient 66 % (2/3) du total possible et l'autre 33 % (1/3). Au tour précédent, l'avant-dernier, puisque ça double à chaque tour, elle n'en atteint que 33% et l'autre 16,5% (1/6). À quel moment est-il plus profitable de terminer le jeu ?
Réponse difficile puisque, au final, c'est la perception de la psychologie de l'autre joueur qui primera ...
Le dilemme du prisonnier est pas mal non plus :
Deux suspects sont arrêtés par la police mais les agents n'ont pas assez de preuves pour les inculper. Ils les interrogent séparément en leur faisant la même offre : "Si tu dénonces ton complice et qu'il ne te dénonce pas, tu seras remis en liberté et l'autre plonge pour 10 ans. Si tu le dénonces et lui aussi, vous écoperez tous les deux de 5 ans de prison. Si personne ne dénonce, vous en aurez tous deux pour 6 mois." Les prisonniers n'ont aucun contact entre eux, évidemment. Le raisonnement attendu de chacun est plus ou moins celui-ci : si l'autre me dénonce et que je me tais, j'en prends pour 10 ans mais si je le dénonce je n'en fais que 5. S'il ne me dénonce pas et que je le dénonce je suis libre tout de suite, sinon j'en prends pour 6 mois. Donc il y a tout intérêt à dénoncer dans tous les cas. Seulement, voilà, la réalité est toujours plus subtile que ça. Vous, vous feriez quoi, avec quelle prise de risque ?
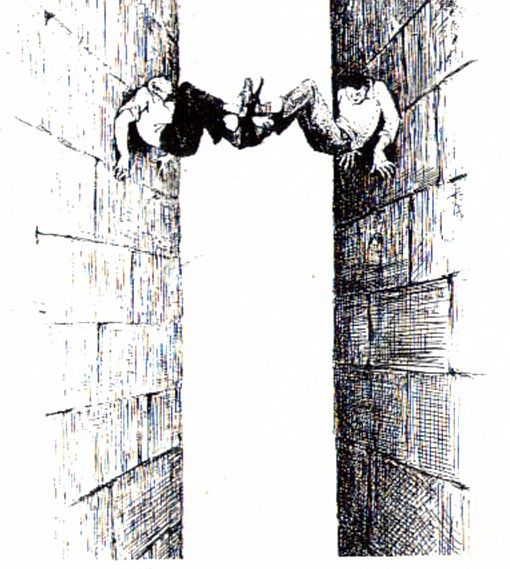
Et si l'histoire se répète ? Mettons qu'au lieu de dénonciation, ce soient deux personnes qui échangent des boîtes censés contenir respectivement de l'argent, un objet de valeur. Chacun a un intérêt immédiat à passer une boîte vide mais il est plus avantageux pour les deux que la transaction ait honnêtement lieu : quand ce jeu est répété, les joueurs adoptant une stratégie intéressée y perdent au final alors que ceux plus "désintéressés" voient leur "altruisme" récompensé : la confiance paye. C'est un peu comme pendant la guerre des tranchées où les combattants des deux camps, et contre l'avis de leurs commandements, appliquaient le principe du "vivre et laisser-vivre" : ils ne déclenchaient jamais les hostilités mais toute agression entraînait une réplique intense. Toujours la confiance.
Une petite glace pour la route, ensuite on reprend ?

Deux marchands de glace doivent choisir un emplacement sur une plage où les clients sont répartis uniformément. Ils vendent la même chose. La différence ne porte que sur l'emplacement : les biens ne sont distincts que du fait des coûts de transport, chaque client se dirige donc systématiquement vers le marchand le plus proche.
La question est double : d'une part déterminer la position d'équilibre, c'est-à-dire où les marchands vont se placer sur la plage pour maximiser leurs gains, d'autre part analyser cet équilibre du point de vue des marchands et des clients.
Ce "problème" est aussi un grand classique du genre parce qu'il s'applique à un grand nombre de domaines, économie en particulier mais aussi à bon nombre d'activités sociales : le problème des marchands de glace.
L'équilibre tombe très vite : la solution évidente au départ est celle où ils se mettent chacun au milieu d'une des deux moitiés de la plage, mais le moindre écart par rapport au centre de cette moitié favorise l'autre. Sa réaction va donc être de se rapprocher un peu de l'autre "pour compenser" et au final, un peu comme si ces deux centres d'intérêt étaient soumis à la loi d'attraction des masses de Newton, la place d'équilibre pour chacun est celle où ils sont dos à dos au milieu de la plage.
En d'autres termes, quel que soit le marché, quelle que soit l'activité, les leaders du domaine ont tendance à se ressembler de plus en plus et à faire la même chose. C'est flagrant en politique comme en économie, ça l'est aussi dans les milieux culturels, associatifs, syndicaux, contestataires, etc.
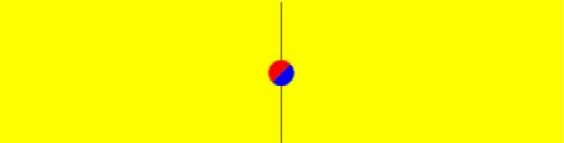
Ainsi, sur les réseaux sociaux on peut se poser la question de la signification réelle du nombre de balises (Twitter) ou de pages (FB) différentes traitant d'un même sujet, assumant la même fonction. La question, évidemment, ne se limite pas aux réseaux sociaux.
Les "jeux" qui précèdent sont des exemples-phares de ce qui s'est isolé en tant que domaine scientifique sous le nom de théorie des jeux et qui, en fin de compte, n'a plus grand chose à voir avec la notion de jeu de détente mais plus en rapport avec l'étude des conséquences des situations répétitives et, pour son volet "biologique", la théorie de l'évolution. Si les statistiques et les mathématiques s'y font une part du lion, c'est parce que ce qui est recouvert est très général, pratiquement universel : toute situation répétitive faisant transiter des gains, donc de l'énergie, est concernée par la théorie des jeux.
Biologiquement parlant, nous savons maintenant que les espèces présentes dans la biosphère aujourd'hui sont le résultat d'innombrables "parties" d'un jeu où les cartes sont les gènes et le gain la survie. Pour une espèce, l'ensemble des cartes, le génome, est son capital. Il est remis en jeu à chaque génération et la partie consiste à affronter la réalité c'est à dire, outre les facteurs physiques, les cartes des autres. La théorie des jeux, plus précisément sa notion de stratégie évolutivement stable (ESS), confirme et modélise que le processus maintenant la survie des gènes jusqu'à aujourd'hui est le même que celui assurant le maintien de comportements sociaux plus ou moins stéréotypés à travers les générations. La base de ce processus est le gain que la chose, comportement, gène ou autre, apporte à l'ensemble de l'espèce au cours de la "partie" infinie qui se joue : la survie et l'adaptation du génome.
Au niveau supra-individuel, par sommation simple des chances de survie le génome du groupe survit mieux que celui de l'individu, ce qui implique que l'altruisme est un facteur renforçant son maintien du moment que celui de l'altruiste est génétiquement proche de celui du groupe. C'est un des éléments mis en évidence par la sélection de groupe.
Ceci implique aussi que, dans les grandes populations, les comportements malveillants intraspécifiques sont naturellement sélectionnés : l'altruisme décroît progressivement de la famille immédiate au groupe (pour les animaux sociaux) jusqu'à devenir de l'agression systématique entre individus de groupes différents puis d'espèces différentes. C'est en tout cas ce que Price et Hamilton ont démontré au travers de la sélection de parentèle. Donc, au sein d'une même espèce et selon la taille de la population concernée, les comportements altruistes sont tout autant sélectionnés que les comportements dits malveillants, agressifs.
Ils sont tous les deux naturels, utiles à la conservation du génome et inévitables, même si cette évidence n'est pas encore reçue comme "politiquement correcte" aujourd'hui au point d'être niée jusqu'à la schizophrénie au nom d'une morale plus ou moins politico-religieuse dont la rigidité permet le maintien de dogmes en bloquant cette reconaissance alors qu'elle ne pourrait qu'apporter plus de stabilité aux sociétés, donc au génome (cf. l'optimum de Pareto à partir duquel et selon la taille de la population concernée, l'augmentation du bien-être de certains individus implique la réduction de celui d'au moins un autre).
Fin du préambule.
Cette science de 200 ans d'âge apparent est encore très jeune car nombreux ont été et sont encore les agents de sclérose intellectuelle en plaques genre Emile Durkeim qui, par instinct de conservation pour sa conception de "sa" sociologie naissante (donc fragile et mal individualisée) et parce que victime lui aussi du politiquement correct de son temps (temps nombriliste, c'est à dire créationniste, phallocrate, colonialiste et convaincu de sa supériorité sur le reste de l'univers), refusèrent et refusent encore dogmatiquement toute idée de lien ou de continuité historique entre les sociétés humaines et celles présentes ailleurs dans la biosphère et, ainsi, ces schizophrènes sont responsables de quasiment deux siècles de temps perdu dans la connaissance des fondements du social dans la biosphère à un moment où le temps est plus que compté (cette recherche, pourtant aussi naturelle que triviale, n'a pu réellement reprendre que dans les années 1990 et se heurte toujours au même déni).
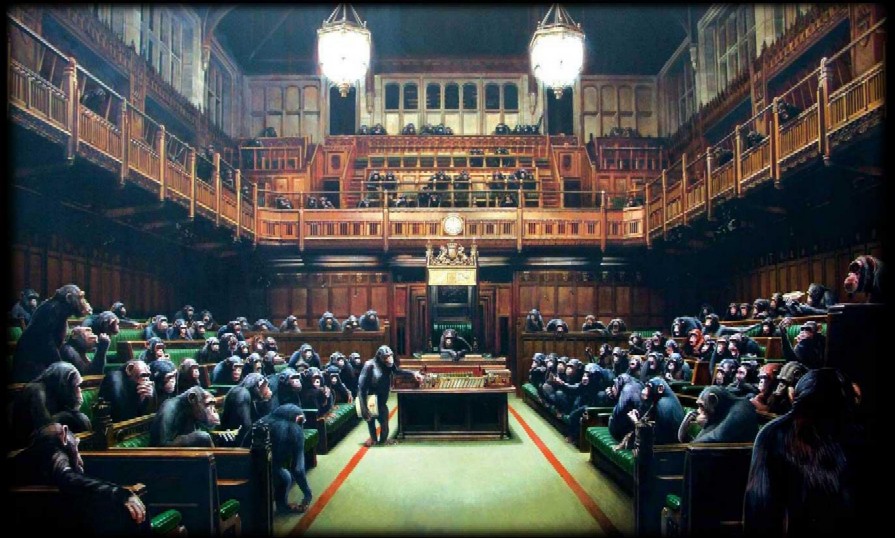
Pourtant dès cette époque cette piste logique et naturelle avait été débroussaillée par les premiers éclaireurs comme Alfred Espinas, victime lui aussi du même politiquement correct de cette époque mais qui publiait en 1878 dans son livre "Des Sociétés animales, étude de psychologie comparée" (Paris, G. Baillière, 1878, 2e éd., 588 pp. - En ligne ici) :
"... Pour nous qui n'avons pas moins souci que qui que ce soit de la noblesse et des destinées de notre race, si nous entendions quelqu'un après la lecture de notre étude dire semblablement : Eh quoi ! dans plusieurs sociétés animales les faibles sont protégés, les vieux sont même parfois secourus, les membres d'une même peuplade et d'une même famille sont prêts à se sacrifier les uns pour les autres sans la plus légère espérance d'une compensation ; et il se peut que certains hommes en soient encore à se demander si ce sont là des vertus ! nous ne pourrions qu'applaudir à un tel langage. Relever les sociétés animales, c'est relever du même coup la société humaine qui les surpasse de si loin et les domine de si haut. Nous croyons servir plus efficacement la cause de la civilisation en montrant que l'humanité est le dernier terme d'un progrès antérieur et que son point de départ est un sommet qu'en l'isolant dans le monde et en la faisant régner sur une nature vide d'intelligence et de sentiment."
L'intuition que la structure et les mécanismes sociaux de l'espèce humaine sont l'aboutissement d'une évolution s'étalant sur une durée dépassant largement toute l'histoire et la préhistoire humaines, donc sur plusieurs espèces, s'était naturellement imposée dès le début de la science formalisée mais le lourd atavisme ancestral du complexe de supériorité de la civilisation occidentale où cette formalisation est née s'est abattu de toute sa bigoterie en une chape de plomb qui étouffe encore pas mal aujourd'hui toute allusion officielle à cette évidence. Donc, pendant ces deux siècles, la biologie sociale a été forcée d'évoluer en deux fronts parallèles trop indépendants : la sociologie et l'éthologie.
Aujourd'hui encore, et même si de plus en plus battu en brèche, le dogme nombriliste qui prétend une séparation entre l'humain et le reste de la nature ou de l'univers est toujours très puissant bien qu'il soit aussi faux et absurde que ridicule. Le déni de réalité et le solipsisme sont deux moteurs ancestraux de la pensée et de l'action humaine.
Comme j'en connais autant en sociologie qu'en théologie, c'est à dire à peu près rien, je garde mon intuition un peu à l'abri de ces influences néfastes ainsi que la liberté de la développer avec des erreurs, certes, mais qui devrait être compréhensibles et facilement corrigeables par des "initiés" et qui ne devraient pas trop gêner l'expression de sa part de vérité.
Dualité mort - vie
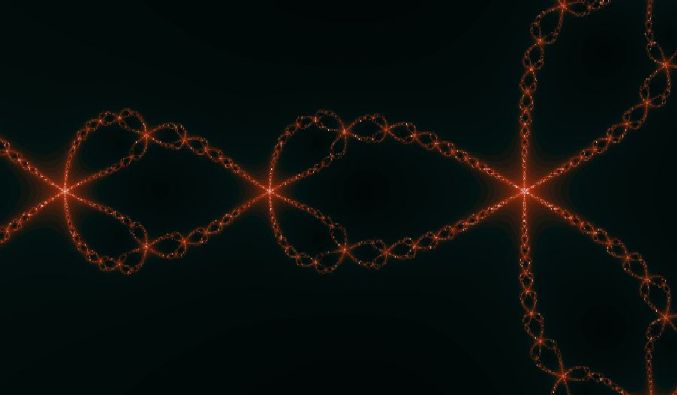
La vie est sortie d'une soupe cosmique, d'un bouillon de molécules synthétisées à partir des gaz de l'atmosphère primitive de la Terre (ammoniaque, gaz carbonique, vapeur d'eau) qui se sont coagulées d'une façon de plus en plus ordonnée au cours des millénaires épurant la-dite atmosphère jusqu'à en faire celle que nous connaissions avant d'avoir commencé à la dénaturer il y a moins de 200 ans. Cet ordonnancement croissant des atomes va dans l'exact sens inverse de la tendance générale de l'Univers qui pousse à la dilution et à l'expansion.
Ces molécules "de condensation" se sont amassées au sol et en mer puis, par la pluie, les vents et les courants marins, elles ont alors été rassemblées sur les rivages des continents où les vagues les ont continuellement brassées. Comme elles étaient de petite taille (et de toutes les sortes possibles), elles sont restées piégées là, s'y sont accumulées tant que l'atmosphère a pu en synthétiser et les éléments climatiques et physiques les y transporter.
On distingue trois types de molécules en fonction de leurs propriétés : les lipides, molécules grasses n'aimant pas l'eau, les glucides, molécules "sucrées" diluables, et les protides, molécules non sucrées plus ou moins diluables. Dans chacun de ces types on distingue encore entre celles qui sont acides (p.ex. acide formique), neutres (sel de cuisine, esters) ou basiques (ammoniac, soude).
Côté éléments atomiques, les 4 majoritaires étaient ceux qui l'étaient déjà dans l'atmosphère primitive : Carbone (C), Hydrogène (H), Oxygène (O) et Azote (N, parce qu'originellement appelé "Nitrogène"), résumés par l'acronyme C-H-O-N. C'est, dans l'univers, une des "fenêtres de vie" connues (= ensemble d'atomes permettant leur structuration en molécules complexes). Bien sûr, tous les autres éléments atomiques disponibles sont aussi présents dans cette soupe mais dans des proportions bien plus faibles même s'ils s'avèreront ensuite d'importance primordiale pour le processus du vivant (Fer, Cuivre, Soufre, Phosphore, Magnésium, Potassium, Sodium, etc..)
Vous remarquerez que, dès cette époque, on assiste à une sorte de "fractalisation" chimique, c'est à dire, à travers la polymérisation de ces composants simples, à une déclinaison pratiquement infinie de répétitions plus ou moins à l'identique de ces "motifs de base" et ce d'une façon extrêmement récursive.
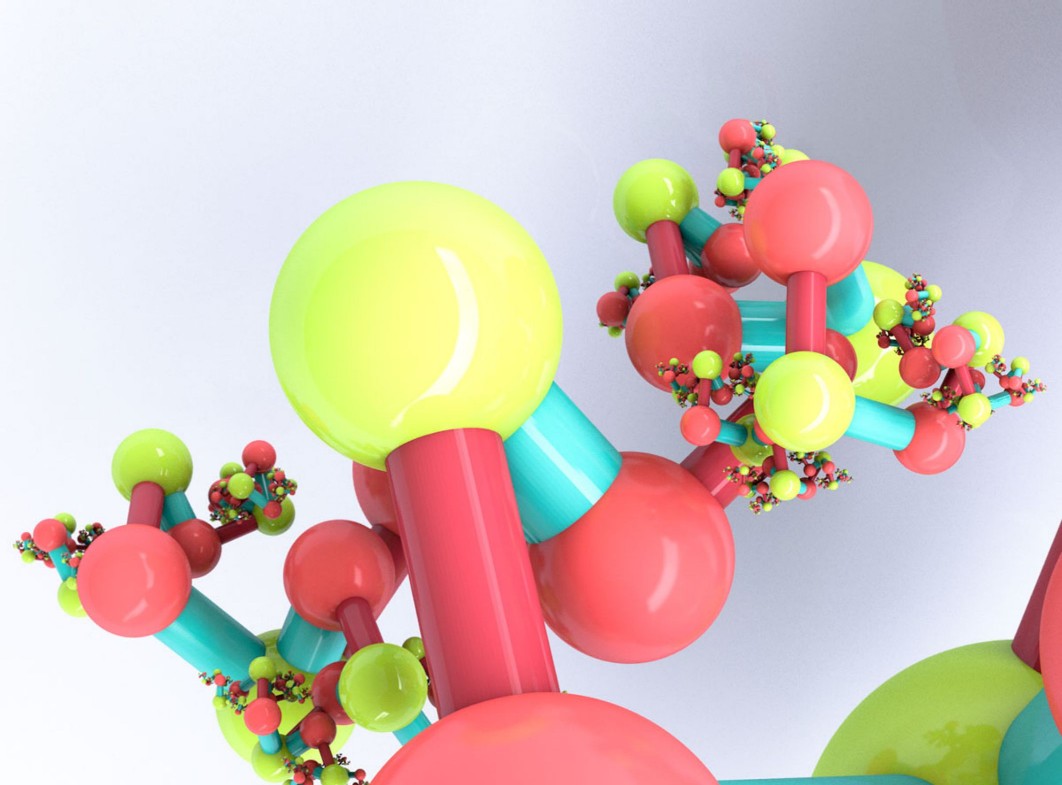
S'il n'y avait eu ni vagues, ni courants, ni pluies, il est probable que les rivages de nos continents seraient encore aujourd'hui bordés de couches superposées de protides, glucides, et lipides, en couches étagées en fonction de leur facilité à se mélanger à l'eau et de leur densité : ces deux propriétés (poids et miscibilité à l'eau) des molécules issues de la condensation de l'atmosphère initiale auraient été suffisantes pour maintenir cet équilibre ainsi pour l'éternité.
Le brassage continu par les vagues et le bombardement intense des rayonnements solaires de l'époque (il n'y avait pas de couche d'ozone comme aujourd'hui) ont maintenu cet ensemble en une sorte de mayonnaise en perpétuel mouvement où toutes les molécules étaient immanquablement coagulées, cassées, divisées, ré-assemblées, polymérisées, atomisées, réorganisées en permanence.
Tout ce fatras moléculaire était donc brassé en permanence et la mayonnaise originelle en était, d'une certaine façon, relativement homogène mais chaque molécule imposait les contraintes de ses propriétés à son environnement immédiat. Ainsi, les plus grasses avaient tendance à se regrouper séparément des moins grasses.
De plus, les événements extrêmes comme la foudre, le gel, les coulées de lave côtières, la sécheresse, ont ajouté des possibilités exceptionnelles aux recombinaisons possibles. Cette rareté a été essentielle à la création de molécules complexes et relativement stables (ADN) qui n'auraient sans doute pu apparaître autrement après que suffisamment d'ozone ait été généré pour faire assez écran aux rayons solaires les plus destructeurs (rayons ultra-violets, X et gamma).
La polymérisation des atomes a généré des molécules mixtes : le carbone propose fondamentalement 4 possibilités de lien à d'autres atomes, on dit qu'il a une valence de 4. L'hydrogène en propose une seule, l'oxygène deux et l'azote 3. On le résume avec ces quatre molécules de base qui sont aussi les 4 gaz principaux de l'atmosphère originelle : CH4 (méthane), H² (hydrogène), H²O (eau) et NH³ (ammoniac).
Donc, en deux mots et en gros, on voit qu'il est possible de tous les lier entre eux un peu comme des perles ou des briques de jeu de construction à partir du moment où on imagine un motif (un radical) laissant plus d'une possibilité d'accrochage, l'hydrogène servant de "bouchon" pour les éventuels liens surnuméraires, soit : CH³-, -CH²-, -CO-, -NH ou -OH.
Donc, une molécule genre CH³-CH²-CH²-CH²-CH²-CH³ existe (c'est l'hexane) et le motif -CH²- peut virtuellement être répété à l'infini, y compris en y insérant de temps à autre un des autres motifs disponibles. Il s'agit ici des lipides. Il est, en outre, possible de faire des "colliers", c'est à dire des "chaînes circulaires" (sur notre exemple ici, en enlevant les deux "bouchons" des extrémités (les passer de -CH³ à -CH²-) et en reliant la première à la dernière. On obtient alors le benzène, molécule circulaire).
C'est, finalement, une sorte de jeu de Légo tout simple mais avec des "règles complémentaires" un peu plus complexes qu'on a regroupées sous le vocable de "Chimie organique", une science.
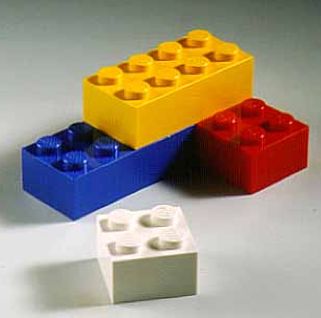
Le caractère "gras" ou "non gras" d'une molécule est essentiellement porté par le radical oxygéné ou d'une de ses variantes : l'hydrogène n'a qu'un seul électron, l'oxygène en a 16 et chaque électron a la même charge électrique, négative par convention, quel qu'en soit le nombre. Si un carbone est lié à un oxygène, alors, par rapport aux carbones liés uniquement à de l'hydrogène, c'est plus gros et électriquement plus polarisé. 16/1, une sacrée différence qui explique cette polarisation : bien qu'ayant tous les deux 2 possibilités d'accrochage à autre chose, un carbone avec deux hydrogènes (-CH²-) est huit fois moins chargé qu'un carbone avec un seul oxygène (-CO-).
L'appétence pour l'eau s'explique de la même façon : l'eau, H²O, est un gros atome d'oxygène qui se lie à deux petits atomes d'hydrogène, un gros et deux petits (séparés spatialement à 120° l'un de l'autre). Donc, globalement, on a un "côté" plus négativement chargé que l'autre, une sorte de "couple atomique" façon Laurel et Hardy ou Astérix et Obélix, un genre de petit aimant magnétique qui va être attiré par ce qui lui est symétrique, donc par tout motif, radical, molécule, qui peut présenter un déséquilibre de charge :
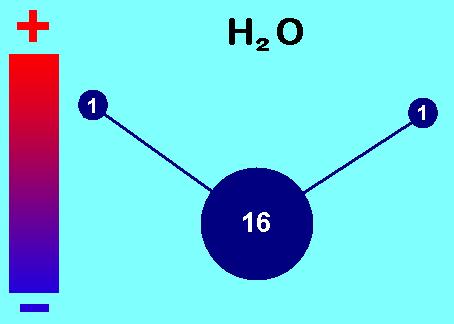
Or, le radical -CH²- est bien plus équilibré (donc neutre) que le radical -CO- (plus hydrophile, lui), ou le radical -NH (idem), etc. : le radical -CH²- est le plus hydrophobe de tous à cause de sa neutralité électronique. Donc toute polymérisation de ce radical est encore plus hydrophobe, sur toute sa longueur. Donc toute chaine de -CH²- est "grasse" et y remplacer le bouchon -CH³ terminal, ou tout autre chainon, par quelque chose de plus hydrophile crée quelque chose de mixte, de bipolaire, quelque chose qui va s'ordonner dans l'espace : tout ce qui est hydrofuge va avoir tendance à repousser ce qui ne l'est pas et inversement.
Donc les molécules identiques vont se ranger dans le même sens, dans la même direction : les parties hydrophiles ensemble, d'un même côté, et les hydrophobes de l'autre. Glucides, lipides et protides suivent tous globalement ce même schéma d'arrangements possibles qui n'est, somme toute, qu'une déclinaison particulière du problème des marchands de glace.
Ainsi, si je représente un -CH²- hydrophobe par une barre et les radicaux hydrophiles par un rond, alors une molécule genre CH³-CH²-CH²-CH²-CH²-CO-OH se représente "/\/\-0". Comme seul le rond est hydrophile, ce qui précède est évident : les zigzags se collent les uns contre les autres et les ronds font de même. Si un seul ose se mettre dans un autre sens, les forces électriques le remettent aussitôt dans celui le moins dérangeant pour l'ensemble, le rond avec les ronds, le zigzag avec les zigzags.
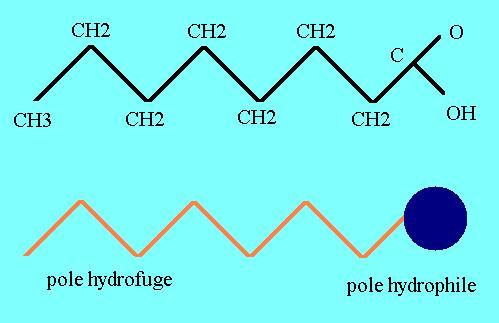
Encore plus fort : si leur nombre est tel qu'il n'est plus possible de les garder en une seule couche alors une nouvelle couche va se superposer symétriquement à l'autre, mettant tous les zigzags ensemble et tous les ronds ensemble. On obtient une sorte de sandwich hydrophiles1/hydrofuges1-hydrofuges2/hydrophiles2. Si c'est sur 3 couches, on aura 3 couches de ronds et 2 de zigzags ou l'inverse ; si c'est 4, ça revient à superposer le cas des 2 couches, etc. Si l'agitation (via les vagues) déstructure ce résultat alors on va obtenir des sphères, mono, bi, tri, quadri-couches, etc., et c'est ici que ça devient intéressant :
Imaginez, dans un monde majoritairement humide, le cas de deux couches avec les ronds "vers l'extérieur" (forcément puisque l'extérieur est aqueux) qui est brisée par une vague, émulsifiée en sphérules. On peut très bien voir ainsi des sphères "creuses" qui emprisonnent une gouttelette de l'extérieur en leur centre et isolée "du dehors" : la couche de ronds externes, puis celle de zigzags en barrière et enfin les ronds internes qui la maintiennent dedans.
En gros, on a quelque chose qui a "le goût et l'odeur" d'une proto-cellule : un milieu intérieur et un milieu extérieur... Bon, comme ça c'est encore trop mort pour être stable bien longtemps mais la route est ouverte, surtout quand on dispose de milliards d'années pour essayer l'ensemble des possibles sur ce schéma naturellement vraiment très abondant dans un milieu extrêmement agité et variable puisqu'il y a beaucoup d'autres molécules très différentes autour. On va donc avoir des milliards d'arrangements possibles et une sélection naturelle ayant tendance à conserver le plus stable de tout ça.
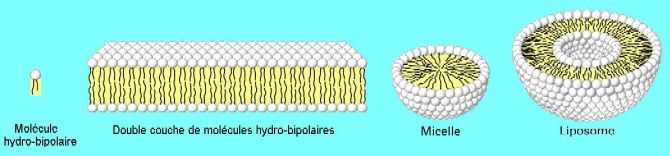
La complexité de l'ensemble permet aussi de monter des structures telles que certaines de ces sphérules "creuses" en englobent d'autres plus petites et n'ayant pas forcément exactement le même "milieu intérieur", des sphérules de sphérules, une sorte de pas suivant de "la fractale" : les coacervats. De plus, ces arrangements gigognes préfigurent ce que seront les organites intracellulaires, les vacuoles digestives, le noyau, les organites, les symbioses, etc., une autre branche de la fractale à laquelle la vie appartient.
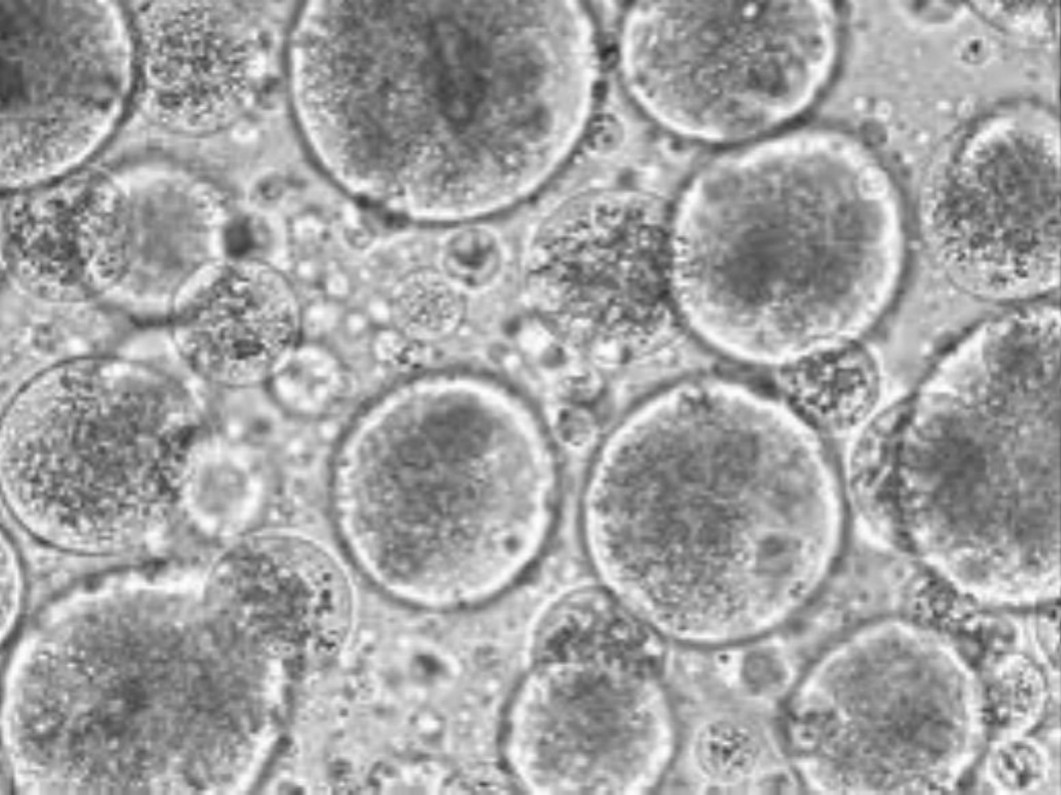
Coacervats : notez comment certains en contiennent d'autres.
L'étape suivante est encore mal connue puisque c'est celle qui explique comment un "machin comme ça" se transforme assez efficacement pour pouvoir grossir de façon stable et cohérente en interne, forcément jusqu'à en éclater au bout d'un moment mais de façon à pouvoir ensuite se recomposer à l'identique dans chacun des morceaux. La première façon victorieuse a sans doute été "d'éclater" délibérément à un moment choisi permettant de reconstituer dans chacune des sous-parties les éléments utiles restés dans les autres, donc l'invention de la scissiparité (division simple). Le premier coacervat qui a réussi ce coup-là a forcément pris le dessus sur tous les autres.
Pour ce faire, il a forcément fallu inventer un "dictionnaire des choses utiles". On peut supposer que les premiers brins d'ADN flottaient librement dans le milieu intérieur de ces coacervats-là, qu'ils n'avaient pas tous le même rôle, bien sûr, et que, vu leur fragilité imposée par leur complexité structurelle, ils ne se maintenaient que dans les coacervats capables de les protéger au mieux des agressions destructrices (UVs, etc.) La pression de sélection a amené les coacervats à trouver comment les garder en sécurité à l'intérieur de leurs sphérules, à inventer le "machin à protéger avant tout", la mémoire des méthodes de fabrication de ses propres constituants en regroupant "au chaud" les bouts de proto-chromosomes flottant "au hasard" dans leur milieu intérieur à même enseigne que tout le reste, donc à créer autour du proto-génome tous les mécanismes associés à son maintien en interne, sa réplication incluse puisque aucune des sous-parties issues d'une division ne pouvait, évidemment, survivre sans réplication complète du "dictionnaire". C'était, en somme, l'invention du noyau cellulaire, des mécanismes de réparation de l'ADN et de sa réplication.
Puis, étape supérieure, comment apparut par dessus cette gestion du dictionnaire l'invention d'une voie proto-sexuée, c'est à dire comment a pu se mettre en place entre proto-cellules assez voisines, un brassage de ce capital proto-génomique assez équilibré pour ne pas en mourir aussitôt. Il est fort possible que des symbioses sont apparues dès ces moments-là : rien n'interdisait vraiment qu'une lignée de coacervats "évolués" et spécialement productifs en quelque chose d'utile aux autres lignées de coacervats du moment ait été incorporée dans des lignées autres mais capables de lui offrir "le gîte et le couvert" en un échange bénéfique aux deux. Ceci après autant d'essais aussi différents que possible, autant de variations qu'on en observe aujourd'hui dans le continuum comportemental recouvrant tout : du parasitisme à la symbiose en passant par la prédation, l'ammensalisme, le commensalisme, etc. : l'ADN efficace leur était une ressource à capitaliser et s'il y avait moyen d'incorporer avec lui le savoir-faire de son maintien, c'était autant de temps et d'énergie économisés pour la survie des deux lignées.
Tout semble indiquer que l'invention puis la généralisation de micro-organites tels que les chloroplastes (captage et transformation de l'énergie solaire), l'hémoglobine (transport de l'oxygène et du gaz carbonique) et les mitochondries (stockage et libération de l'énergie) aient atteint un succès total à partir de symbioses réussies et que, de toute façon, l'univers des possibles ne laissait que très peu de solutions viables : les bactéries libres les plus proches des mitochondries sont les rickettsies, la chlorophylle et l'hémoglobine ont des structures moléculaires très voisines entre elles (hème), dans l'hémoglobine de certains animaux l'atome chélaté est le cuivre et dans d'autres, cas général, c'est le fer, autant de signes tendant à le démontrer...

On remarque ici que ce sont des principes similaires qui ont présidé à la constitution des coacervats à partir des molécules élémentaires issues de la condensation de l'atmosphère originelle (i.e. radicaux chimiques + leurs propriétés) d'une part et d'autre part à la complexification des coacervats parfaitement morts en cellules parfaitement vivantes (i.e. molécules puis organites de base à fonction totalement définie + mécanismes de leurs réplication). C'est typiquement une fractale de complexité croissante (neguentropie).
Il me semble aussi clair qu'évident que les milliards d'années ayant été nécessaires pour passer du coacervat parfaitement mort aux cellules parfaitement vivantes sont grandement expliquées par la loi des 80/20 et celle des 90-9-1, le cas des hèmes de chlorophylle et d'hémoglobine me semblant parfaitement contenus dans celle des 90-9-1 (1% de ces "découvertes" ont été intégrées par 100% du vivant).
De plus, la stabilisation des proto-cellules s'est certainement opérée selon le principe d'eutrophisation : la pérennisation-stabilisation des mécanismes les plus complexes a nécessairement été extrêmement énergivore, sa réalisation ne pouvait pas se faire sans une extrême abondance de ressources sous forme d'éléments de complexité juste inférieure et capables de soutenir des milliards de tentatives de stabilisation dans tout le spectre des relations du continuum comportemental entre le parasitisme, la symbiose, la prédation, ... en butant contre le dilemme du prisonnier répété, l'optimum de Pareto dans la marche vers l'eutrophisation et autres équilibres de Nash pour stabiliser les stratégies de survie, plus celui des marchands de glace pour rassembler et homogénéiser les solutions efficaces trouvées, etc.
C'est au résultat particulier et sans doute inéluctable de cette complexification+stabilisation que nous devons aujourd'hui l'existence de la séparation entre végétaux et animaux, de celle entre proies, parasites, prédateurs, commensaux, etc. : des milliards d'années d'essais et d'échecs, de presque réussites, de réussites avant d'en arriver à une biosphère enfin vivante, proto-bactérienne, très diversifiée, à peu près stabilisée dans la vie et en route pour l'étape suivante.
Le moteur fondamental de cette complexification-là me semble bien être une fractale sur un formé par la contradiction entre uniformisation (principe d'eutrophisation) et diversification des stratégies assez efficaces pour permettre la survie de tout ensemble de base (coacervats puis cellules autonomes) à partir des éléments du niveau juste précédent (molécules, agencements de molécules et organites).
Dualité liberté - sécurité
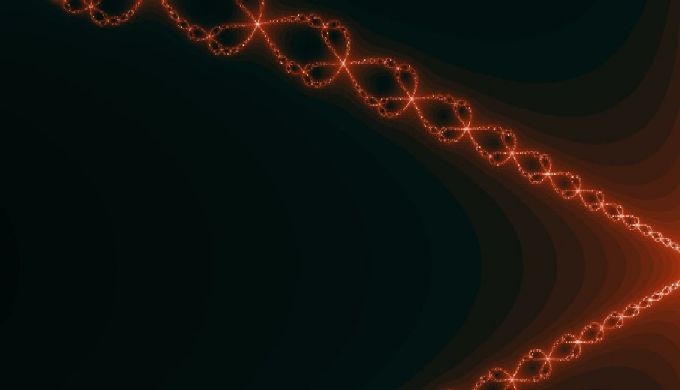
A ce stade, on imagine sans peine que la gigantesque marée "noire" de coacervats qui ceinturait tous les continents a été dévorée par les premières espèces d'organismes unicellulaires qui en étaient issues. Pour ces premières cellules libres, le monde était un paradis infini à dévorer sans contrainte puisqu'il n'y avait encore rien pour les contrarier, ni parasites, ni prédateurs, ni maladies. Cependant, comme nous l'avons vu, la transformation rapide de la mayonnaise de coacervats en mayonnaise d'organismes unicellulaires, toujours en suivant le principe d'eutrophisation et les lois du préambule, a rapidement évolué aussi et cette situation paradisiaque a donné naissance à de nouveaux systèmes permettant de réduire les biomasses homogènes et gigantesques de toute espèce arrivant à s'imposer sur la grande majorité des ressources. Les eutrophisations successives entre les premiers organismes unicellulaires ont été le lit de nouveaux comportements prédateurs, parasites, symbiotes, etc., comme ils l'avaient été entre les coacervats et avant encore, entre les molécules (même si le mot "comportement" ne peut pas être considéré ici sous son sens premier).
Dans un monde unicellulaire formé de biocénoses aux interrelations aussi complexes que les actuelles et où toutes les stratégies de survie possibles sont explorées, exploitées, utilisées, les plus efficaces et les plus chanceuses prennent forcément le dessus, les autres, moins efficaces et/ou moins chanceuses, sont progressivement éliminées ou repoussées dans les coins les plus isolés de la biosphère leur offrant encore la possibilité de survivre et d'évoluer en toute indépendance des contraintes biologiques (prédateurs, parasites, concurrents, etc.) qui les éliminent partout ailleurs mais en restant à l'écart des flux d'énergie principaux. Le monde des unicellulaires était suffisamment vaste pour autoriser assez facilement ces isolations, ces évolutions parallèles, pendant un temps au moins. Au centre, par contre, ces contraintes devenaient toujours plus fortes et complexes au fur et à mesure que les eutrophisations successives faisaient apparaître de nouvelles stratégies efficaces pour les minorités, de nouvelles espèces aux comportements plus adaptés à cette complexité globale croissante. La croissance génère de la complexité et la complexité génère de la croissance. C'est une contradiction en cercle vicieux qui s'applique toujours aujourd'hui, génératrice de diversité et d'efficacité dans le recyclage de toute forme d'énergie qui devient assez abondante pour le permettre. C'est le moteur créateur de néguentropie.
La polymérisation d'atomes ou de molécules est un phénomène qui réduit le degré de liberté, de mouvement, de chacun des constituants de base en les portant dans un état beaucoup plus stable que l'antérieur tout en démultipliant les effets de leurs propriétés de base au point d'en générer de nouvelles. Pensez à la série minérale du carbone : gaz carbonique, suie, charbon, diamant. Il en est de même pour les cellules qui peuvent être regardées à travers la série "cellules isolées, rassemblées, unies en foule, en colonie, en thalle, en tissu, en organe, en organisme supérieur individualisé". La grande invention issue de cette "polymérisation"-ci est la spécialisation des cellules, un phénomène déjà amorcé chez les unicellulaires de part leur mode de vie (champignons, végétaux, animaux tous diversifiés dans le continuum comportemental des parasites, prédateurs, commensaux, symbiotes, etc.) et leur adaptation plus ou moins étroite à des milieux différents.
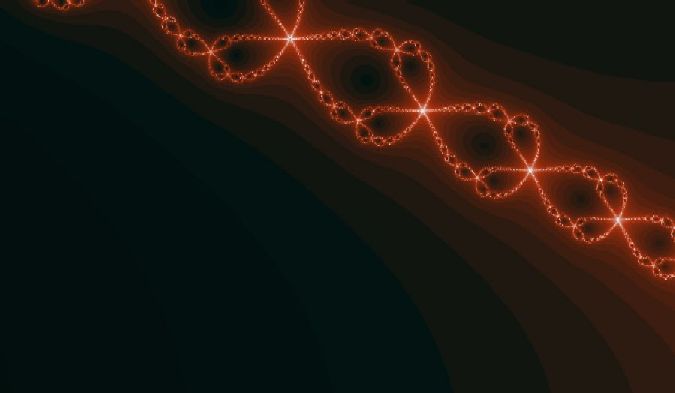
De la même manière que la polymérisation ou la cristallisation des radicaux en molécules ou cristaux renforce et généralise les propriétés de chaque radical, il était logique qu'à un moment donné cette polymérisation trouve comment s'appliquer aux organismes unicellulaires. Les contraintes de ce niveau sont bien sûr incomparablement plus complexes que celles imposées aux radicaux chimiques mais la stratégie reste valide et, rançon de cette complexité nouvelle sur les éléments de base, le temps nécessaire à la mise en place des stratégies efficaces est plus long, plus hésitant, les résultats en sont aussi plus fragiles une fois établis. La stabilité des stratégies les plus efficaces tient toujours aujourd'hui. Ce sont même elles qui caractérisent la majorité des espèces unicellulaires actuelles : les premières colonies d'êtres vivants étaient certainement filamenteuses, résultat de scissiparités non menées à terme tout en restant parfaitement viables (un seul "dictionnaire" partagé et totalement ou partiellement répliqué maintenant l'ensemble). Aujourd'hui, si les unicellulaires libres existent toujours, le filament reste la forme principale des organismes unicellulaires coloniaux ainsi que celle des multicellulaires les plus rudimentaires (champignons, bactéries).
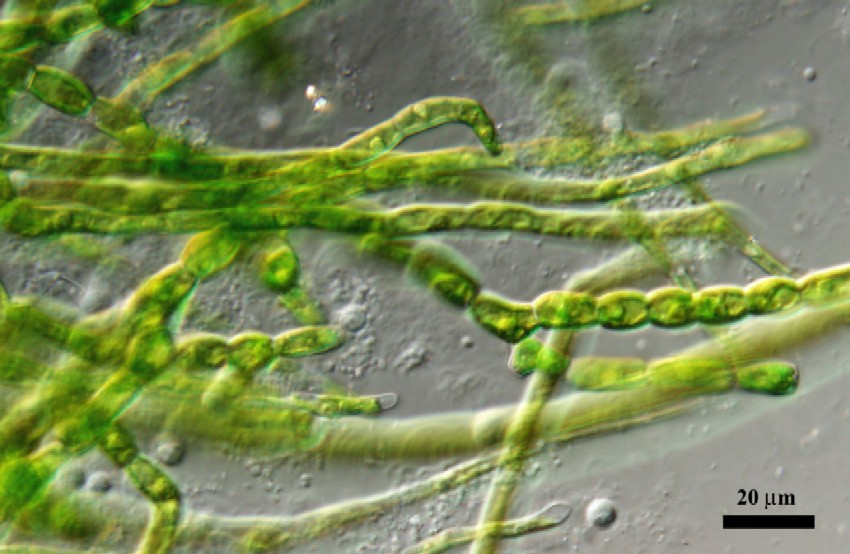
Filaments d'algue chlorophycée.
Même lorsque la forme globale de la colonie d'unicellulaires n'est plus filamenteuse, les liens entre les individus le reste encore :

Colonie de Volvox dorés (Volvox aureus)
Une fois la liberté individuelle abandonnée par les cellules, les possibilités offertes aux pluricellulaires se sont progressivement complexifiées. Si les premiers tissus étaient essentiellement des amas de cellules fonctionnellement et morphologiquement identiques dont les interrelations passaient essentiellement par le contact direct entre cellules voisines (thallophytes végétaux : algues ; "thalles" animaux : éponges et ascidies), cette proximité a mis en avant plusieurs nouvelles complexifications avantageuses à toute la communauté, à commencer par l'amélioration de la communication d'un bout à l'autre (les systèmes vasculaire et nerveux). Une fois unies et coordonnées, les cellules peuvent se spécialiser en tissus divers tant qu'elles restent complémentaires de façon à ce que les fonctions autres que celle à laquelle ou celles auxquelles se dédient celles d'un tissu sont nécessairement assumées par d'autres populations cellulaires de la même communauté se spécialisant, elles aussi en tissus sur autre chose et, complémentarité obligatoire, profitant également de la production des premières.

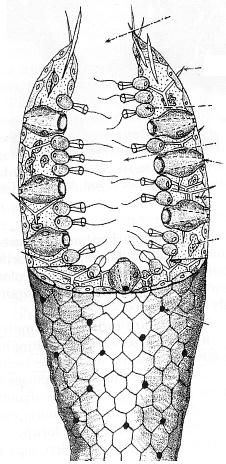
Les spongiaires : éponge languette
La rationalisation et l'optimisation des échanges intercellulaires sur les besoins de la communauté donnent plus de sécurité à l'ensemble. Le travail de chaque cellule s'y définit et y est encadré dans ce but. La sécurité de l'ensemble est une chose totalement impossible sans union et coordination. Elle est uniquement réservée aux communautés stabilisées où l'échange d'informations est assez réciproque et assez rapide pour que ces besoins soient toujours assurés du mieux possible en tout point de la communauté de façon à ce que chaque cellule y reste en vie sans manquer gravement de quoi que ce soit.
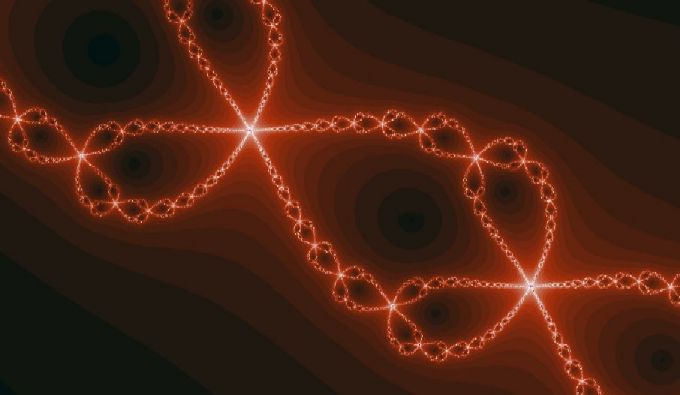
Pour les cellules, la liberté est le prix à payer en échange de la sécurité de la communauté. Plus cette liberté est réduite, plus la communauté doit développer de mécanismes fiabilisant les échanges et combattant les désordres au sein de tout tissu dès que ce désordre entrave ou fait mine d'entraver la bonne marche de l'ensemble. En conséquence, l'équilibre des échanges de l'ensemble des tissus différents est primordial au maintien en vie de toute la communauté. Ceci pousse donc aussi à la création de "tissus de coordination et de défense", c'est à dire à la création d'une réplique des mécanismes de cohésion du niveau de complexité inférieur dans le niveau de complexité supérieur, tout comme les coacervats avaient inventé le noyau cellulaire. Évidemment, le nombre de solutions possibles pour assurer ces fonctions est pratiquement infini et, comme au niveau précédent, l'adaptation aux contraintes de la réalité va favoriser les plus efficaces. Nous avons ici encore une récursivité des principes déclinés dans le niveau précédent mais avec des éléments différents, soit, ici encore, un comportement typique de fractale.
On remarque également que la cohésion des tissus se répartit entre la communication centralisée des systèmes nerveux, sanguins et hormonaux et celle des échanges intercellulaires de voisinage plus ou moins immédiat.
Dualité stabilité - souplesse
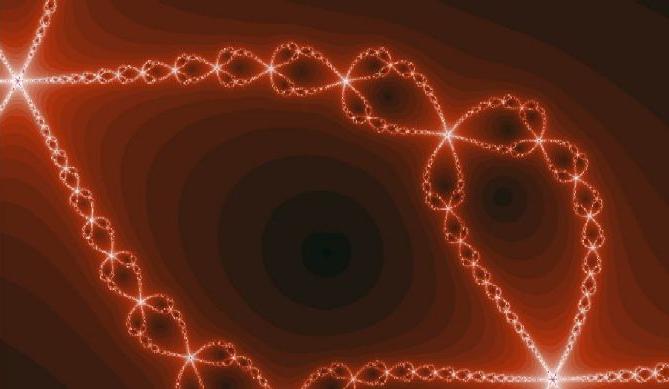
NB : Je vais ici m'appuyer sans les redéfinir ni les ré-expliquer sur les notions développées dans le chapitre précédent, il est donc très conseillé de l'avoir en tête dans ce qui suit ou de le relire maintenant.
La biosphère, tout en gardant à ses marges de nombreux éléments des niveaux inférieurs autonomes et de plus en plus spécialisés sur les flux d'énergies plus marginaux que la moyenne, (cf. la Loi normale précédemment présentée), s'est ainsi retrouvée essentiellement constituée d'organismes pluricellulaires, bien plus adaptés et adaptables à l'exploitation et à la capitalisation des énergies du milieu, quelles qu'en soient les formes. Pour ainsi dire, l'élément de base n'était plus là ni le radical chimique, ni l'organite cellulaire, ni même la cellule constituée mais l'organisme pluricellulaire.
La route était alors ouverte en grand à une autre déclinaison du continuum comportemental en offrant encore plus de possibilités de diversification que les niveaux précédents. La règle de la recherche de l'eutrophisation restant également le moteur principal de l'expansion de chaque lignée, la sélection continuait de favoriser ceux qui se montraient les mieux capables de drainer à eux le plus d'énergie possible sous toutes ses formes. Le principal facteur externe à cette compétition générale pour l'énergie, le soleil donc le climat, a servi, sert et servira longtemps encore de cadre général à cette complexification.
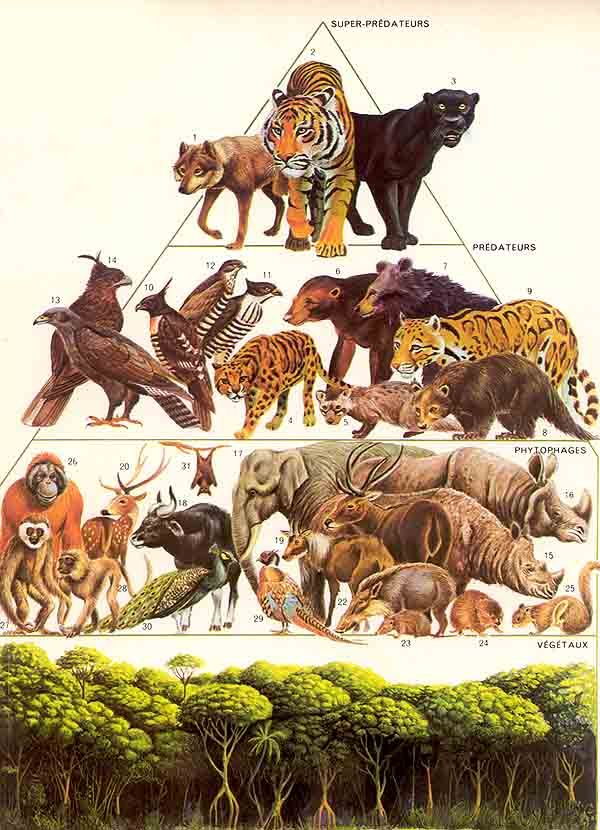
Ainsi, deux stratégies opposées sont devenues dominantes : d'une part la spécialisation amorcée par l'individualisation des règnes végétal et animal s'est énormément complexifiée, elle aussi en fractale, d'autre part l'adaptabilité, la souplesse, a donné lieu à des déclinaisons aussi importantes, en fractale également : dans ce jeu-là, celui de la survie, ces deux équilibres de Nash (spécialisation contre ubiquisme) se montrent tout aussi efficaces pour garantir la stabilisation de la situation des "joueurs" et comme il s'agit d'une contradiction, l'effet fractal en est aussi naturel que prévisible : les spécialistes exploitent mieux leur ressource que les généralistes, ce qui leur confère un avantage sur eux, alors que les généralistes exploitent plus de ressources que les premiers, ce qui leur confère symétriquement un avantage sur eux. Comme il s'agit de deux attitudes très générales, la fractale qui en découle peut prendre un nombre faramineux d'aspects différents.
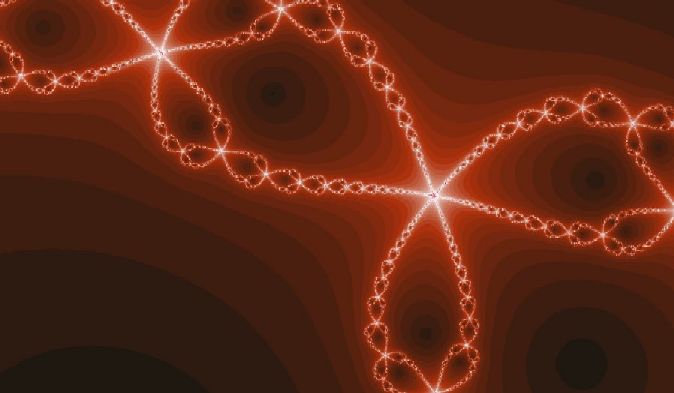
De plus, la protection assurée aux cellules par l'individualisation en organismes pluricellulaires permettait enfin à la biosphère de se lancer à la conquête de tous ces espaces encore à peu près vierges et situés au-delà des rivages, tant sur la terre ferme qu'en plein océan.
Une conséquence de ce phénomène est que le continuum comportemental (des interrelations entre individus et espèces différentes) définit des écosystèmes qui sont d'autant plus individualisés que les conditions physiques imposées par leur biotope sont tranchées. Le nouvel équilibre qui peut se mettre en place par dessus les populations uni ou pluricellulaires crée et individualise les biocénoses tout en s'étendant sur les continents. Cette complexification a certainement été très rapide au fur et à mesure de l'avancée de la biosphère dans des milieux vierges de plus en plus secs. Cette tendance s'était certainement mise en place dès les coacervats mais la conquête par les organismes pluricellulaires de milieux moins humides et moins salés que les rivages de tous les continents a imposé les pluricellulaires comme nouvelle caractéristique de premier ordre. (symétriquement, la conquête du plein océan et des terres très humides a été plus rapide aux unicellulaires inventeurs du flagelle et de la reptation qu'aux coacervats).
Cette conquête de la terre ferme a imposé en même temps de gérer la maintenance interne d'une humidité et d'une salinité voisines de celles du milieu d'origine tout en développant des mécanismes protecteurs contre les milieus extérieurs sec ou humides pour maintenir leur intégrité dans le plus de circonstances possible, en plus des adaptations de plus en plus poussées imposées par la complexification du continuum comportemental. Pour preuve, la salinité du sang de pratiquement toutes les espèces terrestres est voisine de celle de l'eau de mer. La conquête des espaces vierges en a donc été lente avec beaucoup de "casse" mais le capital d’adaptabilité acquis par le pluricellulaire sur les coacervats et leurs descendants a permis que cette conquête se fasse bien plus rapidement que la création des premières lignées de cellules dans le milieu des coacervats : en bonne fractale, la complexification de la vie suit elle aussi une exponentielle, va de plus en plus vite.
Les biocénoses sont rapidement devenues des unités élémentaires pouvant ouvrir la route à un niveau de complexité supérieur mais, cette fois-ci, son expansion a buté contre le mur des climats, à du rester enfermée à l'intérieur d'un même biotope/biome. Comme l'énergie globalement reçue est restée à peu près la même, c'est à dire considérable, et que la fabrication de la couche d'ozone amorcée dès les coacervats était terminée, la stabilisation des écosystèmes sur la terre ferme a pu avancer vers leur eutrophisation. La capitalisation de l'énergie était alors contrainte de trouver de nouvelles voies d'expansion, un niveau de complexité supérieur.
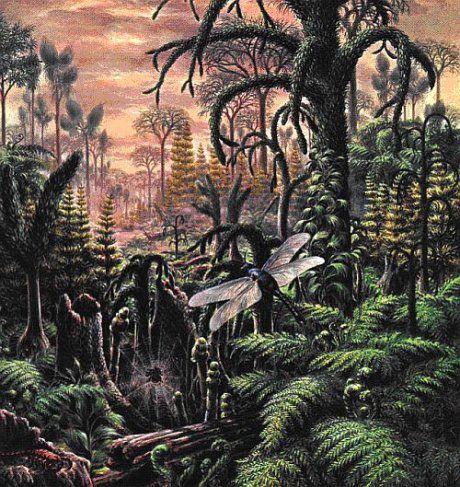
Paysage du Carbonifère.
Dualité solitude-société = dualité égoïsme-altruisme = dualité compétition-coopération = dualité capitalisme-communisme = continuum prédation-symbiose
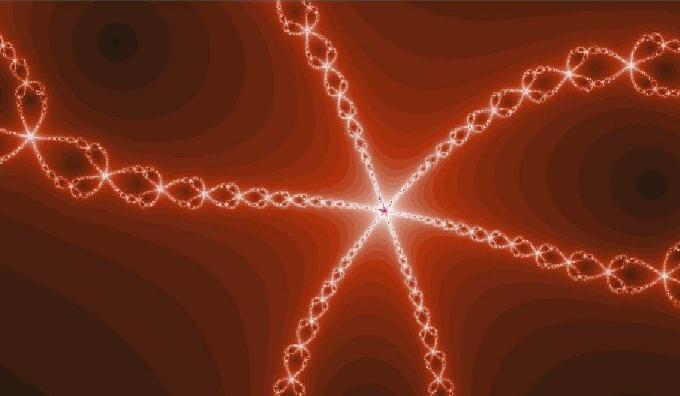
La majorité des espèces de l'époque initiale étaient constituée d'individus solitaires, enfin, solitaires au sein de leur espèce car la diversifications des formes de vie tout le long du continuum comportemental interdit la solitude absolue : entre les parasites, les commensaux, les symbiotes et les autres, aucun organisme supérieur ne peut être regardé autrement que comme une biocénose à lui tout seul même en l'absence de prédateurs et ce depuis l'intégration des proto-bactéries qui ont donné les chloroplastes et les mitochondries à l'intérieur des cellules.
Or, même lorsque des conditions extérieures faisaient localement barrage à la vie, l'énergie solaire a continué à être assimilée et capitalisée par la biosphère et cet apport oblige à sa concentration, à encore plus de complexité. Comment ajouter efficacement de la complexité si ce n'est en ouvrant un nouveau pas à la fractale, sur le même motif puisqu'il a toujours été efficace pour ça jusque-là ?
Le passage de l'unicellulaire au pluricellulaire, comme nous l'avons vu, avait été amorcé par les ancêtres des Volvox, Gonium, etc. Le pas suivant est, en toute logique, de tenter la création de quelque chose structuré sur la base d'individus pluricellulaires. L'apport continu d'énergie solaire et la sélection poussent à élaborer quelque chose de plus complexe mais viable, efficace et pérenne, à créer sur la base d'individus une structure plus compétitive que ces mêmes individus isolés dans la captation et la capitalisation de cette énergie.
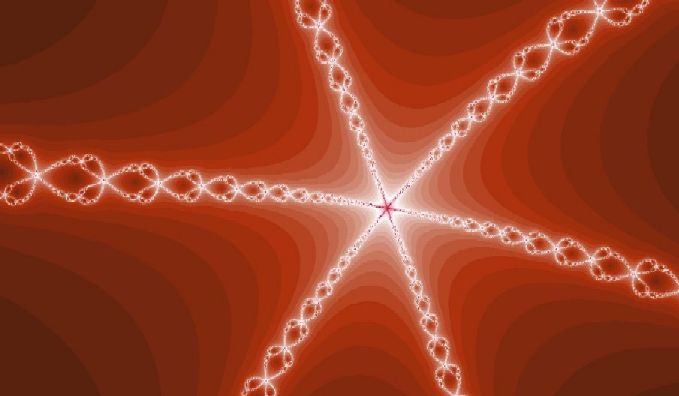
Les populations d'individus d'une même espèce et étroitement reliés entre eux en méta-organismes diffus, en super-organismes (cf. Bert Holldobler & E.O. Wilson, The super-organism, 2009, 522pp., Norton, ISBN 978-0-393-06704-0), existent et sont dites "eusociales" (du grec, eu = eury = large, complet). Les premières traces d'organismes eu-sociaux ont été trouvées chez des insectes (termites, abeilles, guêpes et fourmis) datant d'il y a plus de 65 millions d'années (= fin Crétacé). L'évolution y ayant amené a forcément commencé plusieurs millions d'années avant. Pour comparaison, les premiers hominidés sont apparus il y a 6 petits millions d'années.
Le mécanisme qui conduit à l'eusocialité est celui qui conduisit aux pluricellulaires. C'est une autre déclinaison de l'équilibre de Nash du dilemme du prisonnier répété et du problème des marchands de glace répété : si l’égoïsme permet parfaitement la survie de l'individu, dans les situations répétitives la coopération lui est bien plus efficace. Ainsi, si un rassemblement d'individus d'une même espèce a majoritairement, au départ, un comportement de compétition intraspécifique, toute ébauche de stratégie coopérative est généralement plus efficace pour la conservation et la multiplication du génome. Toute amorce de comportement coopératif a donc un très grand pouvoir intrusif sur l'ensemble des comportements en cours et possibles dans l'espèce et, dès que le maintien de la coopération garantit à la fois plus de stabilité au génome et une certaine souplesse/adaptabilité face son l'environnement, la sélection naturelle a toujours fini par la retenir devant tout les autres comportements. Par contre, si une coopération, quelle que soit son efficacité énergétique, impose globalement plus de rigidité génétique et adaptative que celle d'individus isolés, elle est marginalisée puis éliminée.

Fourmi du Crétacé prise dans de l'ambre.
Tout comme l'a été celle des pluricellulaires, la route vers l'eusocialité est ainsi parsemée d'embûches et d'impasses qui demandent du temps pour être éliminées. Si certains insectes ont franchi ce cap au crétacé, pour les bien plus jeunes vertébrés cette route ne fait que commencer, les "dégâts collatéraux" de cette recherche aussi mais cette jeunesse permet également d'inventer éventuellement une autre voie, un schéma légèrement différent de celui d'il y a environ 100 millions d'années. Un signe qui permet de le confirmer est la petite différence qui existe entre les fourmis et les termites : la caste laborieuse est toujours constituée de femelles chez les fourmis alors que les termites la constituent d'individus des deux sexes, tous stériles dans tous les cas. Ceci dit, sur une centaine de millions d'années, il est pratiquement certain que pour eux l'ensemble des variations possibles a été testé.
En outre et c'est logique, quel que soit le pas de la fractale, l'évolution principale se stabilise au centre du flux d'énergie, au plus fort des courants de sa transformation. Ceci parce qu'à ses marges l'énergie n'est plus assez abondante pour permettre l'essor de la complexité même si c'est là qu'elle naît : le flux principal attire à lui, sélectionne dans ses marges, les complexités les plus efficaces pour la capitalisation de l'énergie. Un corolaire intéressant est que la biosphère garde la trace de sa propre évolution dans la diversité de ses marges (espèces dites "fossiles vivants", "archaïques", etc.). On peut considérer ici les marges aussi comme une sorte de "laboratoire de recherche sur l'amélioration des génomes", une bibliothèque des "inventions du vivant", "l'ADN de la biosphère" en quelque sorte. D'ailleurs, dans une fractale, la répétition des motifs, les pas suivants, sont générés aux marges des figures déjà posées et non pas autour de leurs centres de gravité souvent unis, homogènes. C'est encore une confirmation de l'universalité de la loi des 90-9-1.
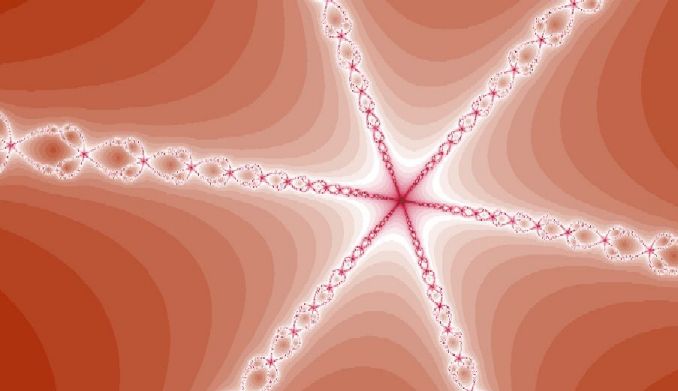
Les études de l'équilibre dynamique qui s'établit entre l’égoïsme et l'altruisme au sein d'un génome en route vers l'eusocialité montrent que, chez les espèces eu-sociales, la proximité génétique entre tous les individus du super-organisme est indispensable, chose conforme à la loi de "sélection de parentèle" et au problème des marchands de glace" présentés au début.
Familles, clans, troupes, troupeaux, tout comme pour les volvocales face aux organismes réellement pluricellulaires et comme dans le continuum comportemental, l'évolution est très progressive entre l'individu isolé le super-organisme eu-social, cette structure vivante de complexité vraiment supérieure et dont les briques sont des individus pluricellulaires. Aron et Passerat l'ont synthétisé ainsi :
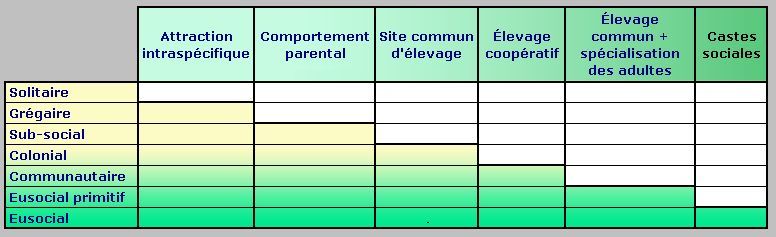
(d'après S. Aron & L. Passera, Les sociétés animales, De Boeck - 2009, 336pp., ISBN-10: 280412861X, ISBN-13: 978-2804128616.)
Le mouvement général vers l'eusocialité a sans doute commencé tout de suite dès l'apparition des organismes pluricellulaires et, comme pour tous les pas précédent de la fractale, beaucoup de populations et d'espèces se sont engagées dans cette voie il y a "très longtemps" (par rapport à nous), un grand nombre en a disparu de ne pas avoir su ou pu trouver un ou des équilibres internes assez génétiquement stables et assez écologiquement compétitifs.

Vol d'étourneaux : notez la ressemblance avec une colonie de volvox (cf. plus haut)
Par exemple, il existe une grosse vingtaine d'araignées sociales (24 en 2007) Sur les quelques 41 000 espèces d'araignées connues à travers le monde. Elles sont très peu documentées en français. Leur sociabilité semble être liée à une spéciation (= création d'espèces nouvelles) faible donc à des extinctions plus fréquentes que chez les solitaires. En d'autres termes, la socialisation a l'air d'être une impasse évolutive pour les araignées.

On connait environ 10 000 espèces d'oiseaux. Si beaucoup vivent en bandes et en troupes, en général ils ne constituent pas de société structurée. Leurs rassemblements reposent le plus souvent sur un intérêt alimentaire ou sécuritaire bien compris provoquant plus des foules ponctuelles qu'une société organisée et les ornithologues vous diront que beaucoup de ces regroupements massifs d'individus concernent souvent plus d'une espèce en même temps. On devrait plutôt parler de foules que de sociétés d'oiseaux. Il existe néanmoins deux exceptions : l'une, très connue, concerne les espèces de manchots et l'autre les républicains. Sur les 18 espèces de manchots connues, 11 (pour l'instant) sont menacées d'extinction. Il est donc assez probable que, comme pour les araignées, la vie sociale soit pour l'instant chez eux aussi une impasse évolutive.
Quant à lui, le républicain n'est pas une espèce eu-sociale. Il est un des rares cas de construction de site d'élevage en commun et ce ne semble pas du tout être une impasse évolutive mais un cas situé entre le site commun et l'élevage coopératif.
.jpg)
Nid de républicains
Chez les mammifères la même progression vers l'eusocialité est visible mais il n'existe, dans l'état actuel des connaissances, que trois espèces de mammifères eu-sociales : le rat-taupe nu (Heterocephalus glaber) (voir aussi Fractal dimension of African mole-rat burrows, résumé en français, pour le lien entre les fractales et la structure de leurs terriers), le rat-taupe de Damara (Cryptomys damarensis) et le rat-taupe d'Ansell (Cryptomys anselli). (La pauvreté du web français de 2013 sur ce sujet est affligeante). Vous remarquerez que leur passage à l'eusocialité est issu d'une contrainte extrêmement forte de leur environnement : l'aridité. D'une façon générale, d'ailleurs, la coopération intraspécifique est d'autant plus facile que les environnements sont hostiles. ils obligent en effet les espèces survivantes à se structurer très fortement pour maintenir et stabiliser leur colonisation du milieu (donc la récupération d'énergie solaire au profit de leur génome), sinon elles s'éteignent : la difficulté à survivre oblige à la plus grande maîtrise possible des flux d'énergie. La coopération révèle, ici et encore une fois, sa supériorité sur l'individualisme tout comme le pluricellulaire l'est sur l'unicellulaire.

rats-taupes
Pour résumer cet endroit de l'évolution par rapport au pas précédent, on peut considérer qu'en fait, le "coacervat de base" du "continuum socialisateur" (des solitaires aux eu-sociaux), est l'individu à l'intérieur de son espèce. Tant qu'aucun génome individuel particulier n'arrive à prendre l'hégémonie sur ceux des autres individus de l'espèce de façon stable et durable, le continuum comportemental et les règles de capitalisation de l'énergie (loi des 90-9-1, eutrophisation, marchand de glace répété, prisonniers répété, etc., qui ont fait le succès de la biosphère en général) s'appliquent intégralement à l'intérieur même de l'espèce et selon toutes les déclinaisons viables.
Une conséquence logique est que des rassemblements analogues aux écosystèmes se produisent ainsi au sein même des espèces en route vers l'eu-socialisation. Les individus se regroupent autour de certains flux d'énergie, se spécialisent, s'adaptent de leur mieux à leur exploitation, en changent plus ou moins brusquement et plus ou moins complètement selon les circonstances (épuisement de la ressource, adaptation à un flux voisin, etc.) en présentant des variations comportementales couvrant l'ensemble du continuum de même nom et ce, toujours au sein même de l'espèce. On a ainsi, dans l'espèce elle-même, des regroupements allant du temporaire (foules de gagnage) au "héréditaire" (pratiques "culturelles") en fonction de leur efficacité à drainer de façon efficace et pérenne une partie des flux d'énergie exploités suffisante à leur maintien.
Dualité erratisme - sédentarité
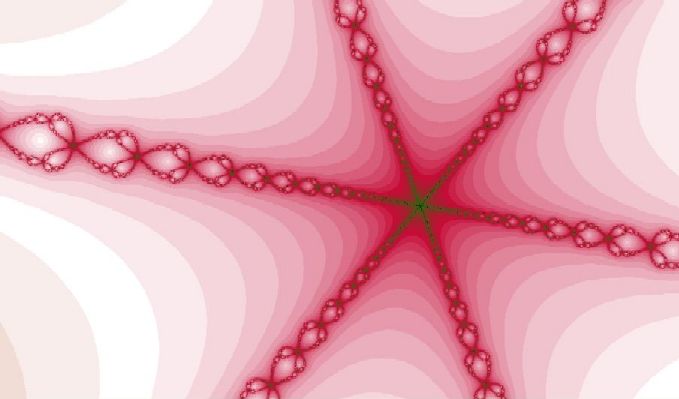
Notre espèce subit depuis peu cette transformation foudroyante : apparus il y a environ 2 000 000 d'années seulement, les hominidés sont restés des individus isolés en petits clans familiaux sur environ 90% de cette période, c'est à dire tant qu'ils n'ont pas su faire autre chose que "piller" leur environnement sans chercher à le modifier consciemment. L'explosion, la transformation évolutive majeure, n'a pas été la maîtrise du feu et des armes (-500 à -300 000 ans) mais celle de l'agriculture et ceci date d'il y a environ 12 000 ans (sur les 2 millions).
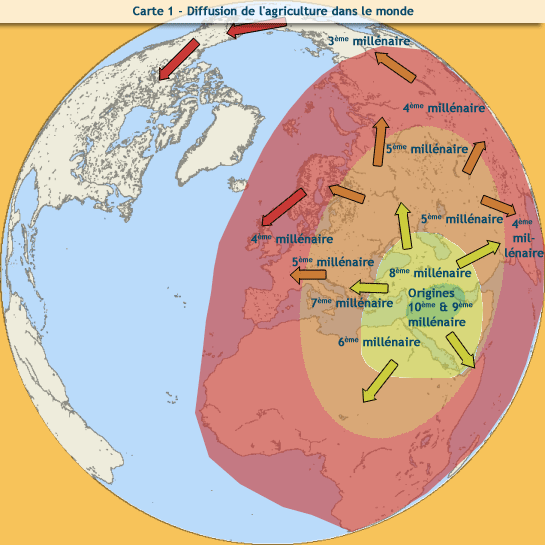
L'agriculture a été découverte en Mésopotamie il y a environ 12 000 ans seulement, l'irrigation il y a environ 8 000 ans. La technique étant extrêmement compétitive, elle s'est répandue comme une traînée de poudre dans toute l'espèce, il lui a fallu 5 000 ans pour s'imposer sur tous les continents.
Comme l'agriculture impose de rester au même endroit tout en garantissant une plus grande stabilité des ressources alimentaires, la voie s'est ouverte d'elle-même à la complexification et à la spécialisation des rapports entre les individus : la sédentarité permet d'autres divisions des tâches que celles des origines où les mâles dominants assuraient la protection et l'alimentation du groupe par leurs razzias et prédations dans leur environnement et les femelles le maintien de la pérennité du groupe par l'élevage des générations suivantes et la gestion du "quartier général" en particulier, au départ, en gérant les cultures et les premiers élevages d'animaux domestiqués.
Ceci posé, je ne peux que constater que l'élevage intensif aussi est une conséquence de l'agriculture : d'une part il n'était possible qu'en ayant trouvé comment assurer une alimentation stable aux troupeaux tout en conservant celle de la tribu et d'autre part c'était impossible tant que la tribu n'était pas fixée toute l'année ou presque (même si un certain erratisme est possible avec les grands animaux comme en attestent les populations d'éleveurs rémanentes au Sahara et en d'autres milieux hostiles pour lesquelles c'est justement l'hostilité du milieu qui force à l'erratisme).
Dès 2 000 ans après son invention, les premières grandes agglomérations naissaient : l'agriculture, outre d'imposer une coopération plus forte et plus large, libère aussi du temps et de l'énergie pour que certains individus puissent se consacrer à des tâches n'ayant plus qu'un rapport lointain avec la chasse, la moisson et la défense. L'artisanat est né en même temps que le commerce et ce n'aurait pu être sans disposer d'abord des stocks alimentaires agricoles. C'est de cette époque que date l'apparition de vies entières passées sans chasser ni cultiver et la naissance de l'écriture, il y a seulement 5 200 ans d'aujourd'hui (sur les 12 000).
Les premières villes ont d'abord été des regroupements de commerçants, les premiers nœuds des échanges commerciaux. Les spécialisations ont été rapides et la sélection a tout de suite exercé sa pression. Le principe d'eutrophisation a suscité les vieux comportements de pillages et de guerres mais, cette fois, les prédateurs et parasites n'étaient plus des individus d'une autre espèce mais des groupes humains spécialisés. Chaque entité citadine ou clanique de grande taille s'est comportée comme un individu à part entière, entrant en relation avec les autres entités de même taille selon l'une ou l'autre des attitudes du continuum comportemental alors que les individus de tous ces groupes s'alignaient eux aussi le long de ce même continuum tout en demeurant dedans : la fractale est passée au pas suivant en différents motifs de couleur et de contours flous (agriculteurs, artisans, artistes, pillards, mercenaires, etc.)
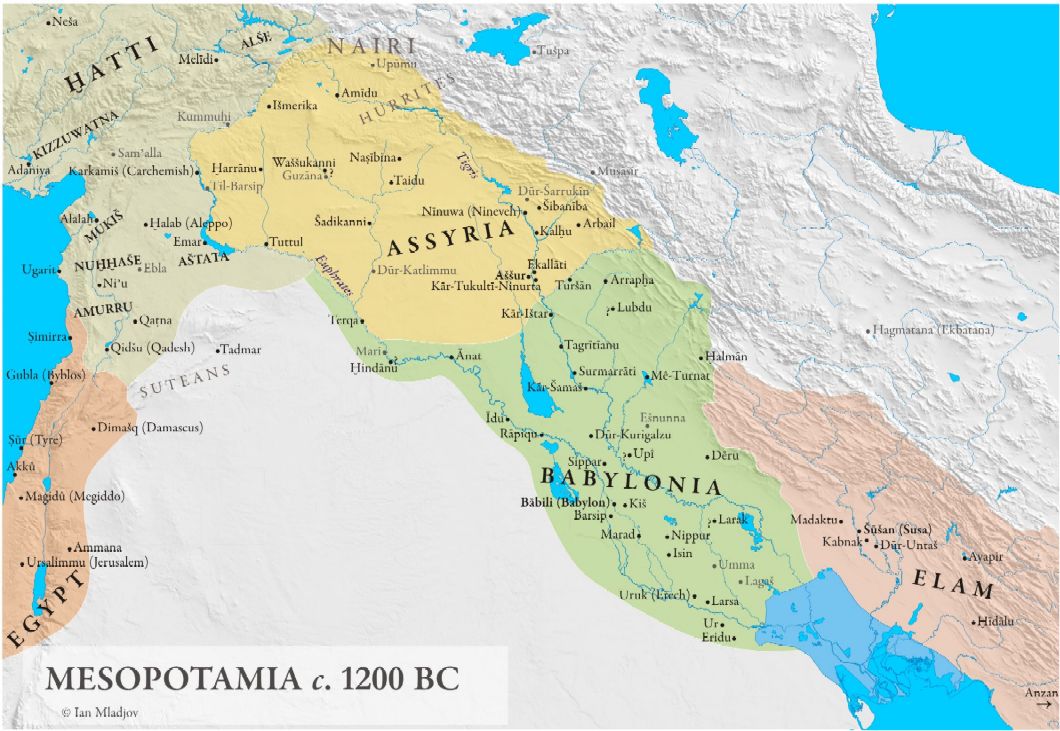
Cette soupe primitive de villes et de troupes a donné naissance aux premières sociétés constituées, premières oligarchies et dynasties, petites, concurrentes, fragiles mais constituées et, tout en restant voisines, fédérant leurs membres dans les premières cultures différentes et très élaborées, à panthéons divins différents. Ceci pendant que, partout ailleurs, les populations humaines s'engageaient dans des voies analogues tout en restant assez isolées les unes des autres et suivaient des évolutions différentes.

L'humanité s'est complexifiée en populations de cultures différentes basées sur des valeurs différentes mais toutes les grandes ont remplacé le mode de vie antérieur, celui de chasseurs-cueilleurs, en celui d'agriculteurs-pillards regroupés en sociétés concurrentes ou uniques. L'eutrophisation poursuivait son chemin sans entrave puisque les sociétés nouvelles, donc sans autre prédateur qu'elles-mêmes, capitalisaient mieux l'énergie solaire intégrée à la biosphère que les populations antérieures (dont il ne reste aujourd'hui que quelques très rares vestiges isolés et en phase terminale d'extinction).
La fractale a généré une sorte d'écosystème à l'intérieur même de l'espèce alors qu'aucune autre espèce sociale ne semble jamais s'être engagée dans cette voie jusque-là sauf à en avoir sans doute été rapidement éliminée face aux autres et sans laisser de trace. Tout me semble s'être passé comme si la dualité entre l'égoïsme et l'altruisme avait généré une sorte de nouvelle déclinaison de la fractale à l'intérieur même de l'espèce. Ceci sans doute en raison de l’influence affaiblie de la loi de sélection de parentèle puisqu'il n'y a pas eu de prise d'hégémonie d'un génome particulier à l'intérieur des populations survivantes, contrairement à ce qui s'était passé chez les arthropodes sociaux.
Cette absence de prise d'hégémonie génétique, cette faiblesse de la loi de sélection de parentèle, était, de toute façon, inévitable d'une part parce que le génome humain ne peut pas supporter une trop forte consanguinité sans en mourir, d'autre part parce que son rythme de reproduction est bien trop lent pour garantir à toute population réduite le maintien d'un effectif minimal, surtout quand on compare avec celui des arthropodes sociaux. La stabilité de la socialisation de l'espèce humaine n'a pu, ne peut et ne pourra génétiquement et physiologiquement pas tenir sur un nombre réduit de reproducteurs. Toute tentative de dynastie en est obligatoirement vouée à l'échec.
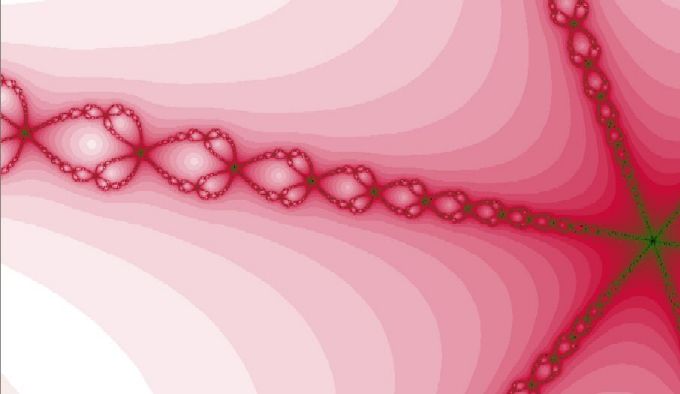
Le chemin trouvé par notre espèce a l'air d'être nouveau pour la biosphère mais d'une part, il est trop tôt pour pouvoir en conclure qu'il constitue une impasse évolutive bien que la très rapide eutrophisation générale actuelle puisse le laisser penser, d'autre part, si cette voie a déjà été explorée par d'autres espèces sociales depuis 65-70 millions d'années, nous n'en avons aucune trace aujourd'hui. Il me semble néanmoins probable que les éventuelles tentatives passées soit n'ont pas débouché sur quelque chose de viable et stable, soit n'ont pas pu résister devant la puissance de ce qui est aujourd'hui le schéma général des arthropodes eu-sociaux : les castes ouvrière stérile, militaire stérile et reproductrice fertile. Je note néanmoins que certaines espèces eu-sociales comportent plusieurs pondeuses par nid, des centaines, mais génétiquement pratiquement identiques entre elles, portant en tout cas des génomes plus homogènes que ceux de leurs descendances stériles (fourmis envahissantes des genres Solenopsis, Anoplolepis, Wassmannia, etc.).
Quoi qu'il en soit, la grande spécificité de l'espèce humaine par rapport aux eu-sociaux vrais, en plus de l'absence de castes génétiques, est de déployer une dualité égoïsme-altruisme en son sein. Comme il n'y a pas de sélection de parentèle viable, le continuum comportemental s'y déploie entièrement. Donc, comme dans tout écosystème, si l'une des déclinaisons déstructurantes prend le dessus, eutrophise l'ensemble, elle s'en désintègre et ceci peut entraîner la désintégration de toute l'espèce. C'est peut-être ce qui est en train de se passer mais la complexité de cet "écosystème intraspécifique" est telle qu'il est difficile d'en juger.
dualité concentré - diffus
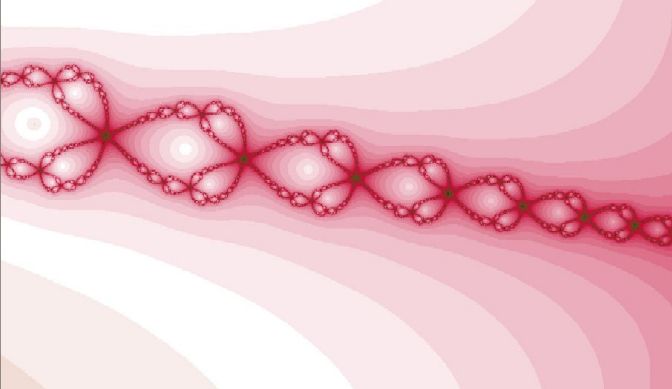
Sur le plan évolutif, la communication inter-individuelle est un pré-requis obligatoire à la vie en société. Les hominidés savent à peu près parler depuis au moins 2 millions d'années, 2000 millénaires. Le langage articulé avec manipulations de concepts abstraits comme le temps est estimé à environ 50 millénaires "seulement".

De ce que nous en savons aujourd'hui et comme nous l'avons vu ci-avant, nous inventions l'écriture il y a seulement 5 200 ans environ, au début de l'âge de bronze, il y a un peu plus de 5 millénaires. Les premières traces sont portées sur des tablettes d'argile, c'est pour ça qu'on les a aujourd'hui. Ils savaient certainement compter et écrire avant (en plus, ils venaient d'inventer la poterie : écrire sur de l'argile est plus pratique que de graver une paroi de pierre ou du marbre mais ce n'est rentable que si ce qui est écrit doit être conservé longtemps, sinon une pièce de tissu, du sable, de la boue, voire une grande feuille séchée peuvent suffire. On a donc pu savoir écrire avant ces tablettes d'argile.)
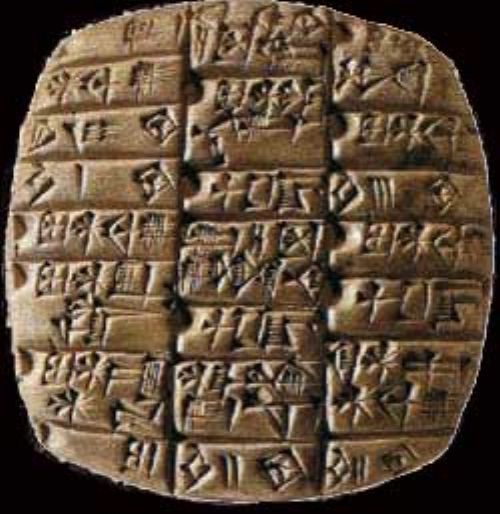
C'était encore en Mésopotamie, dans le croissant fertile, la zone géographique qui recouvre d'un côté le pays des futurs pharaons, le Nil, de l'autre celui des futurs Assyriens et Hittites entre le Tigre et l'Euphrate avec le Jourdain entre les deux (pendant la période d'Uruk, s'étalant de 5 700 à 4 900 ans d'aujourd'hui, au début de l'âge de bronze).
Au départ issue de la nécessité de gérer les échanges commerciaux et les perceptions d'impôts, l'écriture a presque immédiatement explosé ce cadre pour commencer à capitaliser les savoirs et les cultures : la plus vieille histoire écrite connue a 4 700 ans. C'est l'épopée de Gigamesh et elle est centrée autour de la ville d'Ur de Mésopotamie, une des toutes premières cités apparues au monde. Il s'agit de la première légende écrite connue où des héros sur-humains évoluent dans un monde semi-divin de rites élaborés, démontrant le pouvoir fédérateur que la religion a exercé pour stabiliser les premières grandes communautés humaines. On ne sait pas formellement aujourd'hui s'il s'agissait plus d'une légende que d'un texte religieux mais on sait que les premiers poèmes, romans, ouvrages techniques, scientifiques, sont apparus à peu près en même temps et, étant réservés à ceux sachant les lire, sont surtout concentrés sous la forme écrite dans le milieu des élites politiques et culturelles de ces premières civilisations. Ces écrits témoignent aussi du fait que dès la constitution des toutes premières grandes agglomérations l'espèce s'est naturellement portée vers une spécialisation hiérarchisée des tâches (proto-castes) et vers la recherche d'une stabilisation dynastique, exactement comme les arthropodes l'avaient fait avec succès quelques 60-70 millions d'années plus tôt.

Gilgamesh
Le gros bémol à cette datation est d'une part qu'il y a eu très peu de sondages en Afrique Noire d'où il semble que nous soyons tous issus et d'autre part qu'il n'y en a pas eu non plus - et pour cause - dans ces milliers de kilomètres carrés de plaines et rivages qui, bien qu'étant toujours restés à l'écart des calottes glaciaires, donc verdoyants, sont noyés depuis 9 à 10 millénaires par une montée du niveau des océans de 100 m environ à la fin de la dernière glaciation, soit environ 2 000 ans après l'apparition des premières civilisations, les plus anciennes. Il faut aussi noter que, depuis 6 000 ans, les apports de limon du Tigre et de l'Euphrate ont fait reculer la mer rouge sur une bonne distance, ensevelissant tout ce qui était alors à quelques mètres au-dessus du rivage. Il est donc possible que de leurs vestiges soient encore à découvrir, que la grande révolution encore en cours dans notre cerveau ait commencé avant la fin du Würm, avant ces 12 derniers millénaires.
De toute façon, on sait maintenant que l'invention de l'écriture, survenue après celle de l'agriculture, n'a pas été synchrone sur tous les continents et un ou deux millénaires ce n'est pas vraiment significatif à l'échelle géologique.
Au départ l'agriculture a surtout créé de très gros villages, certains devenant villes, Ur, Uruk et Assur en particulier, Assur dont le fer de lance était ses commerçants qui ont délégué l'administration de la ville à son clergé au nom du dieu principal Assur de même nom que la cité. La notion de roi est venue de là : le roi est le plus grand des prêtres et le chef de l'administration. Il deviendra plus tard le chef de l'administration et des armées tout en conservant son apostolat. D'autres villes-états, nombreuses, sont nées "au même moment" dans la région et la compétition entre elles se met très rapidement en place.
Ensuite et pendant 3 millénaires, de la naissance d'Uruk à l'avènement des Perses la Mésopotamie est une constellation de petits états plus ou moins belliqueux entre eux, un peu comme si chacun avait été une bulle d'écume issue d'une vague sur une plage, avalant ses voisines avant d'éclater ou d'être avalée à son tour : le premier empire connu est celui d'Akkad qui englobe toute la Mésopotamie de la mer Rouge à la Méditerranée il y a 4 440 ans mais il se désintègre 140 ans après. La première fédération conduisant à un grand royaume a lieu, par la force, il y a 4 millénaires en gros, 3 800 ans à peu près, sous le règne de Samsi-Addu mais ce royaume se délitera "très vite" aussi au profit de celui de Babylone qui sera plusieurs fois conquise ou rasée puis éliminée. (voir ces cartes pour se faire une idée.)
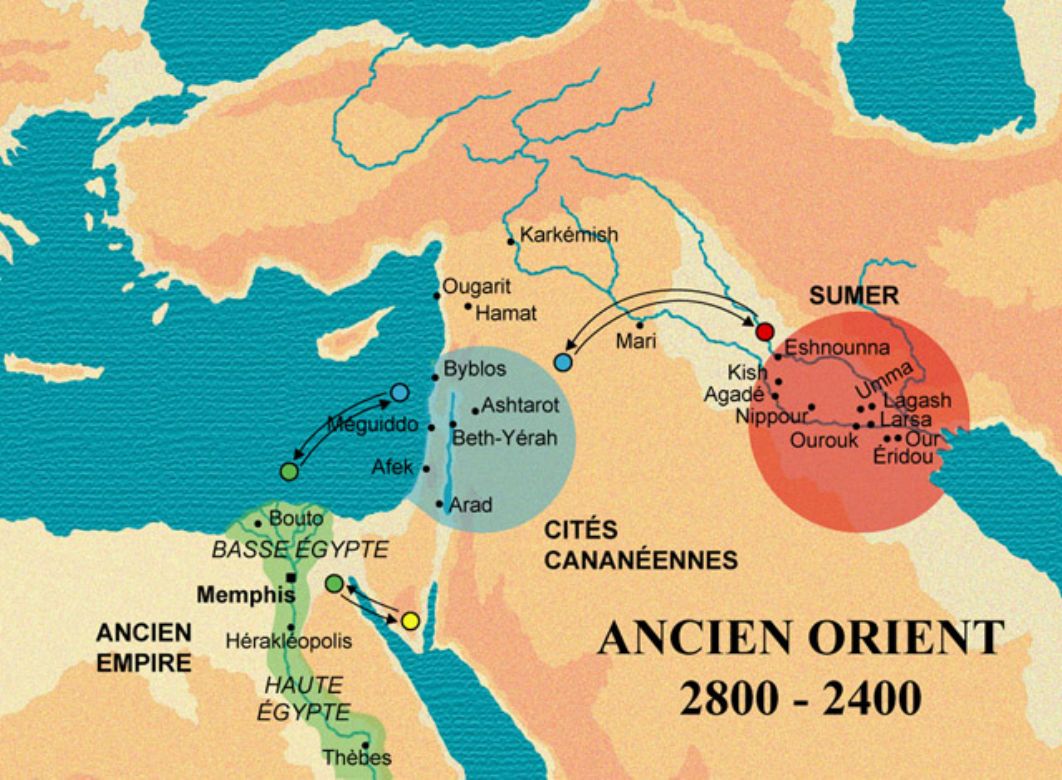
La société se cherche, cherche sa stabilité. Elle ne l'a pas trouvée d'emblée.

L'écume d'une vague évolue comme une fractale.
Comme avec nous, le temps pousse vers l'arrière les bulles nées sur le front déferlant jusqu'à leur disparition complète dans le grand tout uniforme où se créent les vagues.

Les villes ont été créées par les premiers agriculteurs, elles sont entrées en compétition, ont coopéré ou se sont mutuellement détruites au gré des essais naturels de sélection de parentèle voués à l'échec comme nous l'avons vu (dynasties et consanguinité) et des tentatives de structuration en castes qui perdurent encore (ce n'est pas par hasard que les castes des espèces eu-sociales ont reçu ces noms-là, ouvriers, soldats, reine). Ceci alors que dès leur constitution les "méta-individus" que sont ces villes et ethnies culturelles appliquent immédiatement entre eux le continuum comportemental comme le font les espèces d'un même écosystème et comme ont du le faire les coacervats.
L'agriculture a ainsi généré des ethnies et des cultures différentes qui ont été isolées, brassées ou détruites pendant ces 7 derniers millénaires alors que, globalement, la densité humaine augmentait de plus en plus vite partout au monde. La structuration de plus en plus élaborée des sociétés permettant une capitalisation de plus en plus importante et efficace de l'énergie, la complexité de l'ensemble a continué d'augmenter.
Je pourrais dire que la limitation imposée à la loi de sélection de parentèle par notre incapacité à supporter une forte consanguinité était partie pour nous interdire la voie vers la socialisation mais que notre adaptabilité l'a contourné en utilisant la dualité égoïsme-altruisme pour créer un écosystème à l'intérieur même de notre espèce, tentant ainsi de faire passer la fractale évolutive de toute la biosphère à un pas supérieur (puisqu'il semble que cette voie soit nouvelle).
Cette période de la naissance des sociétés humaines et des techniques de gestion et d'industrialisation est très intéressante car, comme dans toute fractale, les processus alors déployés sont ceux que nous déclinons depuis dans la complexification de nos activités. Je remarque encore que le chiffre 3 est très souvent utilisé pour distinguer les grands sous-ensembles conceptuels dans la plupart des domaines : de la même façon que les molécules bâties sur la fenêtre de vie du carbone, de l'oxygène et de l'azote (3, en considérant l'hydrogène comme un terminateur de liaisons) se sont séparées et assemblées en 3 familles de molécules, les glucides, lipides et protides, que les êtres vivants qui en sont issus se sont également séparés et assemblés en végétaux, animaux et champignons, les 3 règnes, et jusqu'aux espèces eu-sociales organisées en 3 castes, les ouvriers, soldats et reproducteurs, les sociétés humaines, d'abord guidées par les 3 valeurs de "famille-travail-patrie", ont généré les secteurs, économique, social et politique bien qu'au départ les trois aient tous été inclus dans le religieux, la tendance depuis quelques toutes petites centaines d'années étant de les séparer de ce qui ne semble plus utile et nécessaire au maintien de la cohésion des civilisations. (... merci d'arrêter de hurler). Toujours des 3, depuis les atomes de l'atmosphère primitive.
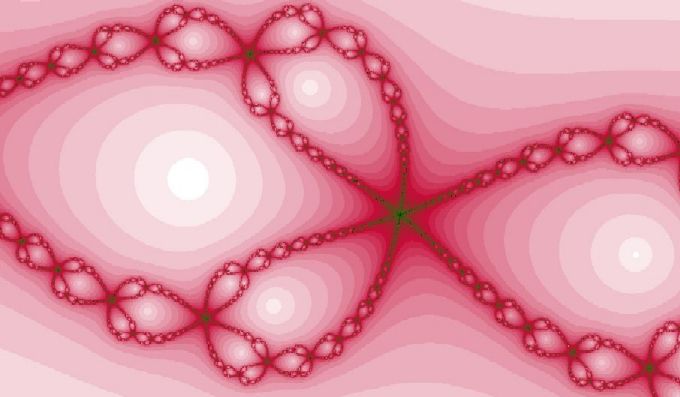
Je n'y connais pas grand chose en mathématiques mais mes recherches sur les fractales m'ont fait sauter aux yeux celle de Newton dont l'équation génératrice s'écrit y= z³-1, y égale z puissance 3 moins 1. Les racines de cette équation sont-elles des attracteurs ? Quel est le lien entre ce 3 et celui qui semble caractériser l'évolution de la vie sur terre ? Est-ce une "illusion d'optique" ou une réalité à formaliser avec rigueur ? Suis-je incapable de conceptualiser plus de 3 divisions sur des sujets de cet ordre ?
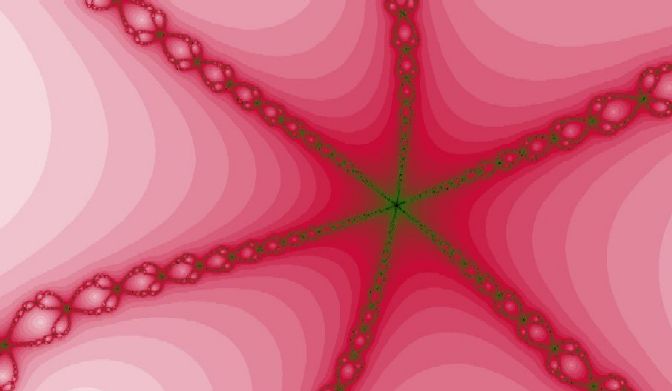
Fractale de Newton.
Quoi qu'il en soit et conséquence logique du maintien de la dualité égoïsme-altruisme dans l'espèce, les individus sont dans une situation analogue à celle des coacervats de la soupe primitive devant le défi de créer l'ADN, ou bien comme les unicellulaires devant celui de créer et conserver de façon durable le système les structurant en individus pluricellulaires, ou enfin comme les espèces devant s'assembler en biocénoses stables et les plus vastes possible. C'est, en somme, pour que la stabilité de leur existence soit acquise et consciemment ou non, le défi incontournable que doivent relever les groupes d'affinités dans les populations humaines, qu'ils soient plus économiques (entreprises), sociaux (culturels) ou politiques (partis) : trouver "un ADN de leur collectif" leur garantissant la pérennité et la reproductibilité quels qu'en soient les individus à un moment donné.
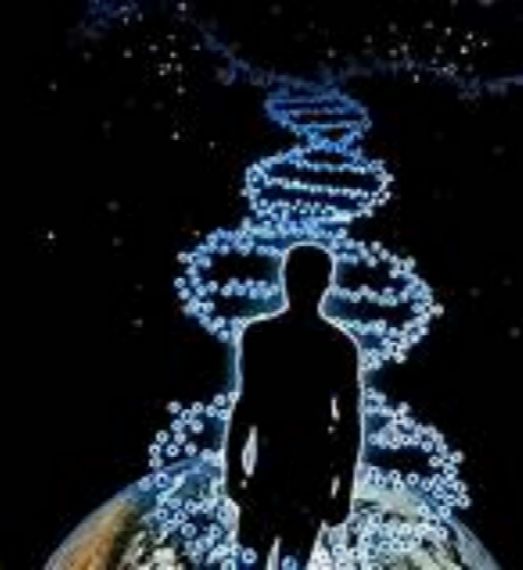
L'ADN, la bibliothèque du vivant.
Notre propension originelle à capitaliser les techniques et le savoir par écrit et à engranger ces écrits dans des bibliothèques qui sont parmi les lieux les plus universellement respectés, même si ceux voulant se rêver les "maîtres du monde" les ont régulièrement et ponctuellement détruites sans y arriver complètement, me laisse penser que la connaissance écrite est l'ADN collectif des groupes d'affinités. Il est en cours de virtualisation depuis deux ou trois décennies bien qu'il soit actuellement pas mal dilué dans des quantités astronomiques d'informations sans valeur, une soupe primitive d'informations en langage humain en quelque sorte. Le grand point faible de la connaissance par rapport au génome est qu'elle n'est pas innée, elle doit être acquise et son acquisition demande du temps et de la volonté. Sa grande force est de se montrer aussi compétitive que le génome pour garantir à ses possesseurs et utilisateurs l'efficacité de son usage.

Reconstitution de la grande bibliothèque d'Alexandrie,
incendiée une première fois lors de l’entrée de Jules César dans la ville (48 av. JC) :
Il avait fait brûler les navires du port et le feu s'est propagé à la bibliothèque toute proche.
En 295, les collections sont de nouveau endommagées (révolte d’Aemilianus).
En 391, le Sérapéion est détruit pendant une révolte contre Théodose.
Enfin, Alexandrie tombe aux mains des arabes en 691 et ils la détruisirent complètement.
Les groupes d'affinités, qu'ils soient à vocation économique, sociale ou politique, se constituent au départ sur une opportunité, une ressource, une forme d'énergie. Leur fonction est d'exploiter cette énergie pour qu'elle reste au sein de l'espèce et, la plupart du temps, au sein du groupe lui-même. De plus, strictement rien n'interdit la constitution de "groupes de groupes", de fédérations, de cartels, de trusts, etc. et ce sans limite de taille, de niveaux autre que la quantité d'énergie qu'ils drainent à eux et ce quelles que soient la ou les sources. Ensuite, le problème des marchands de glace et le dilemme du prisonnier répété participent à la sélection et aux regroupements autour des flux d'énergie exploités.
Nous sommes donc ici dans une situation très analogue à celle des coacervats en route vers l'apparition des premières cellules : il n'y a pas de système "universel" de stabilisation des "cellules d'affinités", ces "coacervats sociaux" sont brassés et peuvent se mélanger, s'inclure, se dissoudre "au hasard" et sans espoir de renaître autrement que "par hasard". Leur durée de vie est, somme toute, parfaitement imprévisible bien que leur existence soit garantie par l'ampleur de la population, la stabilité de la socialisation humaine et aussi la disponibilité de leur ressource principale à un moment donné, leur justification sociale du moment. Nous sommes bien dans une fractale d'affinité-opposition totalement en dehors de la sélection de parentèle, totalement indépendante du génome des populations constituant les groupes qui, d'ailleurs, recrutent d'une façon aléatoire des individus, des portions de génomes, pour se constituer et/ou se renouveler : le critère de sélection est acquis, uniquement basé sur une ou des connaissances, le critère familial est de plus en plus rare.
L'ADN des groupes d'affinités économiques, sociales ou politiques est donc la connaissance orale, visuelle ou/et écrite. La culture n'existe-t-elle que par le partage ponctuel ? Quelle est l'histoire de la capitalisation des savoirs ? Combien en a été/est/sera définitivement perdu chaque fois qu'un groupe s'éteint ? Comment conserver longtemps celles utiles à la conservation des groupes ? Saurons-nous inventer et déployer un système aussi fiable, stable et reproductible que le génome ?
Depuis avant les premières villes, "l'ADN collectif" a d'abord et surtout été oral et rituel. Les transferts d'énergie sont également très rapidement passés du troc au virtuel, sont devenus des flux financiers. Les groupes d'affinités socio-politico-économiques se sont complexifiés et ont grandi petit à petit, en prenant de l'autonomie par rapport au pouvoir central du roi.
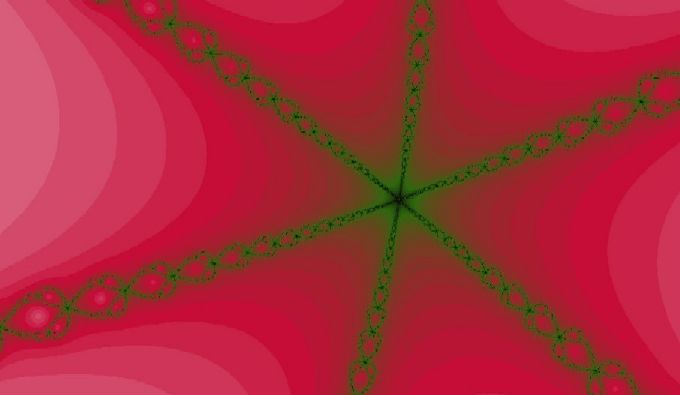
Dualité individu - communauté
Les rassemblements intraspécifiques, versatiles ou stables, organisés en sortes d'écosystèmes autour de flux d'énergie accessibles que j'avais évoqués plus haut chez toutes les espèces à tendances sociales sont, évidemment, aussi un trait de la notre. Par exemple, on peut considérer que les rassemblements dans les centres commerciaux tiennent de la foule de gagnage (achats alimentaires et autres) pour la population des clients, de l'exploitation structurée d'une ressource (l'argent des acheteurs) pour la population des vendeurs, d'un équilibre de Nash du dilemme des marchands de glace pour le regroupement en un même espace des entités vendeuses, qu'elles soient concurrentes entre elles ou non. On retrouve également l'expression de l'ensemble du continuum comportemental à la fois côté client et côté vendeur depuis la symbiose jusqu'au parasitisme-prédation. On notera également que, comme chez les coacervats et dans les écosystèmes, les entités pluri-individuelles s'imbriquent souvent les unes dans les autres avec une complexité croissante et, pour ces entités pluri-individuelles, le continuum comportemental se décline entièrement dans chaque niveau interne et également au niveau global, dans son action sur ce qui l'entoure.

Par exemple, il existe des entités commerçantes dont les sous-groupes de coordination interne (gestionnaires) gèrent parfaitement et en général consciemment l'exploitation de leur marché selon une ou des stratégies (parfois même contradictoires entre elles) s'étalant entre la symbiose et le parasitisme social alors qu'en leur sein les individus qui les constituent en font de même entre eux : c'est la fameuse opposition entre les "carriéristes récupérant ou volant le travail de leurs collègues à leur seul profit" et les "dévoués serviteurs de l'entreprise qui bossent sans jamais rien réclamer de particulier en plus", ceci dans des structures pouvant aussi bien avoir des comportements prédateur, esclavagiste, parasite, coopératif, symbiotique "désintéressé", etc. Ces comportements se retrouvent évidemment aussi "côté client", dans la population des acheteurs. Ce phénomène est facile à constater que ce soit en milieu commercial, politique ou social, dans les sociétés commerciales, partis politiques, associations non gouvernementales et autres. Le continuum comportemental se retrouve ainsi absolument partout, à chaque niveau de structuration depuis le plus bas, l'individuel, jusqu'au plus haut niveau fédérateur des énergies (donc du travail) dans le groupe considéré, qu'il soit association, entreprise, parti, service, ministère, consortium, holding, fédération, syndicat, cartel, multinationale, ONG, etc.

La grande hypocrisie de notre société me semble venir de son ignorance et/ou de son refus de reconnaître cette réalité, chose qui, comme toute autre contradiction, a généré et génère en fractale des comportements spécifiques pour exploiter l'énergie qui en aurait été perdue autrement. Il existe donc énormément de comportements visant à exploiter la moindre contradiction ou faille dans l'exploitation de toute ressource, y compris les ressources "virtuelles" ou "morales" et ce, quelle que soit l'appellation officielle donnée à l'action menée sur le ou les flux d'énergie visés (cf. la crédibilité de l'OMS quant au nucléaire "civil" ou celle de la FDA américaine vis à vis des OGMs, des pesticides, la corruption en général, les compérages d'entreprises, les lobbyings, les vols à grande échelle, les assassinats de masse, les divers "scandales" dénoncés partout au monde pratiquement tous les jours et dans pratiquement tous les domaines).
La règle n°1 de la biosphère est ainsi respectée au sein même des populations de l'espèce : l'eutrophisation de tout milieu accessible par tous les moyens possibles, les moins énergivores et les plus stables au maintien de l'activité (qu'elle soit aujourd'hui identique à celle d'hier ou non) du groupe considéré étant systématiquement préférés quelles qu'en soient les conséquences pour tous les autres groupes et pour l'espèce entière elle-même.
Au niveau supra-individuel et depuis la naissance des premières cités, l'organisation humaine a évolué en se complexifiant autour des flux d'énergie, des ressources. Si, au départ, le travail du groupe de gestion de la cité se cantonnait essentiellement à réguler les échanges commerciaux et assurer la sécurité du stockage et du transport des productions, le domaine d'activité géré aujourd'hui est d'une complexité sans commune mesure avec celle de l'époque, en particulier depuis la naissance de l'ère industrielle autour de 1850.
Comme pour les évolutions de toutes les autres espèces vers la socialisation, les voies explorées qui dominent leur "marché" aujourd'hui ne sont pas nécessairement les plus évoluées. Des voies plus performantes ont régulièrement tenté de remplacer celle dominante du moment mais, étant plus évoluées donc plus sensibles aux contraintes, elles ont été marginalisées ou éliminées par la dominante même si elles auraient pu être plus compétitives pour assurer la survie et l'expansion du génome : lorsqu'un équilibre de Nash s'est stabilisé dans ce "jeu", sa stabilité le rend extrêmement résistant à l'évolution. C'est en d'autres termes ce que nous appelons "la loi du marché" et "la chance", lorsqu'un groupe quelconque prend l'hégémonie sur une ressource/un flux d'énergie et que sa position dominante ferme ensuite la porte aux concurrences naissantes. Il peut tomber un jour sur bien plus compétitif que lui, évidemment, mais sa position dominante, majoritaire, lui permet d'éliminer toute concurrence sérieuse dès le départ, le dilemme des marchands de glace pousse dans ce sens.
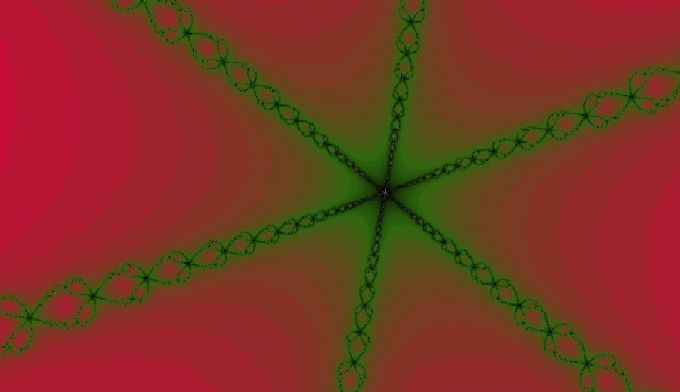
Donc, face à une situation donnée, s'il existe plusieurs équilibres de Nash possibles, ce n'est pas nécessairement le meilleur pour le génome qui est sélectionné d'emblée. Ensuite, une fois qu'il s'est mis en place et tant que le flux d'énergie/les ressources ne change pas sérieusement, il interdit pratiquement aux autres solutions possibles de prendre sa place. Il se peut que le temps finisse par donner raison à un plus compétitif et/ou plus stable que lui mais ce ne peut être aussi brusque et radical que lors de son installation à lui.
Il existe des traces de ce phénomène chez les arthropodes eu-sociaux comme nous l'avons vu : si la caste ouvrière des hyménoptères eu-sociaux (fourmis, abeilles, guêpes) est exclusivement constituée de femelles, chez les termites cette même caste de travailleurs stériles l'est d'individus des deux sexes. Dans l'état actuel des connaissances le résultat final pour l'espèce est à peu près le même, le fait témoigne seulement de l'équilibre de Nash qui s'est imposé au départ, "par hasard", "par chance" en quelque sorte.

Termites : des ouvriers et un soldat,
tous stériles mais des deux sexes et de même mère.
Ainsi, chez les humains, en fonction de leur isolation et indépendamment de tous les autres aspects d'une culture donnée, les rôles ne sont pas systématiquement dévolus aux mêmes types d'individus, que ce soit par type de "profession", par sexe, ou autre. C'est flagrant chez les derniers survivants des cultures restées longtemps isolées et que nous avons pu ethnologiquement étudier avant leur extinction sous la pression de la notre (Yanomamis, Bonobos,etc.) et aussi chez certaines des cultures plus imposantes mais non majoritaires (castes indoues, tamazighs, nippones, etc.). Ce fait révèle exactement le même phénomène : la socialisation du genre humain peut trouver son équilibre de différentes façons possibles mais une fois que l'une d'elles s'impose, tant que globalement les flux, les ressources et leur accessibilité ne change pas significativement, elle n'a que très peu de chances d'être un jour remplacée même si elle n'est pas la meilleure possible.
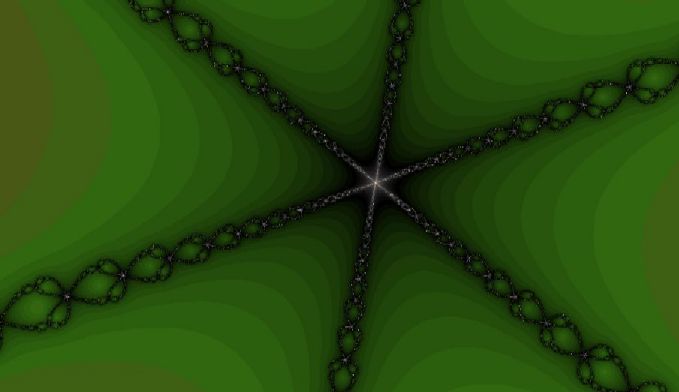
Pour ce qui concerne la culture à laquelle j'appartiens et même si je peux préférer a priori un autre des équilibres possibles (c'est toujours meilleur dans l'assiette du voisin), je ne peux que constater que, globalement, la domination du patriarcat sur le monde humain est majoritaire, dure depuis au minimum 7 000 ans et qu'aucun changement radical ne semble se profiler à l'horizon pour l'instant et sans doute pour encore bien longtemps.
Néanmoins, la révolution industrielle a induit un changement drastique. La hiérarchie des corps de métiers n'est plus la même entre 1850 et maintenant. Le statut de l'individu change, la famille traditionnelle qui constituait le groupe de base de la société avant 1850 et depuis des millénaires est sérieusement malmenée partout au monde, les rôles sont petit à petit amenés à obligatoirement se modifier. L'individu n'appartient plus à une famille d'un village ou d'un quartier, il est membre d'une communauté plus large et plus diffuse et peut même en changer plusieurs fois au cours de sa vie tant professionnellement que politiquement ou socialement.
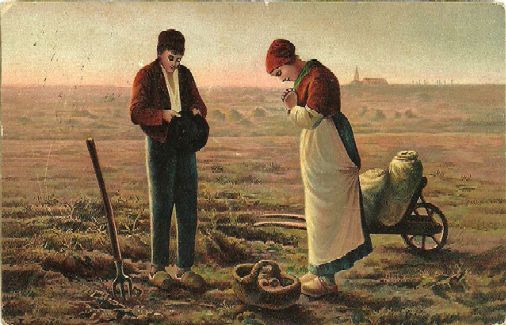
Ceci est devenu possible depuis la révolution industrielle et une mutation de tout le corps social en découle depuis : comme la taille de la population globale augmente en exponentielle depuis 1850, que la communication inter-individuelle en fait autant depuis environ les années 1990-2000 et que les autrefois minorités soumises et isolées font corps d'une façon bien plus individualisée et massive, les statuts sociaux de ses minorités évoluent doucement vers un nouvel équilibre de Nash au gré des avancées de l'intégration de ces nouveaux corps au sein de la société dans la culture dominante. L'histoire récente de la "classe ouvrière", des syndicats, de l'abolition de l'esclavage, du droit de vote des femmes, de la reconnaissance des femmes, des noirs, des homosexuels comme individus à part entière et égaux aux autres, l'intégration progressive des immigrés européens partout en Europe, la reconnaissance de la souffrance animale tant dans les cheptels que chez les animaux de compagnie, etc., sont autant de preuves d'une uniformisation en cours de ces différences-là, d'une meilleure adaptation que l'équilibre patriarcal précédent même si la route de cette nouvelle stabilisation générale semble encore extrêmement longue, surtout à l'échelle d'une vie individuelle. Ce phénomène en cours à l'échelle mondiale est probablement une des sources des changements violents du monde islamique depuis quelques années.

Comme, de toute façon, le glissement d'un équilibre vers un autre témoigne d'une opposition de valeurs, de moyens, de méthodes ou autre, il est logique que ce front-là aussi se déploie en fractale, les extrêmes déclinant leurs sommets dans toutes les directions y compris les plus suicidaires (communautés amishes, mormones, hippies, sectaires façon Aoum, Mandarom, temple solaire, brigades rouges, salafistes, nazis, KKK, séparatistes divers et plus ou moins avariés, etc.) mais tout ceci montre surtout la réalité du phénomène de précédence : un "meilleur" schéma qui ne s'impose pas "à temps", sauf grande supériorité immédiate ou changement drastique des conditions de son environnement social ou autre, est voué à la mort, au mieux à la marginalisation.
Dualité eury - sténo : fractale des colonisations
"il faut repousser nos limites"
Tous les êtres vivants sur Terre cherchent à atteindre l'eutrophisation la plus large et la plus dense possible, comme nous l'avons vu ici. L'espèce humaine cherche naturellement son expansion maximale dès son apparition. Cette expansion+eutrophisation s'effectue en "nettoyant" les milieux conquis de toute forme de facteur limitant présent et sur lequel il est possible d'avoir une influence en commençant, évidemment, par les plus faciles à réduire des plus importants.
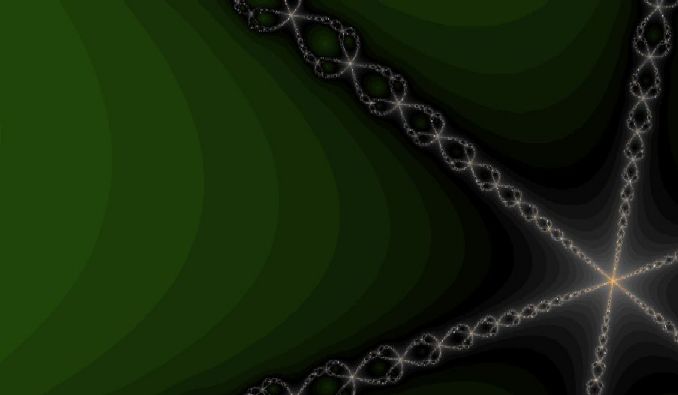
Les éradications se sont donc naturellement portées sur les plus grands des êtres vivants rencontrés, qu'ils aient été vus en tant que ressource ou en tant que menace. Il est ainsi possible de suivre la trace de l'expansion humaine à la surface de la planète à partir de sa région d'apparition en relevant la disparition des espèces de grande taille dans les milieux conquis. La grande diffusion de l'humain a commencé il y a environ 40 000 ans, au Pléistocène, sur le continent qui l'a vu apparaître, l'Afrique. Les extinctions des grands animaux en témoignent également :
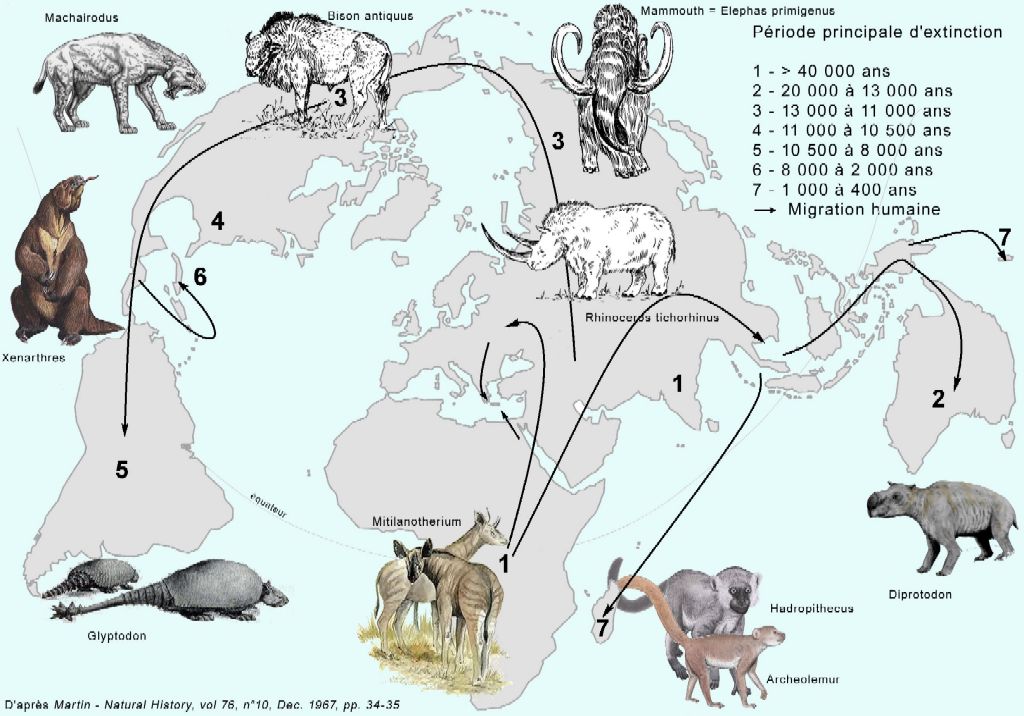
Lorsque, dans sa socialisation, l'humanité a créé le niveau de complexité suivant, les cités et les états, ceux-ci se sont comportés chacun de la même manière, comme s'ils étaient une espèce nouvelle. Les sociétés étatiques les plus primitives se sont comportées ainsi dès que leur stabilité interne le leur a permis. Les premiers empires datent des premiers états et si leur taille était proportionnelle à la stabilité de leur structure interne, leur boulimie d'eutrophisation les a détruits dès que la surface à contrôler est devenue supérieure à ce que leur stabilité intérieure permettait d'assumer. Dès ce seuil dépassé, ou/et des que la structure centrale du pouvoir s’affaiblissait, ces empires sont morts. L'espace libéré de leur emprise n'a pas toujours été immédiatement recyclé dans un "méta-organisme étatique" voisin ou successeur, de la même façon que la mort d'un arbre n'est pas suivie par l'apparition d'un autre au même endroit.
Dans l'ensemble, ces état bâtis autour de l'exploitation et de l'échange des ressources les plus abondantes et/ou les mieux maîtrisées en Mésopotamie et en Égypte ont été en contact plus ou moins directs tout en développant des cultures dans l'ensemble différentes (p.ex. les panthéons comme les alphabets assyriens et égyptiens ont des rapports très éloignés entre eux). Les premières relations internationales ont aussi immédiatement été houleuses, l'humain d'une civilisation considérant plus ceux d'une autre comme des prédateurs ou des ressources : l'esclavage n'a pas seulement servi à consciemment utiliser une main d’œuvre gratuite pour les travaux agricoles ou dans les guerres, les esclaves ont partout été utilisés aussi comme le bétail. Chaque état s'est effectivement comporté comme un organisme à part entière, comme une espèce nouvelle cherchant à eutrophiser la planète entière, exactement comme les coacervats dans la soupe primitive, comme les premiers organismes pluricellulaires et comme les insectes eusociaux entre eux (cf. fourmis esclavagistes).
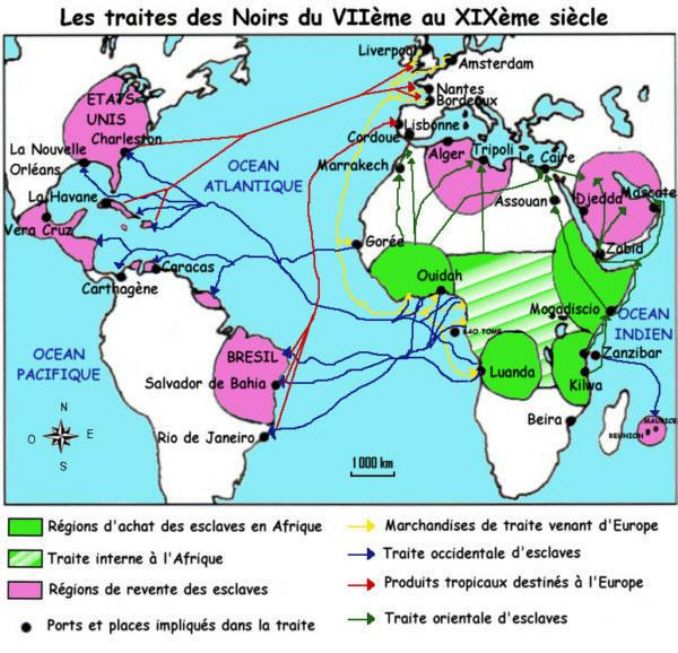
La suite de l'histoire s'est déclinée sur ce schéma, l'évolution s'est faite dans la complexification des échanges internes, des techniques, des pratiques, toujours dans le sens d'une plus grande stabilisation de ces méta-organismes humains mais sans que le schéma de développement établi au départ en soit modifié. Plus les nations se sont stabilisées, plus l'humanité s'est développée et plus les méta-organismes étatiques se sont individualisés tant par leurs cultures que par leur métabolisme des ressources. Les plus stables d'entre eux ont systématiquement éradiqué ceux qu'ils ont pu des autres, qu'ils aient été plus anciens ou juste naissants. Les premiers génocides datent aussi des premiers empires. Leur fonction a été d'asseoir le conquérant sur les ressources conquises de la façon la plus stable possible. La sauvagerie humaine envers l'humanité est au moins aussi vieille que les premiers états et elle n'est pas justifiée par les individus mais par le méta-organisme que ces individus constituent. Ce réflexe d'élimination de la différence culturelle est resté constant, il est même transmis aujourd'hui aux entités vivantes de complexité supérieure que sont les entreprises multinationales. Les éradications des cultures natives américaines commencées par les européens au moment de leur conquête de ce continent se poursuivent aujourd'hui sur celles de tous les autres continents par les multinationales (Bellomonte, Kudankulam, etc.)
La loi de Nielsen explique la conservation des stratégies gagnantes à travers la complexité croissante des structures. Ici, il s'agit de la conservation de ce motif "sanguinaire" dans cette partie de la fractale humaine en route vers l'eutrophisation mondiale.
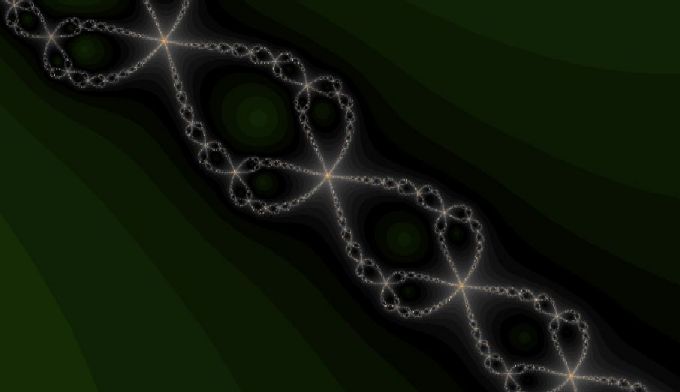
La colonisation mondiale en cours est assise sur la révolution industrielle :
La conquête de toute la biosphère s'est faite en suivant la révolution des transports. La déclinaison est frappante dans l'évolution maritime : si les premiers bateaux étaient mus par la force des bras depuis les premières barques, en passant par les birèmes, trirèmes, drakkars, galères, puis à la voile sur certains de ces mêmes bateaux, puis les galions, deux-mâts, trois-mâts, la révolution industrielle a donné le moyen d'aller encore plus vite et avec encore plus de puissance en offrant le moteur à explosion. La colonisation du monde et sa stabilisation s'appuient aujourd'hui sur les navires à moteurs. La puissance extraordinairement démultipliée fournie par les moteurs a augmenté en exponentielle la densité et la fréquence des échanges mondiaux à la fois par mer, terre et air. Ces échanges intenses sont généraux et touchent absolument tous les domaines d'activité humaine. Ils induisent aussi des déplacements de faune et de flore à travers toute la biosphère, à la fois intentionnellement et aléatoirement. Ces mélanges ont souvent des conséquences désastreuses pour les biomes. Ils sont responsables d'une grande partie des extinctions massives d'espèces et de la déstructuration massive des écosystèmes à présent décrites partout sur la Terre, en plus d'être une cause principale du réchauffement climatique.
Tout se passe comme si l'humanité était, en toute logique, en train de tenter l'uniformisation générale de la biosphère au nom de son eutrophisation propre et en brûlant tout ce qu'elle peut dans ses moteurs, nucléaire inclus. Encore une fois, ceci est parfaitement inscrit dans l'évolution naturelle de toute espèce terrestre.
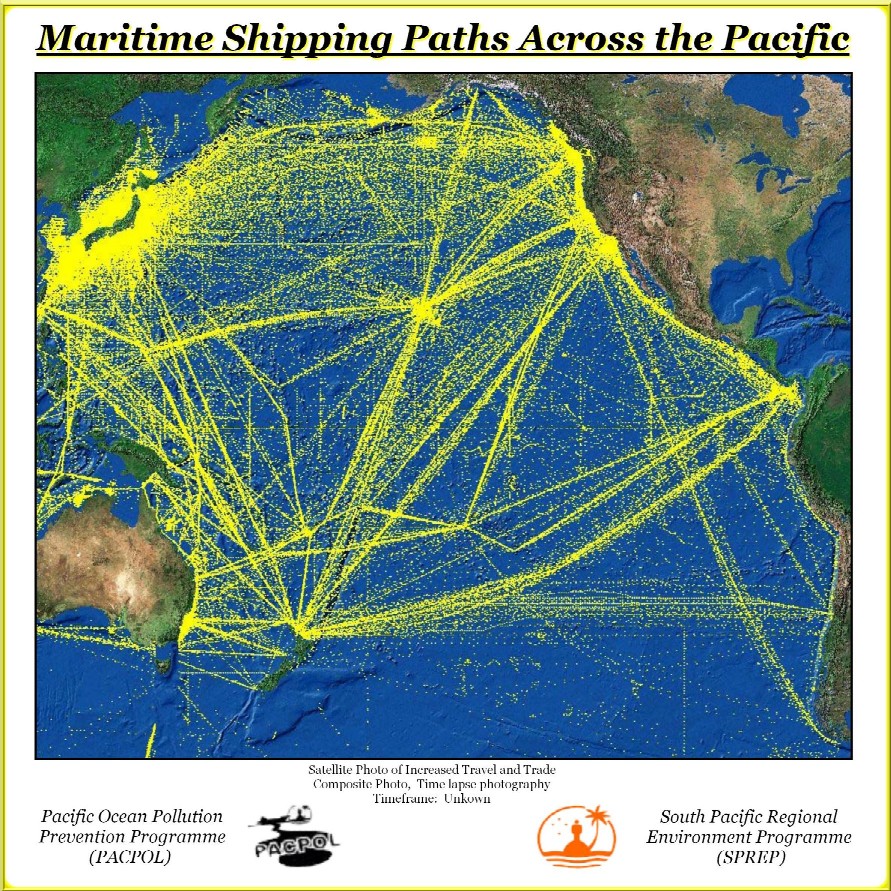
Photo satellite composite des trajets de navires dans l'océan Pacifique (d'avant 2010).
Chaque point jaune représente un navire au cours de son trajet.La période séparant deux points est inconnue.
La tendance générale de l'activité humaine est son uniformisation mondiale, y compris celle de sa coordination. Cette mondialisation est à la fois voulue et combattue dans l'humanité même mais ce sont forcément les méta-organismes les plus puissants et les plus évolués qui imposeront leur volonté même si celle-ci implique obligatoirement l'effondrement général de l'espèce, de la même façon que les premiers empires s'étaient effondrés à la mort de leur noyau politique. La grande différence avec les premiers empires est que si l'impact de leurs effondrement concernait essentiellement la survie de leurs populations, aujourd'hui l'effondrement d'un organisme supra-national implique aussi celui d'une bonne partie des écosystèmes qui lui servent de ressources, que ces écosystèmes soient humains ou naturels.
Une autre différence d'avec les premiers empires est que le contrôle exercé par chacun de ces méta-organismes, disons "industriels", ne concerne plus la totalité des activités humaines en un endroit donné mais seulement une partie spécialisée plus large et diffuse, les relations avec les autres parties étant "coordonnées" avec les autres éléments de ce méta-environnement (nations, états, multinationales et autres corporations ou entités infra ou supra-nationales, administrations incluses). Par exemple, la multinationale Monsanto a récemment été partiellement refoulée d'Europe par le Parlement Européen et de Russie par l'état russe. De même, la fin de la 2e guerre mondiale a vu le démantèlement de la multinationale IG-Farben sans pour autant entraîner l'effondrement de toutes ses structures, ni celui de toute l'Allemagne. Le système général est donc, à cause de sa plus grande complexité et de la plus grande spécialisation de ses structures, plus stable que ne l'étaient les premiers empires. Par contre, chaque entité suit toujours le principe fondamental de recherche de l'eutrophisation à tout prix et pour lui même, l'équilibre général était laissé "au hasard", lequel se fiche éperdument de la réussite ou de l'échec de l'espèce humaine comme de celui de toute la biosphère.
Les colonisations des grands industriels correspondent à une sectorisation de l'activité humaine en "marchés" plus sauvages entre eux et contre leur environnement que toutes les civilisations antérieures ont pu l'être vis à vis de leur environnement complet. C'est logique puisque ces méta-organismes sont plus récents que les autres : ils n'ont pas encore atteint un niveau de complexité-stabilité leur permettant de se modérer assez pour respecter durablement leurs ressources et leur propre survie.
Cette tendance a priori suicidaire est partiellement contre-balancée par des réactions "corporatistes" de certains ensembles ethniques, culturels ou sociaux victimes de cette mondialisation-là : les multinationales politiques, économiques et financières ont, en plus de leurs affrontements réciproques, à faire face à des mouvements sociaux de toutes tailles et issus de leurs excès, mouvements sociaux pour lesquels il n'existe pas encore vraiment de méta-organisme supra-national individualisé assez imposant pour faire efficacement face à ceux des deux autres forces.
Par contre, de telles structures sociales n'étant pas facilement à portée des moyens de contrôle des entités politiques et économiques (même si elles y travaillent d'arrache-pied), rien n'empêche vraiment leur apparition un jour prochain. Je note d'ailleurs que la généralisation d'Internet par quelques uns de ces méta-organismes économiques a provoqué la naissance des premiers méta-organismes sociaux diffus et supra-nationaux. Ces méta-organismes sont encore embryonnaires et fragiles, naturellement déjà cibles de la prédation de ceux bien établis dans les domaines politique et économique (SOPA, PIPA, HADOPI, ACTA, PRISM, ...) S'il en survit quand même, ce qui serait inévitable et naturel, leur structure ne pourra que respecter le schéma général de pseudo-écosystème qui s'est imposé partout ailleurs dans ce niveau de complexité, c'est à dire décliner le continuum comportemental en leur sein-même.
De toute façon, si l'espèce survit assez longtemps, l'apparition d'un méta-organisme diffus social et supra-national d'une complexité équivalente à celle des autres méta-organismes supra-nationaux (multinationales, FMI, ONU, OMS, ...) est inéluctable et ce sera une excellente chose pour la survie et la stabilisation de l'espèce même si ce ne sera en rien une garantie de bonne fin pour la biosphère : comme nous l'avons vu, depuis le tout début, tous les pas de la fractale de la Terre reposent sur 3 concepts complémentaires et, pour ce pas-ci, ces 3 dimensions sont l'économique, le politique et le social.
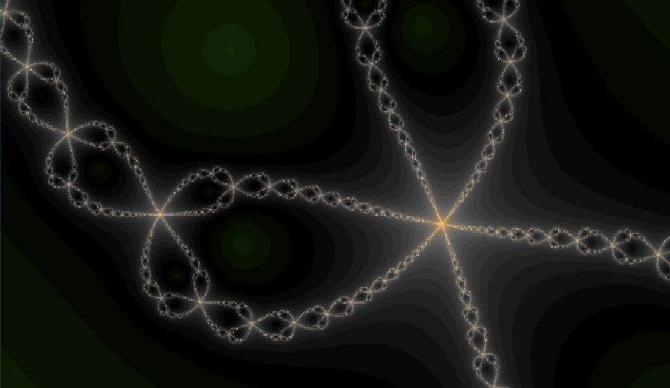
Le combat qui se joue depuis quelques décennies, le nœud de développement actuel de la fractale, est soit la poursuite de la route vers un équilibre mondial durable et de complexité supérieure, soit une eutrophisation sauvage totale qui sera forcément suicidaire à très brève échéance. Si "ça passe", alors la complexité devrait augmenter très vite car la quantité d'énergie solaire reçue est toujours la même alors que l'espace à coloniser n'existe plus, donc les ressources principales autres que le solaire sont toutes "métabolisées", en cours d'exploitation, de tarissement, d'éradication.
Ainsi et forcément pour chacun, de la même façon que l'agriculture avait libéré le temps, donc l'énergie, autorisant "enfin" la création de nombreux métiers (commerçants, artisans, artistes, ...), dans le contexte actuel l'objet de la nouvelle complexification sera de liberer encore plus de temps à chacun tout en réduisant encore les degrés de liberté individuels, en spécialisant encore plus les individus.
Dualité hétérogénéité -homogénéité
Dans l'instant, il me semble clair que l'humanité cherche son nouvel équilibre au moyen de structures supra-nationales. Le commerce avait, le premier, généré les premières multinationales tout comme les premières caravanes avaient généré autour des oasis les premières forteresses à l'intérieur desquelles les premiers gouvernements étaient nés, les premières cités constituées. De la même façon que ces premières cités s'inventaient, les premières institutions politiques supra-nationales se sont constituées sur les commerçants, la SDN évoluant en ONU après la 2e guerre mondiale.
Les organismes supra-nationaux politiques, économiques et financiers sont actuellement la majorité et les politiques ont tenté une déclinaison sociale (OMS, UNESCO, HCR, ...) sans toutefois parvenir à une efficacité suffisante pour garantir leur autonomie, ces structures-là sont totalement contrôlées par les méta-organismes commerciaux et politiques planétaires, elles en sont avant tout des émanations, des avatars.
En prolongeant la comparaison avec les premières cités, l'apparition des premiers authentiques méta-organismes sociaux "n'est pas urgente", puisque les premières grandes structures sociales autonomes ont été les dernières à apparaître, le social ayant très longtemps été atomisé entre les pouvoirs commerciaux, politiques et religieux comme si l'action sociale avait toujours été considéré par les autres pouvoirs comme une force menaçante.
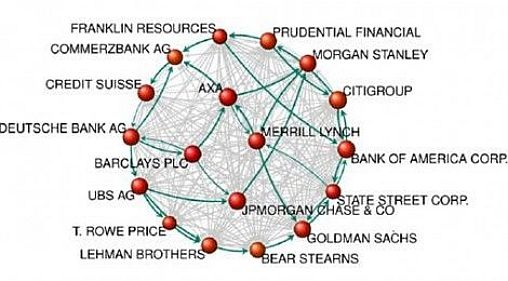
Les maîtres du monde
Les premières populations structurées étaient des sociétés à la fois paysannes et militaires. Produire leur était aussi nécessaire que piller. Issu des chasseurs-cueilleurs, ce comportement de production et de pillage a toujours perduré, il est le trait le plus marquant jusqu'aux colonialismes du XIXe siècle et il se prolonge aujourd'hui chez ces méta-organismes supra-nationaux. Il va sans doute se prolonger jusqu'à ce que de véritables régulations se mettent en place, ou bien jusqu'à ce que leurs excès et exactions déstructurent l'ensemble de la société et de la biosphère. Comme les impacts de ces structures-là sont immédiatement planétaires et tout aussi irréversibles que l'étaient ceux des premières cités, le droit à l'erreur est bien plus réduit qu'à l'époque primitive de l'humanité sociale : si certaines civilisations passées ont pu s'éteindre complètement faute d'avoir su gérer leur coordination interne et leur environnement, cette fois, vu que le domaine est mondial, il n'y aura pas de "terre à côté" d'où pourrait repartir l'humanité si elle échoue.

Si elle réussit, tout en restant dans le motif tripartite de la fractale générale, il est difficile d'imaginer ce à quoi elle va ressembler tant les possibilités sont nombreuses et les complexifications possibles diversifiées. Une chose me semble certaine toutefois : la valeur intrinsèque de l'individu ne peut que reculer encore, tout comme avait reculé la valeur individuelle d'une cellule au sein des premiers pluri-cellulaires.
En outre, de la même façon que dans un organisme pluricellulaire la génération de cellules de remplacement se fait au sein de chaque tissu, la génération des individus de chaque méta-entité se fait partout en même temps et chacun a pour l'ensemble une valeur réelle uniquement liée à sa fonction dans le tissu social, politique et économique. La grande différence entre un tissu pluricellulaire et ces "tissus sociaux" est que dans le tissu cellulaire la loi de sélection de parentèle n'a pas lieu d'être puisque le patrimoine génétique est strictement identique entre toutes les cellules alors que dans le "tissu social" elle s'exerce à plein comme nous l'avons vu. Il est donc impossible que les tissus sociaux atteignent une homogénéité analogue. N'importe quel tissu social ne peut que se décliner en fractale autour du continuum comportemental.

Quelle sera la solution permettant de passer quand même à un niveau de complexité supérieur ? Je n'en ai aucune idée et pourtant il est évident que tout pousse dans cette direction ! Comme nous l'avons vu avec la limitation imposée par la consanguinité, il n'y a pas de source génétique unique dans la population. Or, vu la natalité générale, les regroupements sociaux unifiés perdurent et grandissent quels que soient les massacres subis : les plus de 22 millions de morts de la dernière guerre mondiale ont été compensés par les naissances en un peu plus de deux mois et ceux de Syrie et des guerres ou autres "révolutions arabes" ou d'ailleurs sont actuellement largement compensés "au fil de l'eau", en quelques secondes.
Je ne sais pas et je ne peux pas savoir quel sera le prochain pas de notre fractale mais je pressens que la direction générale de la biosphère est de tendre vers une sorte d'organisme planétaire unique, d'une complexité bien plus grande que celle d'aujourd'hui et ayant trouvé comment s'adapter à la fois à l'apport continu d'énergie solaire et céleste, au recyclage complet de ses propres déchets et aux changements climatiques sur lequel il n'aura pas de prise. Il n'est pas du tout nécessaire à ce peut-être futur hyper-organisme d'avoir la conscience au sens où nous l'entendons pour nous mais comme nous participons d'une certaine façon à sa genèse, il est probable qu'il en ait une, au moins pendant un temps (il s'en débarrassera si ça ne lui sert à rien).
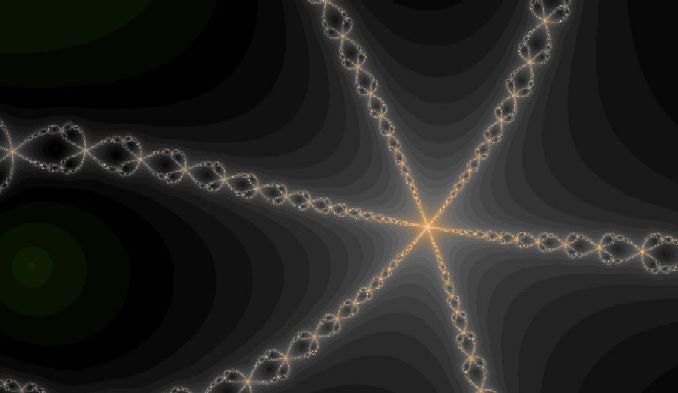
Je ne sais pas non plus si la biosphère arrivera à approcher cette sorte de climax, de cette façon-là ou d'une autre, ou si elle aura implosé avant à cause de nous ou après nous. Il est certain en tout cas que le soleil va continuer de briller, que ses rayons continueront d'alimenter la Terre en énergie de façon continue et que cette énergie restera captive à la surface de la Terre tant que l'atmosphère terrestre et ses boucliers chimiques et magnétiques ne seront pas déstructurés. Par conséquent, l'entropie générale de la couche atmosphérique terrestre continuera à aller vers sa diminution alors que celle de l'univers continuera d'augmenter.
En d'autres termes, la complexité de la vie sur Terre est vouée à augmenter indéfiniment sauf à ce qu'elle entre en auto-combustion elle-même ou meure des transformations que sa propre existence aura imposé à toute la Troposphère, depuis le sol jusqu'à la stratosphère.
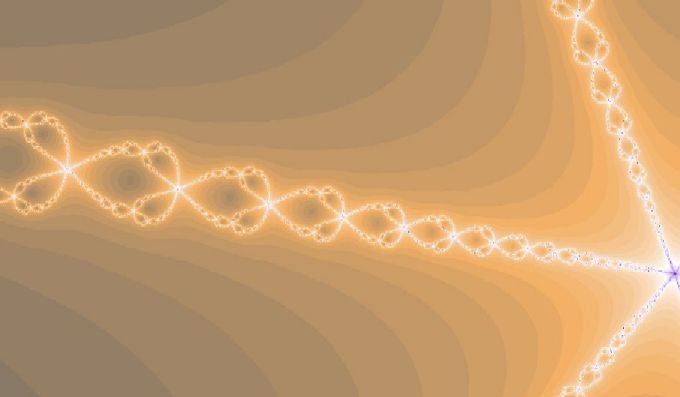
À travers nous, la fractale elle-même cherche à tendre vers l'eutrophisation générale mais si, comme nous l'avons vu, l'eutrophisation est un moteur fondamental de la survie dans la biosphère, elle devient aussi un moteur de l'extinction lorsque tous les facteurs limitants sont dépassés par la puissance biologique de l'espèce en explosion, celle-ci étouffant alors dans ses déchets, ses maladies et parasites et mourant de l'épuisement de ses ressources. Ensuite, comme nous l'avons vu, l'homogénéité qu'elle crée sert de terreau aux espèces "suivantes" et l'ensemble du milieu change d'état à l'intérieur d'une série écologique devant aboutir au climax, à un équilibre stable.
La courbe de la natalité humaine indique clairement que l'espèce humaine est au seuil de son déclin : une exponentielle aussi abrupte est rare et ne laisse pas beaucoup de temps pour que l'espèce puisse s'adapter aux changements qu'elle induit dans son environnement. Les grandes "erreurs" que l'humanité commet depuis la révolution industrielle me semblent principalement être :
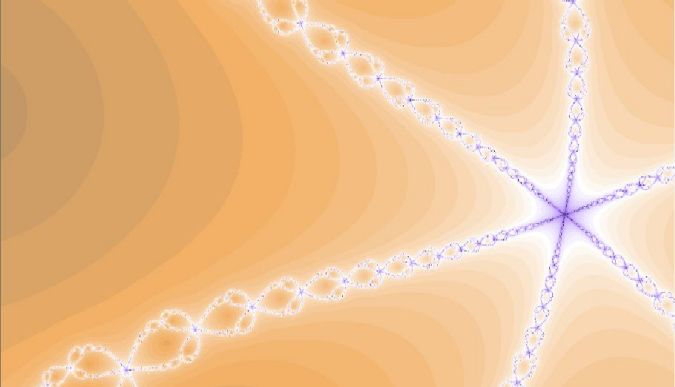
Comme nous l'avons noté, l'évolution démographique humaine depuis 1850 est dans sa phase exponentielle et celle-ci est d'une violence rare.
En son temps, c'est à dire lorsque les premiers des démographes à avoir noté le fait l'ont rapporté en sonnant l'alarme, beaucoup de pays ont, un temps, vu le danger et tenté de prendre des mesures pour ralentir la catastrophe, la Chine de Mao avait, en particulier, instauré une limitation drastique des naissances à un enfant par couple et cette limitation est toujours d'actualité aujourd'hui. Comme ce pays est aussi un des plus peuplés du monde et qu'il se limite depuis les années 60 avec plus ou moins de succès, cette politique donne un répit certain à l'ensemble de l'humanité mais comme c'est le seul pays au monde à avoir compris le danger, cette période de répit sera terminée dès qu'il ne fera plus masse dans l'ensemble de la population humaine : la partie de l'explosion démographique que bride la Chine deviendra insignifiante dans l'accélération exponentielle générale déjà faramineuse de l'espèce.
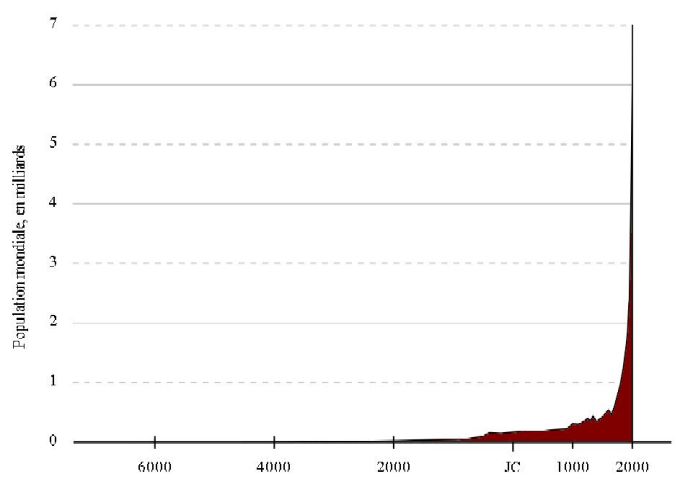
Lutter contre la natalité est pratiquement impossible car c'est s'attaquer à l'essence même du réflexe d'eutrophisation, lui-même base fondamentale de la vie sur terre comme nous l'avons vu. Ce réflexe est profondément enfoui dans le cerveau ancestral humain et le cortex a encore aujourd'hui une prise trop limitée dessus. En effet, comment comprendre sans éducation poussée que le réflexe qui a jusqu'ici assuré la prospérité de l'espèce est à présent la première cause de son extinction ? Ce retournement de valeur à 180°, même s'il est naturel et, corolaire de sa redoutable efficacité, facile à expliquer, n'est pas et ne semble pas devoir être partagé à temps entre suffisamment d'humains :
L'idéal aurait été que l'espèce humaine comprenne et se "stérilise" d'elle-même jusqu'à ce que la population mondiale redescende à un niveau permettant d'assurer sa survie sur toute la terre et qu'ensuite elle reprenne sa natalité à un rythme tel que les effectifs mondiaux restent à peu près stables, si possible en légère diminution pour s'éloigner dans la bonne direction de l'équilibre de Pareto. Or, nous ne sommes pas équipés pour un tel changement, tant physiquement que psychiquement, tout simplement parce que, à l'instar de la majorité des espèces vivantes et éteintes, notre espèce n'est jamais arrivée à ce seuil depuis son apparition, donc n'a jamais été confrontée à la nécessité de mettre en place un tel mécanisme de régulation en son sein. Or, l'énergie à déployer pour en créer un est proportionnelle à l'effectif de l'espèce et celui-ci est en pleine explosion exponentielle.
Sur ce plan, l'avenir de l'espèce humaine est, donc et hélas, évident. Tout ce qui suit n'en est que la conséquence.
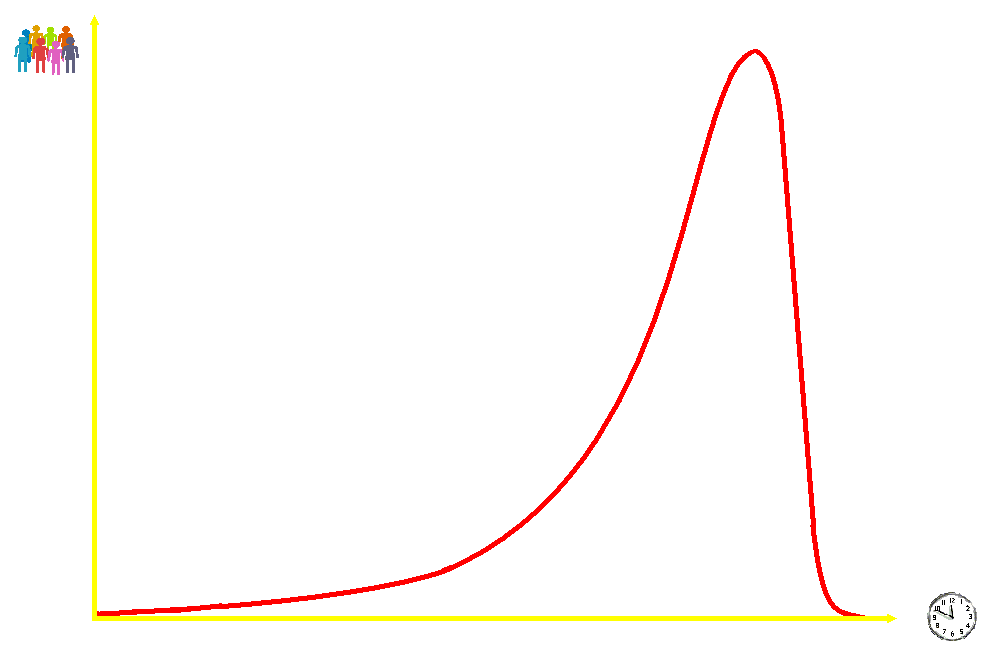
Le sujet est à présent connu bien que ses détails échappent à la plupart des gens qui en sont conscients. Il rappelle et confirme pour notre espèce l'évolution d'une eutrophisation en phase terminale telle que je l'avais décrite dans le chapitre précédent, paragraphe "F- Cybernétique du vivant"
Les limites commencent à être connues avant que nous les touchions, ce qui est apparemment aussi une première dans l'histoire de la biosphère mais ne garantit absolument pas un changement de cap de cette évolution. Comme le disait C.G. Jung dans son domaine, "ce n'est pas parce qu'on connaît la cause de son problème qu'on lui trouve une solution". Concernant les minéraux les plus utilisés, le planning semble être le suivant :
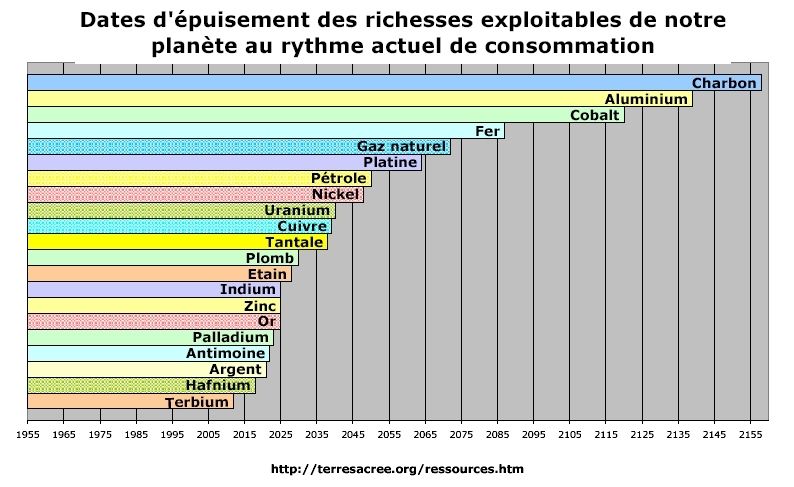
Nous sommes en 2013, la première pénurie est pour maintenant et le processus va rapidement s'accélérer. D'ici 20 ans, la moitié des éléments minéraux que nous utilisons vont devenir très rares. Le pétrole aura été pratiquement totalement brûlé dans 30 ans, le gaz naturel dans 50 et ceci à condition que notre effectif global n'augmente pas encore plus rapidement (ce qui est pourtant le cas) et que nos industries n'accentuent pas plus leur pression sur ces ressources-là (ce qui est vraiment peu probable).
Outre de réduire de façon significative l'effectif de l'humanité et sa consommation d'énergies fossiles, une solution pourrait être de chercher à prendre l'énergie à sa source et sans massacrer le reste de la biosphère qui en dépend mais en avons-nous encore le temps ? Le mirage du nucléaire semble toujours être pris sérieusement comme efficace et va faire perdre un temps maintenant précieux en plus de démultiplier en exponentielle également les problèmes qu'apporte le feu nucléaire à toute la biosphère. Tchernobyl et Fukushima ne sont vraisemblablement que des signes avant-coureurs de désastres plus massifs maintenant que la majorité des centrales nucléaires du monde commence à se déliter dans le silence ouaté d'une censure gérée par les super-organismes humains qui en vivent et qui se situent dans le continuum comportemental plutôt du côté des prédateurs et parasites.
Ce temps perdu ajouté à d'autres délires écologiques comme la fracturation des schistes pour expurger les dernières gouttes de pétrole ne fera qu'aggraver encore plus l'inévitable crise tout en la repoussant à peine pour la porter à un moment où toute conversion encore possible alors aura au minimum beaucoup de mal à s'effectuer à temps pour que l'effondrement ne soit pas profond et général.
De plus et vu la puissance de l'exponentielle démographique, mettre des écrans de capteurs solaires sur toute la surface de la Terre dans le but de pouvoir assurer au minimum la continuité de l'alimentation énergétique de toute l'humanité génèrerait forcément une autre crise grave par compétition avec les terres cultivables. La solution de positionner ces centrales dans l'espace est réelle mais son coût d'installation, d'entretien, de recyclage et de surveillance demande d'utiliser des technologies suffisamment fiables qui n'existent pas encore et qui seront difficiles à élaborer à temps, c'est à dire d'ici au minimum 30 ans et au maximum 50. Ceci reste néanmoins à mes yeux pour l'instant le seul espoir énergétique sérieux, sauf grand miracle. Je ne vois néanmoins pas vraiment de signe marquant que cette solution-ci soit réellement et sérieusement envisagée à temps.
Côté agricole, le tableau est tout aussi sombre : les traficotages génétiques et biochimiques en cours depuis au moins un demi-siècle ne polluent pas seulement l'environnement, ils désintègrent aussi une bonne partie de la stabilité des génomes, le nôtre inclus, substituant à ces génomes fiables, issus d'une expérience plus longue que l'histoire de l'humanité et vis-à-vis desquels la biologie humaine est adaptée, des "essais" de manipulations génétiques récents, peu éprouvés et pour lesquels les preuves de nocivité sont de plus en plus nombreuses. Ceci alors qu'il est scientifiquement parfaitement acquis que l'adaptabilité métabolique des organismes pluricellulaires est inférieure à celle des unicellulaires, pour des raisons évidentes de complexité interne et que, justement, nous labellisons surtout comme "ravageurs des cultures" des organismes unicellulaires, bactéries, moisissures, c'est à dire les plus souples, ceux s'adaptant le plus vite.
Donc, limiter maintenant cet espace agricole pour le remplacer par des centrales solaires ou/et des cultures nocives (OGMs) voire stupides (biocarburants, huile de palme, etc.) fait entrer toute l'humanité dans une contradiction qui, tout en se déclinant encore en fractale, ne peut qu'aboutir à des désastres humanitaires d'une ampleur encore inimaginable aujourd'hui et contre lesquels nous seront désarmés par manque de temps et d'expérience sur ces "nouvelles technologies" et leurs conséquences néfastes, donc ignorants des conduites à tenir pour y parer.

Ce sujet aussi est très connu, tout simplement parce qu'aujourd'hui il n'existe pratiquement personne n'y ayant jamais été confronté, nulle part au monde, mais s'il n'est plus une surprise pour personne, son ampleur, elle, n'est pas réalisée à sa réelle mesure.

Nos déchets ne sont pas seulement "encombrants", visibles, ils sont aussi pour beaucoup invisibles et pernicieux. Polluer, c'est diffuser dans l'environnement des matières et des molécules difficilement recyclables par la biosphère ou/et qui lui sont toxiques. Ces toxicités sont de différents ordres, s'étalant depuis des blocages mortels de la physiologie des organismes, des stérilisations massives et rémanentes, jusqu'à des saturations de l'espace de vie de ces organismes. Ceci inclus, évidemment, les pollutions tant synergiques que celles en cascade, c'est à dire d'une part celles dont les effets sont démultipliés par la présence conjointe d'un ou plusieurs polluants (p.ex. hormones et IGRs, neurotoxines, radionucléides, etc.) et d'autre part celles induites par les changements que ces polluants imposent à l'environnement (p.ex. CFC et ozone, OGMs).

Pollution du fleuve Yang-Tse
Les pollutions "invisibles" sont évidemment les plus incontrôlables mais celles visibles ne sont pas mieux gérées pour autant. Si le recyclage des macro-déchets est commencée dans certains pays depuis la fin du siècle dernier, les quantités non gérées tant de ceux déclarés recyclables que des autres sont astronomiques et évoluent toujours de façon exponentielle.
Je ne peux, de plus, m'empêcher de penser que tous les efforts individuels faits par certains, nombreux, pour réduire leurs propres déchets et limiter leur utilisation de non recyclables sont largement dépassés d'une part par l'arrivée constante de nouveaux individus qui ne prennent aucune précaution particulière et d'autre part par une industrie qui, pour tenter de maintenir et d'élargir son marché, n'a aucun scrupule à fabriquer et intégrer des polluants souvent inutiles dans l'utilisation stricte de leurs produits. Il me souvient, pour exemple, d'une époque où certains producteurs de sirops avaient tenté d'enlever les colorants de leurs bouteilles mais la loi du marché les avait fait abandonner ce comportement en un an ou deux parce que la clientèle s'en détournait alors et les colorants sont revenus dans leurs bouteilles.

Fukushima 2011..2051 (minimum).
La partie la plus visible de ce monstre de déchets est dans les plastiques bien que je n'ai pas la conviction que ce soit la plus importante. Il s'agit néanmoins de milliards de tonnes par an qui sont rejetées anarchiquement dans la biosphère et qui, à l'instar des pollutions plus ou moins flottantes générées par les algues dans les marigots eutrophes, se rassemblent et s'accumulent en masse dans les endroits tranquilles où les courants aquatiques ou aériens les rassemblent. L'apparition du 6e continent est ancienne mais sa médiatisation est récente, comme nous l'avions vu dans le chapitre sur l'eau :
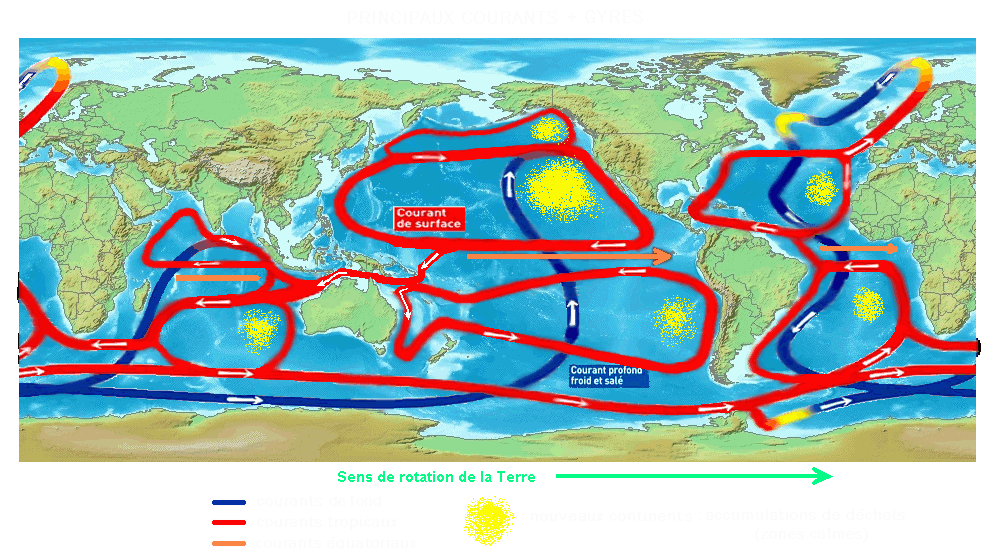
Lorsque j'ai appris l'existence de cette monstruosité, j'y ai immédiatement pensé comme un signe d'eutrophisation planétaire et, en poursuivant ma réflexion, je me suis demandée en combien de temps nous allions totalement en couvrir la surface des océans, chose qui m'a rappelé une constatation faite à la fin des années 70, disant que la totalité des mers du globe était recouverte d'un film de pétrole de quelques microns d'épaisseur et que ce film isolant gênait déjà à l'époque la respiration générale des océans. Il est probable qu'aujourd'hui cette couche soit plus épaisse tout en commençant à être radioactive et à concentrer beaucoup des molécules faiblement hydrophobes que nous balançons par tonnes chaque jour, hormones incluses. Je n'ose imaginer l'ampleur des concentrations de macro-déchets dans les endroits où la nature a tendance à les regrouper. Je n'ai aucune idée de la façon par laquelle on pourrait les réduire et, pour une grande part, les recycler. Quelle tâche pire que de devoir filtrer la totalité des océans de la planète bleue, le tonneau des Danaïdes ?

La gyre de déchets du Pacifique Nord est la première en taille.
Une des conséquences manifestes de cette gigantesque et irréversible eutrophisation est l'inéluctable effondrement des écosystèmes terrestres et marins, forcément accéléré aussi par notre pillage continu et de plus en plus intense du monde marin vivant. De nombreux signaux d'alarme s'accumulent de façon de plus en plus rapprochée depuis plusieurs décennies, tels la désertification de zones autrefois poissonneuses ou la disparition des insectes (Il n'y a pas si longtemps, tout trajet en voiture de quelques dizaines de kilomètres maculait le pare-brise d'insectes. Ce n'est plus le cas aujourd'hui quasiment partout au monde.)
En outre et en toute logique, si notre contamination concerne d'abord la biosphère terrestre et marine, en tant qu'organismes vivants nous polluons forcément tous les milieux que nous touchons, fussent-ils extraterrestres. Nos traces sur la Lune ne se résument pas à celles des pas des cosmonautes et de leurs appareils, leurs déchets y sont toujours et ils ne sont pas tous neutres.
Évidemment, l'espace qui nous sépare de l'astre de la nuit est bien plus pollué de tout ce que nous y avons expédié et laissé, volontairement ou pas.
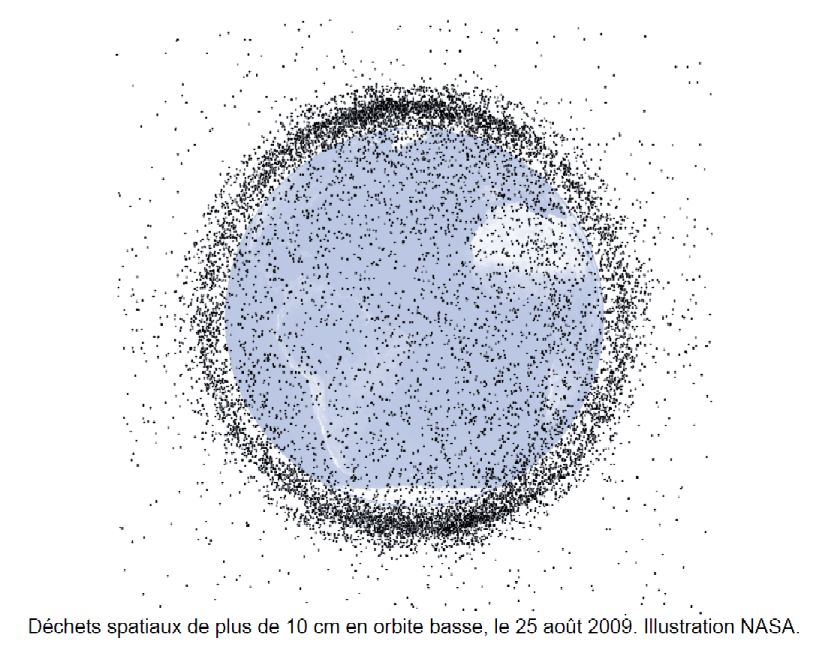
L'eutrophisation humaine atteint l'espace depuis le premier lancement de fusée réussi. Or, si cet espace est infiniment plus grand que la couche viable de la Terre, il est également essentiellement vide. Donc, tout ensemencement par le plus petit de nos déchets y est immédiatement très significatif. Comme cette façon de voir est systématiquement oubliée par ceux qui ont les moyens d'aller y jouer, l'espace proximal de la Terre (Mésosphère et Stratosphère) est significativement alimenté par nos ordures dont beaucoup sont extrêmement radioactives de la pire manière qui soit.
Or, si la gravité est la loi qui explique et permet la mise en orbite "définitive" d'un certain nombre de nos productions, elle est aussi celle qui en assure le retour à terme. Malheureusement, les productions humaines envoyées dans l'espace contiennent très souvent les pires des nucléides possibles : Plutonium, Uranium, Americium, etc. Comme la loi de la gravitation s'applique à eux aussi, la Terre est plus ou moins régulièrement arrosée de débris hautement radioactifs plus ou moins atomisés pendant leur incandescence durant la traversée de l'atmosphère, incandescence qui n'en réduit malheureusement pas la radioactivité initale d'un iota :
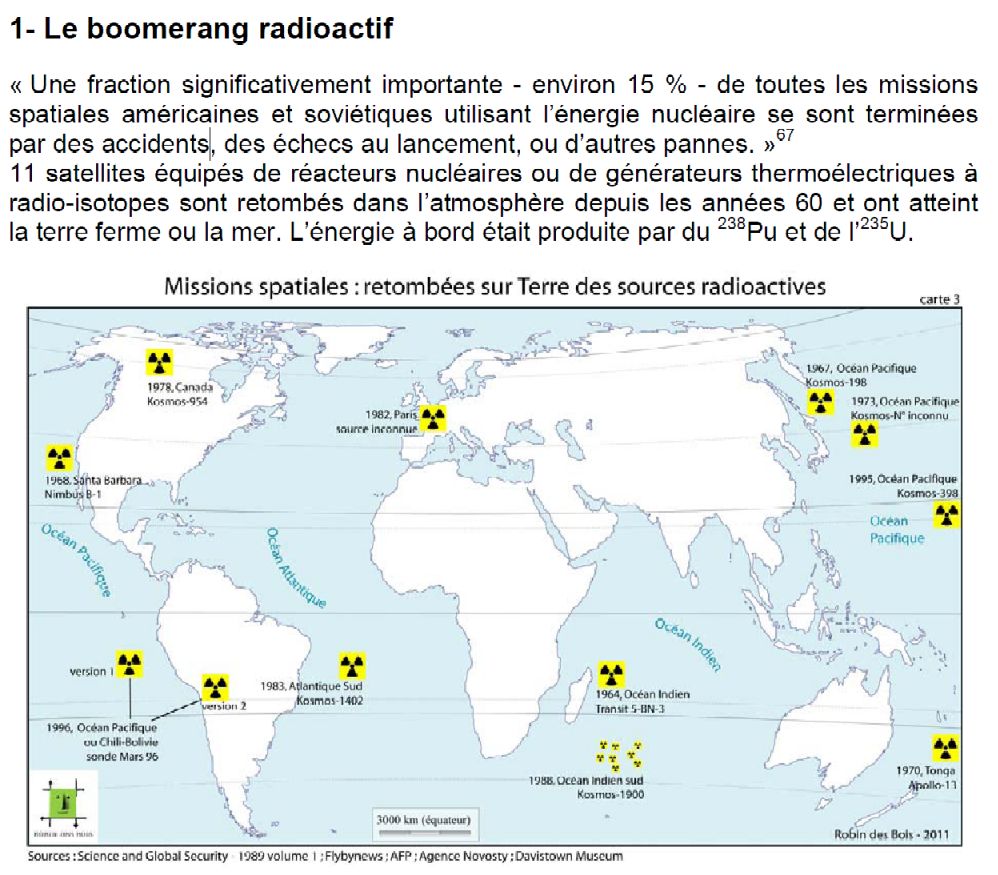
Comme cette diffusion générale de déchets le démontre, l'espèce humaine est actuellement la plus puissante de toutes mais sa nouvelle puissance depuis la révolution industrielle est telle que l'ensemble de la biosphère doit s'y adapter ou en mourir. Comme cette révolution date, en gros, de 1850 et que l'échelle de l'évolution de la biosphère se compte plus en millénaires et millions d'années qu'en siècles ou décennies, la biosphère n'a pas les moyens et le temps de se maintenir sans changer profondément d'état, sans repartir gravement en arrière et dans un milieu totalement nouveau pour elle (métaux lourds, molécules nouvelles, hormones artificielles, radioactivité bien plus intense d'éléments qui étaient rares depuis plusieurs ères géologiques, etc.)
L'inéluctable changement d'état de toute la biosphère est à présent attendu, suivi, étudié et même planifié par les scientifiques qui sont suspendus au signal d'alarme depuis quelques décennies sans que les populations et leurs politiques n'aient encore réellement écouté et compris la nature et surtout l'intensité de ce qui est en train de se passer, qui menace toute l'espèce humaine d'extinction prochaine :
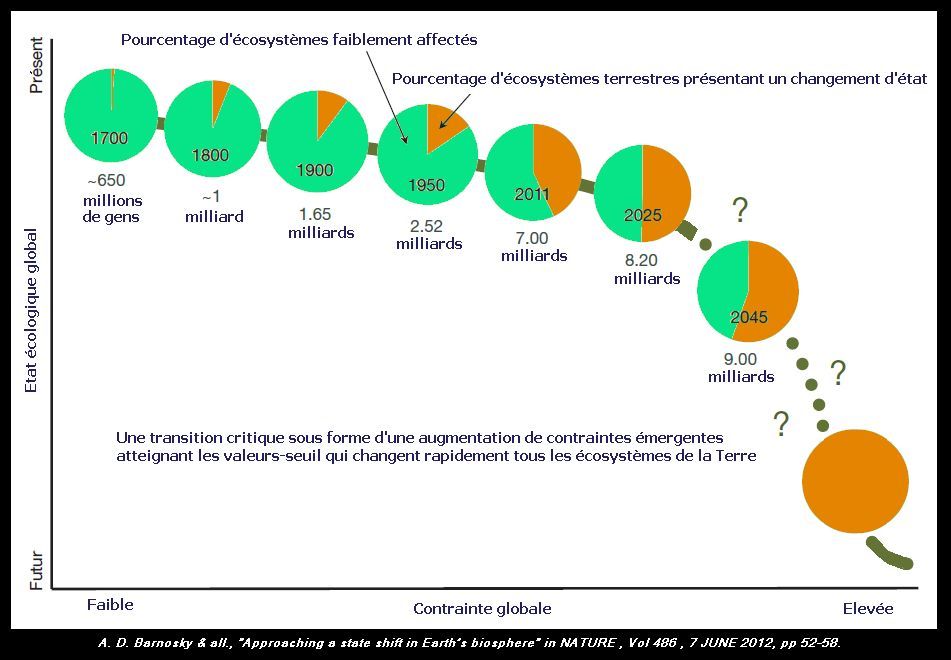
Il me semble de plus en plus probable que si la religion avait créé des peurs irrationnelles sur une fin du monde pour l'an mil, puis l'an 2000, la période entourant l'an 2100 a toutes les chances de correspondre à la fin de l'extinction du genre humain si celui-ci reste aussi impassible et amorphe devant ses propres destructions et contradictions.
"Ce qui ne nous détruit pas nous rend plus forts", un dicton fréquent et que j'ai toujours trouvé spécieux derrière sa part de vérité, spécieux par son apparente ignorance de toute limite alors que le monde vivant est tout sauf illimité : il suggère, un peu comme l'histoire du type qui vide le distributeur de boissons parce que "tant que je gagne, je joue", que tout est permis, que seules les conséquences personnelles de nos actes ont de l'importance.

L'auto-prédation humaine est partout car elle est une conséquence de l'omniprésence de la consanguinité chez les humains. Cette opposition entre la compétition naturelle entre génomes individuels et le tronc commun majoritaire du génome humain entretient la dualité égoïsme-altruisme dans la société humaine et barre totalement la route vers une eusocialité telle que pratiquée chez les arthropodes.
En bonne dualité, elle se décline en fractale de comportements et d'actions à travers lesquels la socialisation générale tente de se maintenir. C'est une réplique du continuum comportemental général mais à l'intérieur même de l'espèce.
De plus, contrairement à la déclinaison inter-spécifique, les comportements sont extrêmement labiles à l'intérieur même de l'espèce, chaque individu pouvant passer, selon les circonstances et en quelques secondes, de n'importe quel comportement à son antithèse, de la symbiose à la prédation, de l'égoïsme à l'altruisme, du commensalisme au parasitisme, etc. Peut-être est-ce un front de cette partie de la fractale et sa versatilité une garantie de futures déclinaisons (je me demande d'ailleurs si les coacervats n'avaient pas cette labilité dès le moindre changement mineur de leur environnement proximal) mais si l'effet de masse de ces comportements est effectivement une main-mise quasi-totale sur tous les flux d'énergie, il agit en respectant à la lettre le principe d'eutrophisation et en le poussant au maximum de façon quasiment incontrôlable. Ceci fait qu'il ne tient aucun compte des limites des flux d'énergie, de leurs points de rupture et c'est bien là le danger.
De la même façon que les algues d'un marigot finissent par s'asphyxier et transformer de leurs cadavres leur milieu en réservoir de boues puis en terreau, laisser ce continuum sans contrôle entre les humains les asphyxie eux-mêmes en cassant tous les flux d'énergie qui les alimentent. Sur ce plan, l'histoire de l'île de Pâques est un exemple miniature de ce qui est en train d'arriver sur toute la terre. Comme, ainsi que nous l'avons vu, il n'existe aucun méta-organisme social humain (que ce soient des structures économiques, politiques ou sociales), ne respectant pas en son sein la déclinaison du continuum comportemental et la recherche de sa propre eutrophisation, il n'existe aucun système permettant de le contrôler au sein de l'humanité : contrairement aux eu-sociaux vrais, l'humanité n'a pas développé de moyen de contrôle de son auto-prédation et de son eutrophisation externe ou interne.
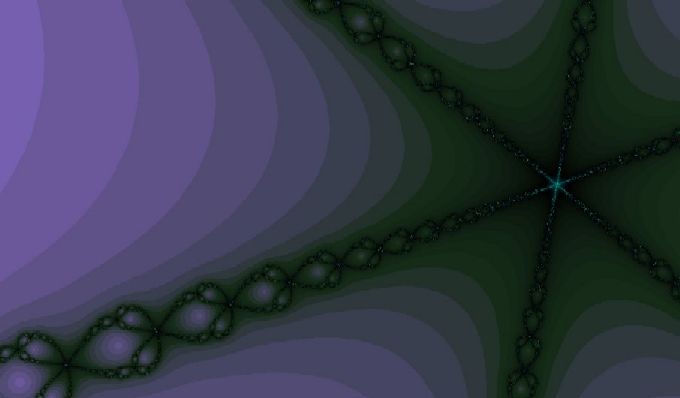
L'aspect fractal est d'autant plus incontrôlable qu'il décline plusieurs dualités autour de celle de l'altruisme-égoïsme : parenté-ostracisme, stabilité-opportunisme, coopération-prédation+parasitisme, création-destruction, etc. Les exemples de l'aspect fractal autour de ces dualités sont légions et nous baignons tellement dedans que nous n'en remarquons que les moins étouffés des plus caricaturaux (affaires du sang contaminé, des vaccins contre le H1N1, scandales Garantie Foncière, Ligue contre le Cancer, Monsanto, Spanghero, Emprunts toxiques, Bhopal, Fukushima, génocide rwandais, guerre "civile" de Syrie, guerre d'Irak, etc, etc, etc.)
Le noeud fondamental de tous ces drames repose sur la déclinaison du parasitisme social et de la prédation intraspécifique à l'intérieur même des méta-organismes, chose qui se manifeste y compris chez ceux conçus au départ pour les réguler (lobbyisme et noyautages des ONU, OMS, FDA, IRSN, etc.) Il n'existe donc aucun organe de contrôle réel des points de rupture du milieu par rapport à la survie de l'espèce, même si certains de ces méta-organismes au départ de contrôle obtiennent de temps à autres des résultats très partiels (interdiction des OGMs en Europe, contrôle des banques en Islande, moratoire mondial sur la pêche à la baleine, interdiction des CFC, etc.) : l'exception n'est pas la règle, tout au plus peut-elle servir d'argument à ceux qui abusent pour en justifier l'absence. Je ne vois aucun signe patent d'un quelconque changement sur ce plan-là.
La non-gestion de l'auto-prédation et de l'auto-parasitisme, tout en nous assurant de l'exploitation immédiate la plus totale possible du moindre flux d'énergie disponible est notre meilleure garantie d'extinction.

Charnier rwandais.
La survie d'un génome reproduisant en lui-même la complexité des relations d'un écosystème est une voie d'apparence nouvelle pour la biosphère, à moins que tous ceux qui s'y sont déjà essayés s'en soient éteints. Nous ne savons pas si une solution viable et pérenne peut exister mais nous avons la liberté d'exploiter toutes les solutions possibles pour éventuellement en trouver une.
Le problème est que toutes les formes de structurations élaborées autour des individus se comportent toutes comme des méta-individus et, chacune cherchant l'eutrophisation pour son propre compte, éliminent systématiquement les plus faibles, qu'ils le soient intrinsèquement à cause des contradictions dans leur structure ou bien uniquement parce qu'ils sont plus jeunes, plus petits, même s'ils seraient plus compétitifs qu'eux à taille et maturité équivalentes. La conséquence de cette sorte de "droit d'aînesse" des méta-organismes humains entre eux est que l'évolution naturelle ne sélectionne pas "les plus aptes" mais, sauf exception, les plus chanceux parmi ceux "de qualité inférieure aux plus aptes". Comme tout rassemblement humain légèrement coordonné et structuré constitue un méta-organisme, ce phénomène se manifeste aussi entre les cultures et les civilisations dès qu'une différence survient, même minime.
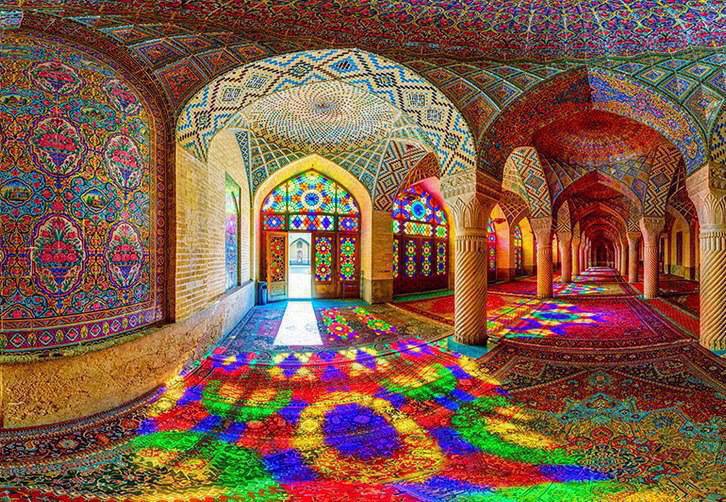
Mosquée Nasir Al-Mulk - Shiraz - Iran
(Ceci n'est PAS une image de synthèse bien que la fractale soit évidente.)
C'est une sorte d'application du dilemme des marchands de glace, la recherche de la stabilité par rapport au "marché" amenant l'ensemble à se rapprocher d'une homogénéité centrale comme si les éléments étaient attirés les uns vers les autres par une sorte de gravitation bien que repoussés par leurs différences, comme s'ils étaient de même charge électrique : les électrons se supportent mutuellement deux par deux à condition de ne pas tourner sur eux-mêmes dans le même sens, les protons ne restent ensemble qu'au prix d'une énergie nucléaire faramineuse, les cultures coexistent, entre autres, en n'écrivant pas avec les mêmes caractères et en ne les alignant pas dans la même direction : européen, arabe, chinois. Dans tous les autres cas ces entités se repoussent, se combattent ou s'éliminent les unes les autres.

Les croisades, en tant que choc de cultures ancien.
L'élimination de la diversité culturelle stérilise les possibilités de survie puisque toute solution mieux adaptée que la dominante est défavorisée à la naissance. En effet, quelle que soit la culture non dominante, elle est minoritaire avant de se déployer. Jusqu'à présent elles n'ont pu le faire qu'en étant suffisamment isolées des plus grandes mais maintenant que la mondialisation est en marche, ce n'est plus possible (cf. Optimum de Pareto). Si une nouvelle solution plus adaptée à la survie globale est trouvée où que ce soit, elle ne peut plus s'imposer à cause de la pression des cultures existantes, elle a toutes les chances d'être éliminée "dans l'oeuf". Quant aux cultures minoritaires au moment du déploiement de la mondialisation, elles ont aussi toutes les chances de s'éteindre soit par génocide, soit par "intégration", c'est à dire par implosion et phagocytose. L'histoire est particulièrement dense d'exemples depuis le début de la révolution industrielle du XIXe siècle.
.jpg)
Exécutions de Juifs de Kiev par les unités d’extermination mobiles allemandes (Einsatzgruppen) près d’Ivangorod (Ukraine).
Le but ici est de tuer deux personnes avec une seule balle.
La photo fut envoyée en Allemagne depuis le front de l'Est et interceptée à un bureau de poste de Varsovie par un membre
de la Résistance polonaise nommé Jerzy Tomaszewski.
L'inscription originale [en allemand] au dos de la photographie est : « Ukraine 1942, Action juive [opération], Ivangorod. »
Ce que nous montre aussi l'histoire de la mondialisation, née en même temps que le moteur à explosion, est que les grandes cultures capables de coexister occupent des territoires différents au départ, mais dont les limites sont de plus en plus floues, tout en se concentrant actuellement en 5 grands "pôles" culturels :
Les deux derniers ont subi une très violente colonisation occidentale et en ont perdu beaucoup de leur identité. Tout porte à croire qu'ils sont voués à "s'intégrer" dans la civilisation occidentale au niveau de ses valeurs primaires en ne gardant que quelques reliques de leurs valeurs originelles. Les trois autres semblent avoir atteint une taille relative suffisante pour ne pas être absorbées par l'une des deux autres mais c'est très difficile à affirmer car elles s'interpénètrent de plus en plus. Je ne sais pas s'il en sortira vraiment une culture mondiale homogène mais il me semble que c'est bien la direction suivie.
La "loi de la gravitation" des marchands de glace couplée au principe d'eutrophisation tend à ne sélectionner et imposer partout qu'une seule et même culture. C'est bien ce qui se passe mais, de fait, la solution dominante actuelle prouve très clairement à présent qu'elle conduit à une eutrophisation incontrôlée, donc à la mort de toute la population humaine mondiale.

Une mare au dernier degré d'eutrophisation
(Prises dans les algues, des bulles de méthane,un gaz issu ici de la décomposition de cadavres divers, végétaux et animaux)
Le mécanisme qui impose une culture sur une autre me semble reposer sur la loi de Nielsen (90-9-1), que je relie à celle dite "du moindre effort", et celle de la sélection naturelle ou de l'instinct de conservation. La première explique que la diffusion des changements se fait lorsque le plus grand nombre les suit (d'où certaines colonisations en cours par implantations massives), la seconde (au sens le plus darwinien du terme, la survie des plus forts même si ce ne sont pas les plus aptes) explique la marginalisation en fossilisation voire extinction des anciennes valeurs. C'est un peu comme dans une fractale lorsqu'on repousse les variations aux marges pour former une zone "stable", c'est à dire homogène, plate et vaste alors que la création (par les différences) reste sur les marges.
La possibilité de changer le cours des choses actuel me semble donc peu probable bien que les changements soient toujours présents aux marges des grands blocs et que l'un ou l'autre peut soudainement évoluer au point de changer son homogénéité interne entièrement par une autre.

Libye, Djebel Nafusa, Ville de Yafran : peu avant la chute de Kadhafi, les cours de Tamazigh (= berbère) reprennent,
ils ont été interdits pendant 43 ans, depuis son accession au pouvoir par la force.
L'homme est un loup pour l'homme dit le proverbe mais même s'il est actuellement difficile de prouver que le loup est capable d'atteindre le niveau de cruauté humain, nous pouvons être certains que cette cruauté n'est pas une invention humaine. Notre espèce hérite sur ce plan aussi du savoir-faire de la biosphère en la matière.

Qu'avons nous donc réellement inventé ? La morale sans doute mais ce n'est pas une certitude absolue même pour elle : le tabou de l'inceste est un des piliers majeurs de la morale, il est issu de l'impossible consanguinité dont les effets néfastes sont largement présents chez la plupart des espèces. De plus, comme la notion de morale est encore didactiquement très floue et que la sociobiologie est une science balbutiante, il est très probable que de prochaines découvertes nous révèleront que cette notion n'est pas strictement humaine puisque la consanguinité est impossible ailleurs aussi et que notre ignorance est grande sur tout ce qui n'est pas "comme nous".
Qu'avons nous donc encore à inventer alors ? Si la morale est la chose qui cherche à atteindre l'équilibre général dans l'équité et le respect alors le chantier ouvert pourrait être, tout en garantissant la survie de l'espèce, d'inventer comment créer des structures sociales un peu plus immunisées à la naissance et sur la durée de leur vie contre ce que nous considérons comme des travers contre-productifs, des facteurs limitants, tels que le meurtre, la prostitution, l'exploitation, l'escroquerie, le détournement des ressources et des fonds, les génocides, bref, la partie parasitisme social et auto-prédation du continuum comportemental.
En avons-nous encore le temps ? À mes yeux, c'est la question qui se pose surtout car la saturation de la biosphère avec notre biomasse (natalité générale toujours plus galopante), nos déchets organiques et industriels (depuis les hormonaux jusqu'aux nucléaires) et l'épuisement de nos ressources (depuis l'eau potable jusqu'aux métaux) laisse penser que les changements que nous induisons dans l'environnement général ne permettront plus de maintenir notre espèce en vie très longtemps.
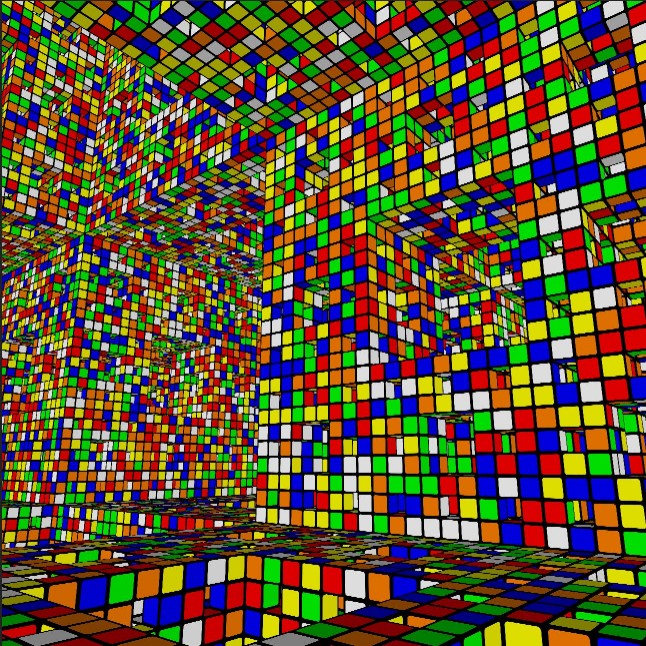
Fractale de Rubic : une métaphore sur la "simplicité" de notre situation
La vie continuera sans nous, la biosphère cherchera d'abord à "métaboliser" les dégâts, puis, ou bien en même temps, elle tentera à nouveau la dernière fractale, l'union générale du vivant en un seul organisme autosuffisant et en équilibre cybernétique dans les ressources et l'espace dont il dispose sur cette planète, si possible avant que le soleil se transforme en super-nova, ou bien un autre essai sera encore pire que le nôtre et elle en disparaîtra. Dans tous les cas il ne restera rien de l'humanité depuis bien longtemps et ce n'est pas notre problème. Les souffrances qui vont précéder notre prochaine extinction sont bien plus préoccupantes.
Côté théologique, s'il existe une divinité quelque part alors elle est encore plus loin de nous que ce que nous ne l'avons jamais imaginé : Qui a écrit la formule de la fractale de notre univers, sur quoi et d'où l'a-t-elle écrite puis lancée dans le réel ?
S'il n'en existe pas, cet univers reste absolument fantastique pour ce que nous en comprenons, c'est à dire rien ou presque.

O-/\/\/\/\/\ /\/\/\/\/\-O

Développement de micro-organismes dans une boîte de Pétri (en laboratoire) :
La fractale n'est-elle pas évidente ?